
|
Chapitre VII.
L'empire carolingien.
L’empire carolingien (751-843) ramène l’ordre. Pépin le Bref,
on l’a vu, fait une campagne d’Italie (756) pour remettre au pape
les principales villes d’Italie centrale. Il remet sur pied une administration
civile (comtes et marquis), s’appuie sur l’Eglise qui multiplie ses établissements
agraires, et organise le repeuplement des territoires dévastés.
Charlemagne, fils de Pépin
le Bref, sollicité par le pape Adrien Ier, se décide à
intervenir contre les Lombards. Il franchit les Alpes (773) par le col du
Mont-Cenis et par surprise, bat les Lombards. Désidério, abandonné
des siens, se réfugie à Pavie, où après un siège
(774), il est fait prisonnier, conduit en France et enfermé au Monastère
à Corbié, où il finira ses jours. Après la prise
de Vérone et de Pavie, Charlemagne s’empare de toute l’Italie et
met fin à la domination lombarde qui aura duré 205 années,
de 568 à 773.
Charlemagne devient roi des Lombards en 774. Le 25 décembre 800,
il est sacré empereur à Rome, dans la basilique St Pierre, par
le pape Léon III et son empire couvre les deux côtés des
Alpes. Il va durer jusqu’en 814.
Premiers comtés et marquisats.
A peine a-t-il pris les rênes du pouvoir, qu’il se met à réformer
son état. Il se soucie principalement de la sécurité
des provinces frontières. Les ducs étant devenus trop puissants,
il découpe le pays en plusieurs provinces, rendant celles des frontières
plus puissantes et plus étendues afin de pouvoir lever plus de troupes
en cas de conflit. Il rend officiel les noms des comtés-frontière
et leur confie les compétences sur les affaires politiques et militaires,
en plus de la justice ordinaire.
Dans les provinces, chaque cité
contrôle la justice civile et militaire, non seulement pour la cité
elle même, mais pour les territoires environnants, jusqu’aux limites
naturelles, montagnes ou fleuve.
Charlemagne distribue les terres
aux personnes les plus illustres et les plus dignes de confiance, créant,
de ce fait, les comtes et les marquis : comme les comtés des frontières
ont une autorité plus importante que les comtés des cités,
en particulier sur le plan militaire, petit à petit, pendant le IXe
siècle, ils se distinguent par leur nom et prennent le titre de marquis
(Marchesi) – de « marca » ou « marchia », mot barbare
utilisé alors pour indiquer les provinces frontières et qui
signifie « limite » ou frontière.
Charlemagne assoit le féodalisme
et la vassalité. Ses guerriers les plus illustres, à qui il
confie ses comtés ou marquisats, doivent contrôler la population
et servir en temps de guerre comme en temps de paix. De cette obligation
vient la pratique de l’hommage. L’usage de transmettre les titres de père
en fils, moyennant un acte de succession et le renouvellement du serment
d’hommage, s’établit petit à petit.
De plus, les vassaux principaux,
à l’exemple du roi, divisent leurs domaines en plusieurs districts
et les concèdent à des vassaux mineurs qui leur sont assujettis.
C’est de cette façon que se crée l’échelle féodale,
du roi aux vassaux principaux, aux vassaux mineurs et des mineurs aux sujets.
A partir des comtés
créés par Charlemagne dans le Piémont, naissent ceux
d’Asti, d’Alba, d’Acqui, de Turin de Bredulo et d’Auriate, au IXe siècle.
Nos vallées « carolingiennes
».
La haute et la basse vallée Varaita font alors partie du comté
d’Auriate, qui a pour frontières, au midi et à l’ouest, la
crête des Alpes, du Monviso au col de Fenestre. Il se situe au nord-ouest
de celui de Tende et couvre, outre une vaste plaine, l’Agro Saluzzese (Saluces),
les vallées du Pô, la basse et la haute Varaita et quelques
autres vallées qui avaient appartenus aux Ligures Vagienni. Où
se trouve le lieu d’Auriate n’est pas précisé par l’histoire
: cetains prétendent que c’est l’ancienne Roccavione sur la rive du
Gesso, près de Borgo S. Dalmazzo ; d’autres, comme Meyranesio, dans
son « Pédémontium Sacrum », pensent qu’il s’agit
de l’actuel village Vallauria ou Valoria, situé sur la gauche de la
Stura, près de Demonte, dont le nom antique était Vallis Aurata,
d’où viendrait le nom d’Auriate ; d’autres encore penchent pour un
site près de Demonte et de Caraglio.
Ceci étant dit, le premier gouverneur de ce comté, fondé
sous Charlemagne, fut un certain comte Henri, français, en reconnaissance
des services rendus à son souverain. Mort en 799, la mémoire
historique n’indique pas ses successeurs. Plus tard, on note un certain
comte Rodolfo, qui, au IXe siècle, est gouverneur du comté
d’Auriate.
Il est un fait qu’il n’existe pas de traces certaine, lors de la division
du royaume en provinces et cités, de la création par Charlemagne
ou ses successeurs d’un comté dans les environs de Saluces. Etant
donné que la cité est alors le plus grand bourg et est très
vaste, la région s’appelle Salutiœ et s’étend sur une partie
de plaine et une partie de montagnes allant du Monviso, avec les vallées
Varaita et Pô, jusqu’aux Alpes Maritimes. Et, comme c’est un poste
important pour les divers passages des Alpes, à l’embouchure de deux
vallées, il paraît certain que Charlemagne l’a pourvu d’un
comte ou d’un marquis. Nommé de fait, un certain Protado, qui fut
connétable de France, et qui laisse un fils héritant de la
dignité de son père et du comté de Saluces, au temps
de Ludovico Pio et de Charles le Fauve, lequel prend le titre de Protado
II.
A celui-ci succède, au
début du Xe siècle, le comte ou le marquis Gualtieri qui épouse
la célébre Griselda qu’ A. Della-Chiesa, dans sa « vita
del Beato Giovenale Ancune » dit native de Villanovetta et exemple
de patience féminine. Boccaccio, à l’instigation de Pétrarque,
raconte, dans son « Décaméron », l’aventure de
ces deux époux.
Il est probable que les comtes d’Auriate et
puis de Turin, à qui appartenait Saluces, incapables de surveiller
les cols alpins directement, ont dû stabiliser un vice-comte ou un
gouverneur, si celui-ci n’a pas été nommé directement
par Charlemagne.
Le témoignage de Tommaso III, marquis de Saluces,
dans son roman historique « Le Chevalier errant », indique un
préfet Gualtieri, pour le comté, neveu de Rodolpho,
premier comte d’Auriate, de façon certaine. Cette simple déléguation
du comte d’Auriate donnait autorité sur Saluces, avec comme titre
vice-comte ou gouverneur militaire. Les gens de l’époque l’appelait
par un titre de comte ou de marquis.
Dans le « Cartario Ulcienne N94 », de
l’an 1080, Adélaïde, comtesse de Turin nomme un certain Pagano,
son vicomte, à Auriate.
Les Maures, sur la fin du règne de
Charlemagne, reprennent leurs courses dévastatrices (806, 808, 813).
Les comtes et seigneurs provençaux, par besoin d’indépendance
ou par ambition, pactisent souvent avec eux, ajoutant à la confusion.
Partout on trouve les ruines de couvents, d’églises et de bourgades.
Un grand nombre d’habitants se réfugient dans les montagnes, abandonnant
leurs propriétés.

|
Puis Charlemagne partage son royaume entre ses trois fils en 806 :
la Provence et la Bourgogne à Louis, La Savoie (“Saboia”) et le nord
à Charles, l’Italie à Pépin. Mais ce partage ne dure
pas bien longtemps car Charles récupère l’ensemble des territoires.
L’insécurité règne : les Sarrasins pillent Arles (838),
puis Marseille (850).
Au traité de Verdun (843) tout revient à Lothaire
: c’est la Lotharingie.
|
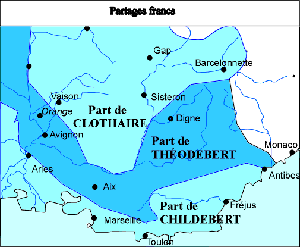
Royaume de Provence,
ou d’Arles ou de Vienne (879-947).
La dissolution de l’empire carolingien, à la mort de Charles le Fauve,
divise l’empire en trois royaumes : la France, la Germanie et l’Italie.
Sur ces débris de pouvoir, les dynasties comtales et ducales se mettent
en place et acquièrent une grande indépendance de fait.
En Provence,
un Franc, nommé Boson, représentant le roi, usurpe son pouvoir
(879) et devient premier comte de Provence. Il occupe la Provence,
les vallées de l’Isère, de l’Arc et le comté de Savoie.
Le nord de la Savoie se trouve inclus dans le royaume de Bourgogne Transjurane,
fondé en 879, par Rodolphe Ier.
Les cols alpins.
Le Mont-Cenis, vers 800, débouchant directement sur l'Helvétie,
la France centrale, intéressant aussi les régions du Nord,
commence à supplanter le Mont Genèvre. En 792, Louis-le-Pieux
l’utilise, puis, trente années plus tard, son fils Lothaire, En 876,
puis 877, c'est Charles-le-Chauve, revenant d'une expédition manquée
en Italie. Il périt misérablement au petit village mauriennais
d'Avrieux, empoisonné, dit-on, par son médecin.
|
|



