
|
Chapitre III.
Les Romains.
Conquête de la Gaule.
Les romains, après la conquête de la vallée du Pô
sur les gaulois, traversent les Alpes et livrent leurs premières batailles
contre les ligures (Salyiens), à Æegitna (Biot, Alpes-Maritimes)
en 154. En 125, Marseille, colonie grecque, demande l’aide de Rome, qui
vient à son secours. Le danger écarté, les romains
font main basse sur une région qui s’étend de Genève
aux Pyrénées.
En 122 avant J-C., les romains construisent la
via Domitia, pour assurer une voie de
passage vers l’Espagne, fondent Aix et la Provincia Romana ( première
province transalpine), qui laissera son nom à la moitié orientale
(Provence), mais sera appelée Narbonnaise (fondation de Narbonne
en 118). La conquête de la Gaule par Jules César commence en
58 et dure jusqu’en 51. La reddition de Vercingétorix, assiégé
dans Alésia (-52), marque la fin de la guerre.
Pendant cette conquête de la Gaule, les Romains n’ont fait que passer
: les Alpes ne sont pas occupées.

Campagnes romaines en Provence (-200
à -120)
L’empire Romain ( de -120
à + 415) ; conquête des Alpes.
Il faut attendre encore quelques années avant que les peuples alpins
soient soumis à Rome : les Romains y parviendront grâce à
quelques rois alpins, comme ceux de Suse. Ils se sont d'abord contentés
de négocier le passage : « Ce fut César, nommé
proconsul d'Illyrie, de Cisalpine et de Transalpine, qui réalisa le
vieux rêve des généraux romains. L'occasion en fut l'annonce
d'une véritable migration des Helvètes, prétendant, des
bords du Léman, aller coloniser le centre de la Gaule. Averti de ces
intentions, il se hâta en - 58 de passer le Montgenèvre avec
cinq légions, pour parvenir de Rome à Genève en huit
jours, soit une moyenne de 150 km par jour. Elle donne une idée du
bon état des routes jusqu'au pied des pentes, peut-être jusqu'au
sommet du passage, car au-delà, on entrait en pays barbare. Au cours
des huit campagnes qui suivirent, César passa et repassa à
plusieurs reprises le Mont Genèvre, aussi, sans doute, suivant les
nécessités du moment, le Petit Saint-Bernard.»
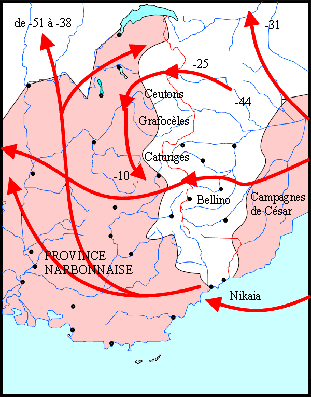
Campagnes romaines dans
les Alpes
|

L'Emprire romain
|
La conquête définitive
fut l'œuvre d'Octave Auguste (24-14 avant J.-C. ).
En –7 est crée la Province des Alpes Maritimes, une province militaire
sous la dépendance directe de l’empereur. Cemenelum (Cimiez), mise
en place en 13 avant J.C., en devient la capitale. Elle s’étend jusqu’à
Barcelonnette et déborde sur le Val Stura italien.
Un
an plus tard, les romains édifient le Trophée de La Turbie,
pour célébrer la victoire sur tous les peuples alpins : Ceutrons
de Tarentaise, Grafocéles de Maurienne, Caturiges du Mont Genèvre,
Salasses du Val d’Aoste, Quariates du Queyras,
Vagienni ou Venisani du ValVaraita
. Ce Trophée énumère les 48 peuples vaincus.
Ce qui permet de constater l’extrême morcellement de la population
dû, sans doute, au relief difficile. Ce trophée est construit
au point le plus haut de la « Via Julia
Augusta » qui relie l’Italie à
l’Espagne par la Narbonnaise. Cette grande voie romaine joue un rôle
économique et militaire important. On trouve encore les bornes qui
jalonnaient cette voie entre Vintimille et Fréjus, par La Turbie,
Cimiez et Vence. Nice, port grec, est laissé à l’écart.
Les arcs de triomphe d'Aoste et de Suse témoignent encore de ces
victoires romaines.

Arc de triomphe d'Aoste
|

Arc de triomphe de Suse
|
Nos vallées «
romaines ».
En ce qui concerne nos vallées, Cozio
, qui gouverne alors les vallées alpines, se soumet volontairement
aux Romains, sous Octave. Du Monviso au Mont-Cenis, les peuples dépendent
en grande partie du gouvernement de ce Cozio, installé à Suse.
Il reçoit, en récompense, le titre de roi et un petit royaume,
tributaire de Rome, qui comprend 14 populations réparties sur les
deux versants des Alpes occidentales. Cozio fait ériger un arc de
triomphe, à Suse, visible encore aujourd’hui, et sur lequel sont notés
les noms des 14 peuples [4]. Celui d’Aoste marque aussi la soumission à
Rome.
Sur les cartes géographiques des Alpes occidentales, les habitants
du Val Varaita de l’époque gallo-romaine sont appelés
Venicamori : ce nom est probablement dérivé
de Venica (Venasque) de la basse vallée, qui était, en ces
temps là, le centre principal du commerce de la vallée
(7)
.
Avec Néron (37-68 après J-C), les Ligures passent complètement
sous le domination romaine, leurs territoires devenant une Province d’Etat
de l’empire romain. [4]. Diverses monnaies romaines trouvées à
Sampeyre et dans d’autres lieux de la vallée, et l’existence de quelques
inscriptions, attestent la communication et les relations politico-commerciales
que les Venicamori
ont avec Rome.

Voie romaine dans les Alpes
Les grands cols
alpins romains.
La faible altitude du col du Montgenèvre
et l’insécurité régnant sur la zone côtière
en ont fait le passage majeur des Romains.
« Après
la mise au pas, plus ou moins brutale, des différentes tribus montagnardes,
une vraie route, fut édifiée à l'initiative des vainqueurs
par Cottius, fils de Donnus, commensal de César, dont le petit royaume
enjambait la crête des Alpes, d'où les noms Alpes Cottiennes
et "Via Cottia per Alpem". Cette voie, à partir de Turin, gagnait
Valence par "Fines Cottü" (frontière cottienne, douanes, où
les marchandises payaient le quarantième de leur valeur...), Suse
(Segusium), capitale, Oulx, Cesana (Gaesao), les redoutables gorges placées
plus tard sous le patronage de Saint Gervais, Matrona, point culminant du
passage, où il existait une importante station routière avec
mansio, et aussi, d'après la chronique de la Novalaise, un temple dédié
à un certain Cacus, jadis vaincu par Hercule avec l’aide de Jupiter
"monument d'une remarquable architecture, construit avec des blocs de pierre
reliés entre eux par des barres de fer scellées avec du plomb"
et dont on a retrouvé quelques vestiges au siècle dernier.
»
Au bas de la descente, la route passait à Briançon (Brigantium),
à Embrun (Eburodunum), à Chorges (Caturigomagus), puis à
Gap. Un prolongement de la Domitienne descendait directement par le sillon
de la Durance (navigable à l'époque à l'aide de radeaux
montés sur outres).

Au Montgenèvre, il reste aussi quelques vestiges de la grande artère
"in alpe Cottia" dont les lacets raides tracés sous Clavière
forçaient à démonter les chars et laissaient un souvenir
ému aux "traverseurs" surtout en période d'enneigement...
"Le voyageur venant des Gaules écrit Ammien Marcellin, qui dut
faire l'aller et le retour vers 335 après J.C., trouve en effet une
pente assez douce, mais, sur l’autre versant, les murailles de rochers en
surplomb offrent un spectacle terrifiant : surtout au printemps, lorsque les
glaces et les neiges fondent au souffle plus chaud des vents et qu'à
travers les gorges, entre deux à pic et les ravins dissimulés
par les congères, hommes et bêtes descendent à pas hésitants
et s'abattent ainsi que les attelages. Et le seul remède que l'on
ait trouvé pour éviter leur perte est celui-ci : la plupart
des véhicules sont attachés par de grosses cordes, retenus
par derrière par l'effort vigoureux des hommes et des bœufs,
et, marchant à peine d'un pas traînant, descendent les pentes
avec un peu plus de sécurité".
Le Col
de Larche, culminant à 1991 m, présente
des pentes douces, boisées de mélèzes, et la seule
difficulté est un défilé, côté italien,
mais il est assez souvent balayé, l’hiver, par des vents furieux.
“Nul doute qu'une voie romaine, établie sur l'ancienne piste Ligure,
passait déjà par là avec un embranchement à
Gleisolles pour le dit Col de Vars, au confluent de l'Ubaye et de l'Ubayette.
C'était après tout le plus court chemin entre l'Espagne et
Plaisance, et certains tiennent que Pompée, retournant en Italie
pour combattre Sertorius, emprunta cette route vers -70. En tous cas, les
indigènes qui se nommaient Esubiani, les Esubiens, passaient pour
aussi farouches que leurs ours ou leurs chamois. Ils supportèrent
si mal le joug des légions qu'ils préférèrent
émigrer”
La Table de Peutinger
, un parchemin médiéval, copie d’une carte d’Agrippa, qui
fut mise à jour jusqu’au III ou IVe siècle, montre ses passages
alpins.

Malgré ces turbulences,
et les fréquents passages des troupes, le peuplement alpin ne subit
pas beaucoup d’influence. L’élevage reste l’activité la plus
importante, de bovins lorsque l’herbe et les pâtures le permettent
ou des ovins dans les alpes du sud. La population ne varie guère :
dans le Queyras, par exemple, la principale immigration vient du Piémont.
On notera, plus tard, un enracinement solide de la couche primitive de population,
avec transmission, pendant un millénaire au moins, de nombreux noms
de famille.Pax Romana.
Les romains apportent la paix (Pax Romana), la création d’un état
centralisé et une période de stabilité pour les populations.
Ils établissent des circonscriptions, créent un réseau
urbain assez dense, mettent en valeur les voies de communication, et améliorent
la circulation (routes avec relais) en créant une infrastructure nécessaire
à l’unité des nouvelles provinces. Les routes convergeant vers
Lyon, n’utilisent que faiblement les traversées alpines, le trafic
principal restant maritime, avec principalement les ports d’Arles et de Narbonne.
La longue période de paix gallo-romaine n'a pas ajouté une
nouvelle couche de peuplement mais développé l'agriculture
(nombreux noms de lieux dérivant de propriétaires de villas,
surtout dans les plaines).
L'occupation romaine en Dauphiné,
à partir de –121, durera 575 ans environ, imprégnant fortement
la civilisation.[55] La majeure partie du Dauphiné est rattachée
à la province Narbonnaise, administrée par un proconsul de
rang sénatorial, tandis que la haute Durance et le col du Mont Genèvre,
de première importance, maintenue par Néron dans les Alpes
Cottiennes relevaient directement de l'empereur.[55]
L'ensemble se subdivise en pagi (nos actuels “pays”) autour de vici,
bourgades souvent médiocres comme Cularo (future Grenoble) ou Augusta
(Aoste).[55]
Dans les régions montagneuses le portage pour le franchissement des
cols fournit certainement du travail dans bien des villages au pied des
crêtes. Surtout, les habitants utilisent les ressources particulières
des massifs, le bois (pour la construction navale), les filons métalliques
ou l'élevage, dont le cuir et la laine alimentent une industrie prospère.[55]
La langue
d’oc dans les vallées.
Avec la domination romaine, tout le
monde méditerranéen utilise le latin. Ce latin devient populaire
dans nos régions par l’influence des colons et des soldats romains.
Cette langue se diversifiera par l’influence des parlers. Entre les Pyrénées
et les Alpes se développe la langue
d’oc, dépassant même les Alpes
dans quelques vallées italiennes.
Ces vallées de la province de Cunéo et quelques autres qui
font aujourd’hui partie du Turinois, suivent la Provence et le Dauphiné
méridional, dans cette évolution du latin. Une des causes profondes,
de nature historique, est que les Romains, depuis la conquête des Alpes,
ont fixé la frontière, entre l’Italie et la Gaule, le long
d’une ligne qui sépare la plaine piémontaise des premiers contreforts
des Alpes. Des bourgs comme Borgo San Dalmazzo ou Piasco sont devenus des
postes de douane où se paie la taxe de 2,5% de la valeur des marchandises
qui entrent en Italie. Il est probable que l’antique division du territoire
a continué à exercer une influence importante sur les communications
et donc sur les parlers. La langue d’oc se développe donc à
l’intérieur des frontières de l’antique division romaine, de
chaque côté des Alpes. La communauté d’intérêts
des montagnards, de chaque côté des Alpes a maintenu une langue
commune. L’influence du Piémontais a été faible.
La langue
de nos ancêtres des vallées occidentales doit quelque chose
aux romains et à leurs péages.
|
|



