XVII. Début du XVIIIe
siècle.
La peste de 1720.
Un bateau, le Grand Saint-Antoine, en provenance du levant arrive à
Marseille en 1720, n'observe pas sa quarantaine et propage la peste.
Durant l'été, le nombre des décès est considérable
et la maladie s'étend aux campagnes environnantes, puis atteint
Toulon. Au lieu de prendre la fuite pour éviter la contagion, Mgr
de Belsunce parcourt la ville, le nez seulement protégé d’une
éponge trempée dans du vinaigre, distribuant aumônes,
réconfort, confessions pour les mourants. Malgré les risques,
il échappe à la mort et sa conduite admirable en fait une
figure de l’époque.
La peste progresse, réussit à passer les murs de protection
et le Comtat se prépare, corps et âme, à l’approche
du fléau.

A Carpentras, l’évêque Abbati multiplie prières, processions,
exposition des reliques, promenade du St Mors ou St Clou (qui aurait été
forgé avec l’un des clous de la Passion ramené de Jérusalem).
Peur et dévotion font porter un « clou d’argent » consacré
au revers de l’habit. Le vice-légat interdit tout commerce avec
la Provence.
Nos villages se protègent en s’enfermant derrière leurs murailles.
A Caromb, on choisit 2 personnes intelligentes pour veiller à ce
que la garde des portes soit bien tenue, sans qu'elles ne puissent se faire
remplacer. On interdit encore une fois le fumier le long des murailles, de
la porte du Rieu au Jeu de Ballon et on fait ôter celui qui reste dans
les rues.
On fait murer la porte par laquelle on entre de dessous les cloches dans
le cimetière et on construit une muraille derrière la chapelle
Ste Magdeleine ; on fait murer la brèche près de la porte
de byliso ( ?) ; on fait fermer la porte de la Mirande ; on demande au fermier
du seigneur les clés de la poterne du château pour lever le
pont-levis ; on fait réparer les portes de la ville afin que plus personne
ne puisse passer dessus, ni dessous ; on ferme les portes à 9h1/2,
après avoir sonné les cloches des pénitents blancs comme
avertissement et, sitôt après, les clés sont remises au
1er consul ; on donnera une pièce de pain aux passants qui n’auront
plus le droit d’entrer.
On le voit, toutes les précautions sont prises pour que l’enceinte
du village soit un vrai refuge, fermé hermétiquement, au
cas où la peste arriverait à nos portes.
Les habitants des bourgades (*61
) ne recevront plus d’étrangers.
On répare la fontaine de St Maurice dont l’eau est si utile pour la
santé.
On chasse un déserteur des galères et sa famille
Et on fait appel à la religion, à St Roch qui a déjà
tant fait, qui nous a déjà sauvés de la peste ou de
la rage. On fait remettre en état “la roue du bienheureux” pour la
faire veiller selon l’ancienne coutume. Comme à Carpentras, on organise
des processions. On dépose les Saintes Huiles de l’extrême onction
chez les dames de Ste Ursule.
Même pendant ces préparatifs face à l’adversité,
nos nobles défendent leurs prérogatives : le 25 août,
le marquis de Sade représentant les nobles vassaux du Comtat, proteste
contre la juridiction qui aurait été donnée aux consuls
et aux bureaux de santé de se saisir des clés des poternes.
Le vice-légat répond par lettre au chef élu de la
noblesse, le marquis de Modène, Louis-Hiacynthe de Raymond de Mourmoiron,
qu’il suffit de lui envoyer les clés avec étiquette et que
c’est lui qui donnera ses ordres aux consuls.
Le mal progresse toujours et, début septembre, le vice-légat
réclame, aux consuls des villages, des hommes ayant déjà
servi (dans les armes) pour venir constituer une compagnie de 50 hommes
chargée d’empêcher les gens et les marchandises de franchir
la Durance. Le vice-légat prend la tête de la lutte contre
la peste, et avec ces 50 hommes à recruter, à armer et à
payer, se donne une première force de défense. A une assemblée
de Carpentras, nos consuls apprennent que cette ville fournit trois hommes
et que chaque village doit en fournir un.
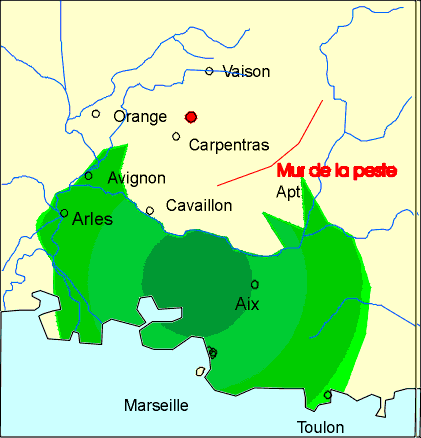
A Caromb, il n’y a pas de volontaire et la sélection se fait par tirage
au sort dans un chapeau. La personne choisie est récusée
par le vice-légat car il est soutien de famille. On décide
un nouveau tirage au sort, après la messe du 18 septembre, parmi
les jeunes gens éligibles. Le tirage au sort est très long
et très compliqué puisqu’il se termine le 24 septembre. Le
26, le capitaine de Carpentras refuse ce soldat de Caromb car trop petit
et trop jeune. On décide d’acheter une nouvelle personne pour être
soldat. On achète aussi l’équipement : fusils et baïonnettes.
Si nos villageois sont enfermés derrière leurs murailles, il
n’en est pas de même pour le bétail qui, lui, doit sortir.
Dès le 18 septembre, on se plaint au vice-légat des dégâts
causés par les bêtes à laine dont la quantité
a augmenté : on les interdit sur la commune, sauf au quartier de
St Hippolyte. En octobre, on interdit aux habitants de garder vache ou bœuf
“à bâton plantat”, pour les même raisons.
Un voleur d’olives ayant été surpris, on nomme 8 gardes pour
les olives.
En novembre, on fait mettre une petite clochette à la porte publique
de l’église pour réveiller le capitaine des portes en cas
de maladie chez les “bourgadiers” (ceux qui habitent en dehors de l’enceinte
du village). Le capitaine ira alors avertir le médecin ou le chirurgien.
Nos villageois vivent dans l’angoisse. Foires, marchés, attroupements
et circulation de marchandises sont interdits [33].
Le vice-légat demande aux communes de constituer des bureaux de santé,
dès septembre, puis il organise la garde "de la montagne qui sépare
de la Provence" (Monts-de-Vaucluse). Caromb doit lever et payer 10 soldats
pour 8 jours (octobre).
Dès mars 1721, le vice-légat décide d’employer les grands
moyens pour combattre l’avancée du fléau et ordonne la construction
d’un grand mur, de 36 km de long, vers Méthamis et Venasque. Ce «mur
de la peste», en pierres sèches, doit être gardé
par des sentinelles pour ne laisser passer personne. Ce mur, sur un axe
Cavaillon-Sault, essaie d’isoler le Comtat de la Provence proprement dite.
Il réclame à chaque communauté un nombre déterminé
de personnes pour construire ce mur. Chaque homme devra avoir un outil
_ pelle, lichet ou pioche_ pour construire ce mur, et des vivres pour 10
jours. Caromb doit fournir 13 hommes.
Bien évidemment, il n’y a pas de volontaire lors de l’appel sur la
place publique, par peur de la contagion. Le conseil doit les désigner.
Début avril, le vice-légat
réclame l’enrôlement de 8 travailleurs pour “la garde des lignes”.
On met 58 noms dans un chapeau et on les tire au sort ; ces 8 hommes rejoindront
Venasque et seront relevés par 8 autres, tous les 15 jours.
En même temps, on stocke de la farine dans la tour de la porte du Rieu
près des moulins ; on équipe l’hôpital de 30 paillasses
et de 30 traversins, que l’on range dans un coffre bien fermé et
on dépose la clé aux archives.
En avril encore, on apprend la mort du pape et on décide de faire
un service de funérailles à l’église de St Maurice.
En mai, 7 personnes de Caromb rejoignent les 300 hommes de la garde de la
ligne et on devient encore plus restrictif sur l’ouverture des portes du
village : on ferme alternativement la porte Neuve et celle de la fontaine
pendant la journée et les deux portes sont fermées dès
21 h.
Dès l’été 1721, la peste passe la Durance et atteint
Avignon et Bédarrides.
En juillet, le mur est en construction. Il reste 12,4 km à faire ou
6.200 cannes, et on ajoute un fossé de 2,6 m. Le vice-légat
fixe l’objectif de tout finir pour le 10 août, répartit le
travail entre les communautés, à leur charge de définir
le nombre d’ouvriers à envoyer sur ce chantier.
Au sud, dans les villes touchées, ceux qui ne sont pas encore contaminés
n'ont d'autre solution que la fuite et une chronique avignonnaise de l'époque
précise que «toutes les portes de la ville ont peine à
suffire à la foule de ceux qui sortent. Tout déserte, tout
abandonne, tout fuit».
Notre consul ayant voulu réquisitionner une bourrique s’est entendu
lui opposer un refus insolent par une femme. Le conseil réclame une
sanction au viguier, comme “de faire garder les arrêts au château
pendant 3 jours” à cette femme peu commode.
Le mal contagieux progresse toujours. En août, la communauté
fait mettre une inscription et ses armes sous les pieds de la statue
de la vierge placée au-dessus de la porte de l’église et
que l’on appellera Dame de Lagarde.
Le conseil emprunte 10.000 livres pour acheter des vivres, des drogues, de
la poudre.
En dehors de l’enceinte, on fait dresser des murailles et palissades autour
des bourgades et chaque habitant donne une journée gratis pour fermer
les “advenues dudit Caromb”. En novembre, on achète couvertures
et draps de lit pour l’hôpital.
On sait que la peste a réussi à passer le fleuve et les murs
de protection. Après Avignon, elle est bientôt à Sarrians
et Monteux ; on redouble de précautions.
Le vice-légat fait mettre des gardes sur les ponts du Comtat avec
ordre de tirer après 3 coups de sommation : Caromb doit fournir 4 hommes
avec poudre et plomb.
Le vice-légat a aussi son service de renseignements : ainsi on recherche
un chirurgien-parfumeur qui, en quarantaine, s’est enfui après 20
jours. Reconnu et arrêté à Caromb, sans billet de santé,
il est interrogé par le bureau de santé et par le viguier,
puis fusillé pour risque de contagion. La population approuve les
consuls pour cette décision qui a peut-être évité
la contagion du village.
On refait le point sur l’état du village : les greniers à blé
sont pleins. On établit des calades autour des fontaines de la place
et de la fontaine basse pour protéger l’eau. Le corps de garde de
la Porte Neuve est en ruine, mais on renonce à le réparer.
Le 12 juin, on apprend qu’à Avignon, les “parfumeurs” chargés
de désinfecter par le feu ont, par mégarde, mis le feu au
couvent des Augustins, brûlant ainsi une inestimable bibliothèque
de 800 volumes.
En juillet, apparaissent les militaires français, neuf compagnies
de Guernesey, une infanterie qui a reçu l’ordre royal de venir lutter
pour que la peste ne remonte pas jusque chez eux. Le vice-légat
demande que chacun “témoigne de sa fidélité au pape
mais cède cependant à la force”. La troupe avance dans le
Comtat jusqu’à la ligne de santé.
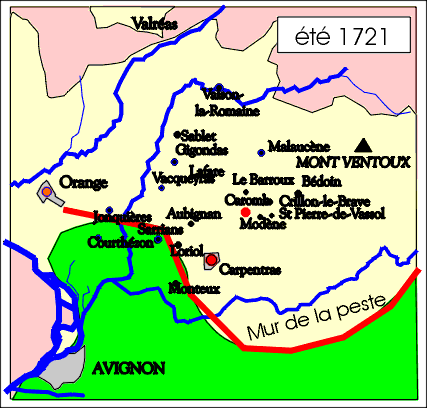
A la fin de l’été, Caromb décide de vendre une centaine
de ses moutons car ils sont en surnombre, puis, en septembre, le conseil
autorise de sortir pour les vendanges : il faut bien continuer à
vivre.
Les Français prennent la direction des opérations : ils ordonnent
la construction de corps de garde et de guérites sur la ligne de
front. Ils veulent une véritable muraille de chine. A Mazan, où
ils cantonnent, se produisent quelques heurts avec la population locale.
Carpentras qui refuse son aide est occupée : avenues, portes de la
ville, maison de ville passent sous le contrôle des troupes françaises
et la communauté doit se soumettre.
En octobre, ces même troupes demandent à Caromb, Beaumes, le
Barroux, Malaucène et Entrechaux de construire neuf corps de garde
et dix-huit guérites et on se garde bien de refuser. Sarrians dirige
les travaux : il faut sept charrettes de pierres plates pour chaque corps
de garde et six pour chaque guérite. Les douze travailleurs réquisitionnés
de Caromb, sous prétexte qu’ils ne s’y entendent pas, se font vite
remplacer par des habitants de Sarrians que l’on paie au forfait. Nos villageois
fournissent des tuiles et louent des mulets pour le charroi.
Le mur, les corps de garde et les guérites sont enfin terminés
et protégent le pays. Un millier de soldats y montent la garde en
1722. Cette année là, la Grande Peste se répand dans
toute la Provence et le Languedoc. La population fuit vers les montagnes,
qui, grâce à des mesures sanitaires, sont des zones épargnées.
Les grands moyens sont efficaces et, même si la peste réussit
à passer, ça et là, la muraille de protection, l'épidémie
ne progresse plus vers le nord. Les Français gèrent
la logistique. M. de Lauzun, commissaire français de la police de
guerre, a chargé les consuls de Sarrians de répartir les fournitures
pour l’hiver entre les diverses communautés. Caromb doit fournir du
bois, de l’huile à brûler avec les mèches, de la paille,
doit les transporter et les distribuer tous les cinq jours le long de la
ligne. Nous manquons de bois et devons l’acheter. Pour payer ces achats, la
communauté vend le reste de son troupeau de moutons. Elle précise
qu’elle cède à la force lorsqu’il faut encore envoyer des menuisiers
avec leur matériel à Sarrians pour faire des lits de camp.
En décembre 1722, le danger est écarté. La communauté
fait vendre aux enchères les toiles, les couvertures de laine, les
“basaques” (couvertures de coton), les traversins, les toiles cardon, les
toiles rousses destinées à faire des linceuls, les sacs,
soufre et autres, qui avaient été stockés pendant l’épidémie.
En janvier 1723, le sergent de Caromb fait crier aux carrefours que l’on
organise cette vente aux enchères. La plupart des objets sont achetés
par un juif de la carrière de Carpentras. Tuiles, portes et fenêtres,
lampes en fer blanc, reste de bois, sont récupérés à
Sarrians.
Elle fait son bilan : les deux baraques et quatre guérites construites
entre Avignon et Monteux, sur le territoire de Sarrians ont coûté
168 livres et les fournitures, 333 livres. Sarrians n’a remboursé
que 153 livres.
Des pierres empruntées à des particuliers pour murer les portes
ayant disparu, on les paie 21 livres.
Au bilan, on compte 87.000 morts en Provence et 7.300 dans le Comtat, d’après
un document officiel de l’époque. La peste a épargné
Carpentras, Caromb et le Haut Comtat, grâce à ces mesures
draconiennes.
Il faudra quelques années pour se débarrasser complètement
de cette peste.
Il va sans dire que la maladie a arrêté toute activité,
tout travail d’importance et que la priorité était la protection
civile. A Carpentras, les travaux de construction de l’aqueduc qui devait
amener l’eau de Caromb jusqu’à la ville se sont arrêtés.
En février 1723, le danger écarté, les troupes françaises
rentrent chez elles. La tranquillité et le calme reviennent en 1724
Comme si la peste ne suffisait pas,
l'été 1723 est si chaud que les gens croient à une mort
générale ! [54].
Les années qui suivent montrent que la vie est redevenue normale :
au 1er mai 1723, on élit un nouveau conseil ; des moutons étrangers
mangent nos rameaux d’olivier et donc on rappelle le règlement interdisant
le bétail lanud ; il n’y a toujours aucun candidat au poste d’extracteur
de la taille et on en nomme un de force parmi les 24 habitants jugés
capables ; les vendanges débutent le 13 septembre 1725 ; on fait
réparer les "gorgages" des eaux pluviales, en particulier celui qui
passe sous une maison de la rue des Tournoches et ceux du moulin des os ;
on répare aussi la rue du château jusqu’à la maison de
F. Gallien ; on achète de nouvelles meules ; on égalise les
poids et mesures ; on achète un tapis pour les chaises des consuls
à l’église.
Bref, rien de plus normal : le train-train
quotidien d’un village du Comtat.
L’affaire des
bouchers.
Sauf que, la vie est décidément trop tranquille, trop terne,
sans gros soucis pour nos carombais de l’époque. Il faut trouver quelque
chose pour animer un peu la vie sociale : dès mars 1724, c’est
fait, c’est l’affaire des bouchers du village. Pensez donc, ils auraient
vendu à leur profit de bons gros moutons, bien engraissés sur
notre terroir et ils n’auraient proposé aux villageois que quelques
moutons maigres ou morts à l’extérieur. Qui plus est, l’échange
de mouton se serait fait de nuit, alors que le troupeau était au
château, en faisant passer clandestinement les bêtes par la poterne.
Evidemment, le ton monte vite et “même les conseillers subissent
de mauvais traitements de la part des bouchers”. On décide vite de
refuser leur candidature à la ferme de la boucherie et de les expulser.
Ce serait bien simple si le règlement de la boucherie l’autorisait,
mais il faut l’agrément du vice-légat, et le village doit
accepter de reprendre le même boucher.
Imaginons un instant les discussions engendrées, dans la Grande-Rue
ou au coin de la porte de l’église,…
On décide de faire deux boucheries, une de mouton, l’autre de bœuf
et de brebis. On fait chasser un “coupeur de viande”.
En juillet 1727, soit trois années plus tard, le consul, paré
de son chaperon et suivi du valet de ville, mais sans le viguier qui a
refusé de les accompagner, se rend dans la basse-cour du château
pour vérifier si le boucher n’a pas trop de moutons. Conformément
au statut de sa ferme, il est autorisé à 4 “trenteniers”,
soit 120 moutons.
Le fermier, accompagné du prêtre, s’interpose, arrête
le consul, l’injurie et le menace de 50 coups de bâton. C’est Don Camillo,
à Caromb !
La communauté aide son consul, réussit à faire sortir
le troupeau sous la menace du boucher, et, bien sûr, elle constate
qu’il y a plus de moutons que prévu dans le règlement. Le
consul va porter plainte à Avignon. On transige : le fermier présente
ses excuses au consul devant le conseil, promet de payer les frais pour
arrêter le procès et, en plus, fait un don de 150 livres à
l’hôpital St Maurice et achète des cierges à la confrérie
du St Sacrement.
Ne soyons pas étonnés s’il n’y a plus de candidat à
la ferme de la boucherie en avril 1729. Le conseil souhaite alors mettre la
boucherie en régie, avec un coupeur de viande salarié de la
commune et un berger pour garder les moutons. La vente du bétail
sera une responsabilité communale, et on nommera un conseiller pour
tenir les comptes.
En mai, le conseil donne l’autre ferme de la boucherie, celle du bœuf et
des brebis, à un étranger de Sault, car il vaut mieux que ce
ne soit pas un Carombais. Pourtant, un vote à ballottes secrètes
préfère un Carombais. On s’empresse de lui adjoindre deux
surveillants. La boucherie de mouton reste en régie et donc, on compte
six personnes pour s’occuper de la viande, …
Ce ne doit pas être suffisant puisqu’en mars 1730, le conseil fixe
le prix de la viande pour le bœuf et la brebis et on impose un “peseur de
viande” pris dans la communauté. On lui interdit aussi de vendre du
mouton.
Avec une telle organisation, on aurait souhaité quelque efficacité.
Eh bien, non ! Puisque, dès mars 1732, une réunion du “triple
conseil” exclut à jamais du fermage les deux bouchers qui ont très
mal servi les habitants, vendu des brebis au lieu des moutons, laissé
manger les oliviers par leurs bêtes, refusé de la viande aux
pauvres et menacé des clients avec un couperet et un pistolet.
Cela devient “Don Camillo Monseigneur”, en mars 1733, quand le vice-légat
prend partie contre la communauté et fait réintégrer
les deux anciens bouchers dans leur ferme. Le conseil fait savoir qu’ils
ont été exclus pour mauvaise conduite et qu’il préfère
mettre les boucheries en régie. Le “triple conseil” se réunit
bien vite lorsqu’il trouve deux nouveaux candidats pour tenir les boucheries.
En mai, c’est l’élection consulaire, autre moyen de s’occuper l’esprit.
Justement, après avoir évoqué le St Esprit, le viguier
demande au 1er consul de proposer quatre noms de la 1ere main pour lui
succéder. Celui-ci préfère qu’un enfant tire au sort
dans un chapeau. On en sort deux noms qui sont soumis aux ballottes secrètes
pour désigner le 1er consul. Comme ce procédé n’est
pas réservé qu’aux riches, on élit le second consul
de la même façon, puis les conseillers. Les consuls désignent
directement quatre auditeurs des comptes, deux prieurs de St Maurice, un
procureur, un ouvrier de l’église et les avocats pour Avignon, Carpentras
et Caromb.
A côté de tout cela, c’est le train-train habituel : vendange
le 14 septembre 1724, augmentation des gages du régent des écoles,
nomination des fermiers des moulins, réparation des murailles de la
ville à la rue Basse. On règle quelques dépenses au
fontainier, au capitaine des portes, à la confrérie de St Roch
et St Sébastien pour la cire des cierges, au loueur d’une chambre pour
le porcher, aux joueurs d’orgues pour la bravade de la Fête-Dieu.
On décide de faire casser le
procès que le prêtre veut intenter à la communauté
pour être dispensé du paiement de la taille en fournissant des
preuves de paiements précédents à rechercher aux archives.
Sous la rubrique “faits divers”, notons :
- - en 1726, le vice-légat
fait battre la campagne de nos villages par des gens armés pour arrêter,
marquer et chasser les vagabonds.
- - la promotion d’un consul n’ayant
que 562 florins au cadastre (alors qu’il en faut 600) à la 1ere main
car il a les qualités requises.
- - un enfant a été
exposé dans la cour du château en octobre 1729 et le conseil
n’est pas d’accord pour l’élever aux frais du contribuable carombais.
Le vice-légat exige que l’enfant soit nourri par la communauté,
mais le conseil fait appel.
Nous recherchons toujours un extracteur-percepteur et on propose de relever
son pourcentage à 6% pour susciter les vocations. Rien n’y fait,
on doit le nommer de force.
En 1729, la communauté, Dieu merci, prend conscience de la valeur
de ses archives et décide de faire un inventaire et d’imprimer
un petit livre où sont transcrits les parchemins anciens. Ceux qui
ont pris cette décision ne savaient peut-être pas qu’ils sauvaient
ainsi une partie du patrimoine communal pour les générations
futures, dont la nôtre. Ils étaient motivés par les
quelques affaires qui avaient récemment demandé de consulter
les textes anciens.
Encore merci, messieurs.
La prise de conscience de la valeur du patrimoine est, par ailleurs évidente
lorsque l’on prend soin de respecter les parapets, créneaux et tours
des murailles de la ville lors des nécessaires réparations,
alors que leur valeur défensive n’est plus d’une grande utilité.
Les murailles ont vieilli, la base des remparts est pourrie et des maçons
de Carpentras doivent les consolider avec “huit pierres boutisses” (qui
traversent l’épaisseur du mur).
En avril 1732, le fermage du sel rencontre à son tour des difficultés
et le brigadier de la garde du sel est député par le vice-légat
à Caromb pour ordonner qu’il n’y ait qu’un seul “regrattier” par
communauté.
Le
vice-légat intervient l’année suivante pour forcer la communauté,
avec Entrechaux, Sablet , Malaucène, Vaison, Villedieu et Séguret,
à nourrir les “Maccabées” depuis longtemps prisonniers. Caromb
répond que c’est à Sablet et Séguret, leurs villes
d’origine, à les entretenir.
Notre conseil proteste contre l’insolence d’une lettre du prieur de Caromb
qui souhaite que le conseil renonce au repas qu’il doit offrir, quatre fois
l’an, aux consuls, procureur et ouvrier de l’église. Le conseil
refuse la demande.
L’aqueduc de
Carpentras.
Carpentras attend jusqu’en 1729 pour reprendre les travaux de l’aqueduc.
L’eau, captée au pied des collines du Paty suit un parcours de 10 Km
en souterrain avant de franchir l’Auzon par 48 arches. L’aqueduc a été
dessiné par M. Clapier et les travaux sont contrôlés par
M. d’Allemand. Nos ouvriers carombais exploitent les carrières les
plus importantes de la région et fournissent des pierres de taille
pour la construction. Après cinq ans de travaux, il est terminé
en 1734 et il fonctionnera de 1745 à 1893. Il mesure 729 m de longueur
et sa grande arche, au-dessus de l’Auzon, a plus de 30 m d’ouverture. La ville
de Carpentras a investi près de 400.000 francs de l’époque pour
sa réalisation.
Les co-seigneurs
de la Baume-Montrevel.
Où en est-on avec nos seigneurs dans le Comtat ? A côté
de l'administration pontificale, ils sont toujours présents, avec
leurs propres droits. Des biens allodiaux persistent dans certains villages
comme Bédoin ou Carpentras. Le Saint-siège cherche encore à
s'accaparer certains de ces droits. S'en est trop pour des villages comme
Malaucène ou Mazan qui protestent. Des transactions sur les droits
seigneuriaux interviennent à Saint-Pierre-de-Vassols, Malaucène
et Beaumes [33].
Nos papes distribuent, moyennant finance, des titres de noblesse : Crillon
devient Duché (1725), tout comme Beaumes (1775). Cette dernière
seigneurie était une baronnie depuis le Haut Moyen Âge. Aubignan
a été promu, et oui, au titre de marquisat, en 1667. Tout
cela est à titre honorifique et n'ajoute aucun nouveau droit [33].
Sur 130 villes ou villages ou châteaux du Comtat, 20 sont des fiefs
directs du Saint-Siège, les autres ont un seigneur ou des co-seigneurs
; certains seigneurs sont des ecclésiastiques ou des abbayes comme
celle de Cluny pour Sarrians. Serres est un fief de Carpentras depuis bien
longtemps (1564) [33].
Vu le chiffre de certaines populations, des conseils municipaux sont supprimés
: c'est le cas de celui de Modène en 1761 et de celui de Crillon
en 1775 [33].
Qu'en est-il de Caromb ?
Nous réceptionnons notre seigneur en novembre 1729 et nous tirons
les boëttes.
Nous avons vu que de nombreux procès ont opposé la communauté
à ses seigneurs et que tous leurs anciens privilèges ont
été contestés.
Pourtant, pour la première réception, à Caromb de M.
le marquis de Montrevel, de son épouse et de son fils, la communauté
offre un tonneau de 6 à 7 barraux (37 litres) de vin vieux, 12 pains
de sucre, 12 boites de confitures, 12 livres de cire blanche pour les flambeaux
de la table et dédommage la compagnie de soldats qui les accompagne
(juin 1732).
Charles Antoine a deux fils, Esprit Melchior, né en 1735 et Charles
Ferdinand François, né en 1736. Ils héritent du patrimoine
de leurs parents en 1736.
Nos co-seigneurs de la Baume-Montrevel portent le titre de marquis de Saint-Martin
et sont associés à de grandes familles : de Poitiers, de
Rye, de Bourbon. Ces familles n’ayant que des filles, ils voient là
une occasion de redorer leur blason.
Charles Ferdinand François conteste à la maison de Rye de Poitiers,
qui s’est éteinte dans plusieurs branches, les biens de la dite maison,
en se rapportant pour cela à un testament de Ferdinand de Rye, archevêque
de Besançon. Le Parlement de Paris juge que la substitution a pris
fin par le défaut de mâle de la maison de Poitiers et que les
biens sont libres dans la personne du dernier de ses éléments,
à savoir Ferdinand Joseph, son beau-frère, issu du second
lit ( de Françoise d’Angluse) [39].
Ferdinand Joseph est marié à Marie Henriette Gertrude de Bourbon
Malaufe qui lui donne une fille. Cette dernière se marie à
Gui Michel de Durfort de Lorges, duc de Randan, à qui elle apporte
en dot les biens des maisons de Rye, de Poitiers et d’Angluse [39].
Esprit Melchior et Charles Ferdinand François conservent leur titre
de marquis de Saint-Martin. En comparaison, la branche principale, celle
des comtes de Montrevel est immensément riche : écoutons ce
qu’en dit Alphonse de Lamartine (*62
) : « Il y avait à Mâcon,
avant la Révolution, une maison de haute noblesse qui dominait tout
et qui égalait le luxe des princes : le comte de Montrevel, qui n’allait
jamais à la cour et qui mangeait 600.000 livres de rentes. Il avait
une écurie de cent chevaux de chasse, un théâtre et
une musique à sa solde qui rivalisait avec la musique des Condé
de Chantilly ».
Nos marquis de Saint-Martin sont loin
d’avoir ce même niveau de vie.
L'utilisation de l'eau de la commune est réglementée
[33] :
- - interdiction de faire des
prises d'eau sur l'Auzon, sauf pour la construction des maisons et des remparts.
- - interdiction de prendre de
l'eau pour arroser prés et défends dans la rivière au-dessus
du village (en amont), de la Pentecôte à la Saint Michel, mais
cela est permis en aval, et vice-versa, sauf le samedi.
- - interdiction de prendre des
lauzes sur les rives, les canaux, les fossés.
- - paiement d'un loyer pour le
passage des eaux d'arrosage sur le terrain d'autrui.
Si l'on s'éloigne un peu de Caromb, on constate que l'agriculture
est très dépendante de la situation politique : la lutte douanière
entre la France et les Etats pontificaux a repris de plus belle. La France
attaque d'abord la soie du Comtat, peu chère, qui concurrence de trop
celle de Lyon. Arrêts et édits sont promulgués [33].
C'est mal connaître nos comtadins qui organisent une contrebande à
grande échelle.
Le roi, par le concordat du 11 mars 1734, s'attaque à la culture du
tabac et, à la suite d'un sévère blocus douanier, la
fabrication d'indiennes est interdite. D’étroites mesures protectionnistes
françaises pénalisent fortement la production des teinturiers
avignonnais en faveur des villes françaises voisines comme Orange,
Nîmes ou Lyon. L'accord douanier prévoit un dédommagement
de 230.000 livres par an en faveur de l'administration pontificale [33].
Les douaniers français persistent sur la soie et cette industrie disparaît.
De même, malgré une contrebande effrénée, l'industrie
des cartes à jouer disparaît. Et encore, celle de la poudre
car la France passe un accord d'achat du salpêtre [33].
Les comtadins réagissent par un mécontentement général,
devant l'augmentation du chômage, les indemnités françaises
dont peu de personnes “ne voit la couleur”, sauf l'administration du pape
et l'affaire des monnaies du Comtat que le roi ne reconnaît plus.
Comprenant qu’il faut demander l’argent de la répartition du tabac,
car cet argent est affecté aux communes qui en ont le plus besoin,
le conseil se plaint, en juin 1741, qu’il faut réparer les moulins
et acheter des meules. Le vice-légat attribue 1.500 livres au trésorier
de Caromb. Cette somme permet d’acheter les meules et aussi de réparer
le chemin de Carpentras qui en a bien besoin, pour un coût de 1.200
livres (mai 1752). En juin 1746, la ville obtient encore 1.000 livres sur
la répartition du tabac.
En Comtat, un parti pro-français se développe face à
un avenir incertain et devant une ruine économique prévisible
[33].
Fraude électorale.
Nous sommes en mai 1734 et comme toujours à pareille époque
de l’année, c’est un temps d’élection : consuls, conseillers,
procureur, … Mais cette année là, les choses ne se passent
pas aussi tranquillement que d’habitude. On constate que la boîte
à ballottes a été ouverte et que l’on a enlevé
non pas un ou deux noms, mais 21 noms sur 24 ! Carrément ! Les tricheurs
n’y sont pas allés de main morte. Il faut prendre des mesures et la
boîte est vite équipée de deux clés que l’on confie
au viguier et au 1er consul. La méfiance, lors des élections,
deviendra permanente.
La poste.
Vu l’importance du courrier vers l’extérieur (sûrement pour
communiquer avec le vice-légat, vu le nombre de ses interventions),
la communauté organise son service des postes et se pourvoit d’un porteur
de messages, salarié communal. En 1758, le porteur de lettres à
Carpentras sera augmenté à 42 livres par an, à condition
d’aller prendre les lettres à Carpentras le dimanche et le jeudi.
Le «centre de tri» est à Avignon où le courrier
est dirigé soit vers la France, soit vers Rome [33].
Nouveaux impôts.
La commune est toujours endettée. La taille étant déjà
élevée, à 4 deniers par florin, et le capage étant
à 3 livres par chef de famille, on crée un impôt nouveau,
une première “Contribution Sociale Généralisée”
à priori sur le bétail, mais qui touche tout le monde :
- - pour une vache, 3 livres,
- - pour un bœuf, une jument,
un cheval, un mulet, 1 livre 10 sols
- - la bourrique et l’âne,
20 sols,
- et ceux qui n’ont pas
de bétail, 20 sols.
Le paiement des impôts n’a jamais été le point fort
du village : en mai 1736, nous devons toujours le fastigage du gouvernement.
Un marquis de Rufulini, colonel de la compagnie de chevaux légers
réclame l’argent. Un généreux prêteur avance l’argent
pour un mois, pour calmer ce noble percepteur.
Par ailleurs Caromb se défend contre toute tentative de nouvelle imposition
: lorsque le vice-légat réclame une imposition de 6 livres
sur chaque saumée cultivée au Paty, afin, dit cet écologiste
avant l’heure, de sauver le bois devenu rare, le conseil refuse, arguant
que cette mesure frappe les plus pauvres (1737).
La communauté
de la Sainte-Famille (
*63
) .
Monseigneur d'Inguimbert décide de donner à la pieuse communauté
de la Sainte-Famille de Caromb sa force définitive par l'érection
canonique. Le 28 janvier 1736, il vient à Caromb proposer aux religieuses
un règlement. C'est de l'étonnement, puis une opposition
presque générale. Il y a dans le village un remuement de la
part des habitants. Tous crient à la nouveauté et chacun à
sa façon cherche les moyens pour détruire et anéantir
le projet épiscopal. Les uns demandent d'assembler un double et un
triple conseil de ville pour former des oppositions, d'autres roulent une
partie de la nuit dans la ville et vont de maison en maison pour dissuader
les bien intentionnés ou pour s'attirer les suffrages. Il y en a qui
veulent faire murer les portes de communications avec l'hôpital et
faire sonner le tocsin ! L'habile prélat laisse passer l'orage et
vient le 2 mars 1736 à Caromb où l'érection se passe
dans le calme. La nouvelle communauté est pleine de ferveur et s'intègre,
le 16 mai 1740, à la grande communauté des sœurs augustines.
A Caromb, la fraternité des sœurs est merveilleuse bien que le milieu
soit très mélangé. On voit à coté des
enfants du peuple, les noms les plus aristocratiques de la contrée
; mais l'union est parfaite car toutes ne veulent être et ne sont que
les enfants de Dieu et les servantes des pauvres. Point de privilège,
les charges sont données sans distinction d'origine. Elles considèrent
les malades comme les seigneurs de la maison.
Mademoiselle Blandine du Barroux est
nommée supérieure pour 3 ans, avec, pour assistante, Magdeleine
de Villeneuve de Grandis, pour dépositaire, Marianne Durand et enfin
M. le curé Curnier est directeur de la communauté [39].
Quelques mois plus tard, le couvent accueille de nouvelles adeptes : Marie-Louise
Thiers, Marguerite Lombard, Jeanne de Camaret, toutes trois de Caromb,
Pierre Pascale de Bernard de Pont-St-Esprit, Thérèse de Malatras
de Monteux et Marianne Neyras de Malemort. D'Inguimbert fait rentrer Marie
Françoise Eydoux en 1742, puis une parente, Elisabeth d'Inguimbert
[39].
Sur ces entrefaites, il se passe un fait qui trouble le directeur Curnier
: les deux sœurs de Villeneuve demandent une dispense pour aller recueillir
l'héritage de leur frère décédé. Craignant
que cet exemple soit suivi par d'autres, l'affaire est soumise à
Mgr l'évêque et au dominicain Gauthier et ceux-ci refusent de
signer la dispense. Pour éviter, à l'avenir, de tels problèmes,
ils décident de lier le couvent à un ordre religieux.
Les premières démarches de Mgr Guyon de Crochans n'aboutissent
pas. Les trois complices s'adressent alors à Mgr Suarez, archevêque
d'Arles. Cette fois les pourparlers aboutissent et l'archevêque dépêche
à Caromb son frère l'abbé Suarez, les deux sœurs fondatrices
du couvent d'Arles, sœur de Francony et sœur de Marteau, ainsi qu'une tourière,
avec Charles François de Pélissier, grand vicaire, l'abbé
Surian, l'abbé Esbérand, son secrétaire, M. le Promoteur
et deux aumôniers[39].
Tout ce beau monde arrive à la porte de la ville le 12 janvier 1739,
à 10 heures du matin, dans deux carrosses et la chaise à
porteur de Mgr d'Inguimbert. La cérémonie se déroule
suivant l'usage et quelques personnes de la localité sont admises
à y assister, notamment M. d'Olivier. La sœur de Francony est nommée
maîtresse supérieure, avec, pour assistante, la sœur de Marteau
promue Maîtresse des Novices.
Ainsi ce monastère passe dans l'ordre des Augustines. On l'appelle
"la Sainte Famille des Augustines Hospitalières" ( le 12 janvier 1739).
Cet ordre, qui existe depuis le XVIIe
siècle et qui fut créé à Tours par l'abbé
Pasquet Bouray, porte la robe de bure blanche avec manteau et voile noirs.
L'ordre carombais compte alors quatorze sœurs, mais bientôt arrivent
de nouvelles adeptes.
Un an plus tard, l'ordre étant définitivement constitué,
la sœur de Francony s'en retourne à Arles, remplacée par
sœur de Marteau avec Marie Anne Durand comme sous-prieure et Blandine du
Barroux comme Maîtresse des Novices.
Quatre ans plus tard c'est au tour
de Blandine du Barroux qui revient une deuxième fois à la direction
de ce petit monde [39].
Cependant M. Curnier note que l'on meurt trop jeune dans ce monastère
et s'en inquiète. L'abbé Sage a publié la longue liste
des décès de cet ordre :
1742 Marguerite LOMBARD
- 20 ans
1742 Marie Françoise EYDOUX
- 31 ans
1743 Elisabeth d'INGUIMBERT -
22 ans
1746 Marie Magdeleine ROUSTAN
- 27 ans
1747 Marianne NEYRON - 36 ans
1747 Marie de GUERNES - 25 ans
1747 Jeanne Françoise de
CAMARET - 29 ans
1750 Claire CONIL - 21 ans
1750 Françoise de BERGIN
de BEAUCLOS - 31 ans
1754 Claire Magdeleine de GUERNES
- 28 ans
- ici manquent les années
de 1751 à 1760 -
1760 Louise THIERS - 61 ans
1760 Thérèse JULIEN
- 23 ans
1761 Marguerite de COTTIER - 32
ans
1761 Barbe de GEORGES de GUILLAUMONT
- 18 ans
1761 Elisabeth de BEAUMONT de
MONTEUX
1763 Marie-Anne DURAND - 57 ans
1762 Thérèse DURRE
des BEAUMETTES - 34 ans
Une liste édifiante !
On consulte M. Bertrand qui a soigné ces malades, l'apothicaire Renaud
et les chirurgiens MM. Pons et fils. Ni les uns, ni les autres, ne peuvent
déterminer la cause du mal et ils l'attribuent à l'exiguïté
des appartements des sœurs par rapport au nombre de pensionnaires. Il faudrait
agrandir les pièces[39].
Les dames religieuses du monastère de la Sainte-Famille, hospitalières
de Caromb, ont acquis une maison et une cour à la Grande Rue Basse
qui communiquent avec leur monastère par un corridor traversant
la rue. Comme la cour joint les murs de la ville côté levant
et que les religieuses veulent se cloîtrer à l'abri des insultes,
elles demandent à fermer une porte de chaque côté de
leur maison et à ouvrir des portes dans les remparts [58]. La permission
est accordée le 11 janvier 1759, à condition de fermer les
remparts par une porte à deux serrures.
Mgr d'Inguimbert, qui aime beaucoup la petite communauté de Caromb,
trouve que les religieuses sont en effet mal logées dans leur étroite
maison et constate que la mortalité y est grande. D'où l'idée
de transporter la communauté à Carpentras et de l'établir
dans l'hospice qu'il fait construire à ce moment là. Il meurt
avant la fin de la construction, le 6 septembre 1755, laissant la somme
nécessaire pour terminer ce bel édifice. Son successeur, Mgr
Joseph de Vignoli, vient plusieurs fois visiter les religieuses, souhaitant
à son tour, leur transfert à Carpentras. Mais l'abbé
Curnier, fondateur de l'ordre s'y oppose. Il faut attendre son décès,
le 20 mars 1764, pour que Mgr de Vignoli relance les pourparlers.
Le 21 juillet suivant, un acte est passé entre les notaires Barjavel,
Devillario et Duchêne de Carpentras et Maurice Jérôme
Durand, délégué de Caromb, pour le transfert de quatre
religieuses de Caromb à Carpentras. Quatre jours auparavant, le 17
juillet 1764, les religieuses sont rassemblées en chapitre et désignent
les sœurs du Barroux, P.P. de Bernard, Marie Malachie de St Véran
(nièce de Mgr d'Inguimbert) et N. de Trouillet. Puis elles en désignent
cinq autres pour les assister : les sœurs Veranne de Trouillet, Louise de
Guillaumont, Anna Anasthasie de Florans, Barbe Bihane de Guilhaumont et Thérèse
de Brémond. Les quatre premières arrivent à Carpentras
le 21 juillet, les autres deux jours après. Sœur du Barroux
conserve ses fonctions de Supérieure [39].
M. Curnier, par testament, a donné son héritage, constitué
de capitaux, de propriétés et d'une maison, à l'hospice
et au couvent de Caromb. Les terres sont vendues à des particuliers
ainsi que la maison, aux Ursulines. Le tout rapporte 30.000 livres auxquels
il faut ajouter 14.000 livres données par une dame charitable avant
de mourir [39].
Plusieurs séances du conseil sont consacrées à cette
affaire : vives protestations du conseil à cause des exigences supplémentaires
de l'évêque qui demande une chambre à trois lits, une
infirmière, un réfectoire pour les religieuses nouvelles
qu'il a fait venir de Paris ; défection du vice-légat qui
avait d'abord promis sa médiation. Le conseil, «à ballottes
secrètes», consent à une transaction avec dédommagement
de 3.000 livres, et donne une partie de l'ancien monastère des dames
religieuses, puis réunit les capitaux de l'ancienne Charité
avec ceux de l'hôpital [58].
Non seulement les sœurs sont parties, mais elles ont emporté leurs
revenus et l'héritage de M. Curnier. La commission de l'hospice s'inquiète
de cette situation et délègue trois personnes, MM. Ambroise
Gaudibert, vicaire perpétuel de Caromb, M. Curnier, premier consul
et Joseph Maurice de Camaret, membre du conseil, pour aller réclamer
la somme emportée, propriété incontestable de l'hospice
de Caromb, à l'évêque Mgr de Vignoli [39].
Ce dernier, tout en reconnaissant
le bien fondé de la réclamation, refuse de restituer la somme,
mais propose de restituer mille écus de capital. Les délégués
font part du résultat de leur entrevue au conseil de l'hospice qui
estime la proposition inacceptable. Les délégués, reçus
une deuxième fois par l'évêque, n'obtiennent rien de
plus[39].
Dans le village tout le monde est choqué par une telle attitude, si
peu conforme à l'image que l'on se fait d'un évêque et
de ses principes religieux.
Y a-t-il procès ? On ne
le sait pas, mais l'hospice doit se contenter de la somme proposée.
La communauté de la Sainte-Famille était née à
Caromb en 1683 et elle y avait grandi. Caromb y est attaché, et
les sœurs aussi sont attachées à Caromb. La séparation
après 81 ans ne se fait pas sans peine. L'hôpital, ce modeste
hôpital, témoin des premiers et touchants essais de la charitable
communauté, se trouve vide de ses religieuses et sans ressources.
Les religieuses gagnent assurément à ce changement, car elles
échangent une maison étroite et malsaine pour un magnifique
palais, mais Caromb y perd. Pendant 25 ans la vie de la communauté
dans le couvent de l'hôpital de Carpentras est tranquille et prospère
[55]. La communauté traîne tant bien que mal jusqu'à la
Révolution.
L’affaire
de St Hippolyte.
De 1740 à 1743, une affaire avec St Hippolyte ramène des procès.
On vient juste de terminer un procès au sujet de la résidence
du curé de St Hippolyte, pour lequel les populations de Caromb et
de St Hippolyte étaient solidaires, lorsque démarre un autre
procès, contre le prieur de St Hippolyte cette fois, afin de le remplacer
par un vrai curé. Ce "cumulard" de postes ecclésiastiques
est chanoine de St Siffrein à Carpentras, prieur de St Hippolyte
et de la Roque-Alric. Il a la mauvaise idée de réclamer aux
habitants de St Hippolyte de payer la dîme sur le blé, le seigle,
les légumes, l’huile, le vin, le foin, les noix, les amandes, les
feuilles de mûrier, le safran, les jardins, les arbres fruitiers, les
abeilles, la laine de mouton, les fromages, bref sur tout ce qui rapporte
quelques sous. Caromb, sentant le danger pour ses propres revenus, déclare
que St Hippolyte est un fief séparé, ayant son propre seigneur
et ses propres officiers.
Les quelques Carombais qui ont des terres à St-Hippolyte n’apprécient
pas, protestent sur ce “lâchage”, demandent que Caromb prenne
fait et cause contre la nouvelle tyrannie du prieur et rappellent la récente
solidarité qui unissait les deux communautés pour demander
un vrai curé.
Rien n’y fait : le conseil refuse
sous prétexte qu’un contentieux existe encore au sujet des bestiaux
de St Hippolyte et des dégâts non réparés sur le
terroir du village. On débute un procès, puis on préfère
discuter des indemnités que Caromb pourrait recevoir, en échange
de sa solidarité.
Quelques-uns, de St Hippolyte, ne sont pas d’accord. Une réunion commune
avec une délégation de St Hippolyte, mais sans les “malfaiteurs”,
permet de s’entendre. Les réclamations du prieur doivent rester lettre
morte.
Quatre ans plus tard, la Sacrée
Congrégation de la cour de Rome décide que le vicaire
de Caromb administrera les St Sacrements à St-Hippolyte.
En août 1738, on envoie une députation à l’évêque
de Carpentras pour protester de la nullité d’un décret de
1725 qui supprimait la procession annuelle de Caromb à St Hippolyte
et qui était l’occasion d’un bon repas payé par le prieur aux
consuls en chaperon, au conseil, au viguier, aux prêtres agrégés
et aux officiers du seigneur. Le conseil n’a pas été consulté
lorsque cette décision a été prise et cela vaut nullité.
Un autre contentieux est réglé, celui du salaire contesté
du vicaire : il recevra pour salaire ce qui était payé pour
les repas du prieur.
Les relations avec St-Pierre-de-Vassols ne sont pas au beau fixe non plus,
à cause de quelques propriétaires carombais qui ont des terres
dans cette commune.
Le 4 février 1726, les Falque de la Tuilière « partent
pour Beaumont trouver au château leur seigneur Messire Frédéric-Eugène,
Comte de la Beaume, Baron de Caromb, Saint-Hippolyte et autres lieux »,
au sujet des eaux de la Tuilière.
En 1722, le notaire carombais s'appelle Reynaud [148]
Travaux au
clocher et dans l'église.
On décide de faire voûter le clocher, d’élever ses murailles
en forme de tour avec créneaux de pierres de taille, plutôt
que de le couvrir d’un toit comme un grenier à foin. Côté
finance, on dispose de 500 livres, sans intérêt, prêtées
par le vicaire et on prévoit le remboursement de cette somme par
une imposition sur l’utilisation des cloches : laïcs ou ecclésiastiques
utilisateurs des cloches paieront : 30 sols pour la grosse cloche, 20 sols
pour la vieille. Le budget prévisionnel laisse penser qu’on aura
un surplus d’argent. On pourra l’employer pour faire une croix et six chandeliers
en argent pour le maître-autel (1739).
Le vicaire bailleur de fonds demande que les murailles soient élevées
de trois pans afin de surélever les cloches dont le son se brise
contre les murailles du château plus élevées et ne parvient
pas aux fidèles qui trouvent là une excuse pour aller au cabaret
plutôt qu’aux offices. Le clergé ne perd pas une occasion de
rappeler ses troupes !
Trois ans plus tard, suite à une visite pastorale de l’évêque
de Carpentras, il est décidé de paver à neuf l’église
et d’y établir des caveaux décents, pour un coût de
4.000 livres. On en profite pour refaire les bannières de St Roch
et de St Maurice.
En 1752, sur insistance de l’évêque, on répare la “bardaison”
du dallage de l’église. La dépense sera couverte par les
droits de sépulture dans l’église : 30 sols roy pour les grandes
personnes et 15 pour les enfants. Les indigents vont au cimetière,
gratuitement. On entreprend les travaux sur des plans dessinés par
un architecte de Carpentras : terre et ossements sont retirés du sous-sol
de l’église et transportés soit au cimetière, où
une bande de terre d’une canne de large a été prévue
le long du mur d’enceinte, soit au-dessous de celui-ci, dans le chemin de
Carpentras.
Deux ans plus tard, les habitants protestent que 14 caveaux sont insuffisants
sous les dalles de l’église puisque l’on compte environ 100 morts
par an à Caromb. Il suffirait d’avoir l’autorisation de l’évêque
pour agrandir, en transportant la terre de l’église dans les champs.
La guerre
de succession d’Autriche (1742-48).
La mort de l’empereur d’Autriche, en 1740, déclenche une nouvelle
guerre de succession. Les rois de France, de Prusse, d’Espagne, de Naples,
de Pologne et de Sardaigne réclament, en totalité ou partiellement,
l’héritage de l’empereur [72].
Les troupes franco-espagnoles, appelées les "Gallispans", s’opposent
aux Anglo-Sardes. Louis XV, roi de France, déclare la guerre
aux Sardes, qui, à nouveau, envahissent la Provence, en décembre
1746.
La France est d’abord battue et refoulée jusqu’à Fréjus.
Les troupes françaises arrivent dans le Comtat et prennent leurs
quartiers. Un commissionnaire des fourrages pour les troupes conseille, par
lettre confidentielle à nos consuls, d’éviter le logement d’un
escadron en fournissant du fourrage. Chacun, sauf les pauvres, fournit une
charge de foin ( mars 1747).
Comme toujours pendant les guerres,
il faut de l’argent. Le général de l’armée de Provence
réclame un emprunt à répartir entre nos villages en
fonction de leur importance (avril).
La situation s’améliore pour la France grâce à
une révolte de Gênes et les sardes se replient.
Caromb doit encore fournir chevaux et charrettes pour le transport
des troupes passant à Carpentras. Le conseil préfère
louer tout cela à Carpentras.
Pendant la guerre, puis jusqu’en 1750, les prix augmentent et le conseil
doit les ajuster pour suivre l’inflation : un jour de voyage pour un de ses
délégués est payé 4 livres 10 sols au lieu de
3 livres. Le prix du sel est augmenté de 6%.
Le traité d'Aix-la-Chapelle met un point final aux guerres, en 1748.
Les Français évacuent. Marie-Thérèse d’Autriche
garde son empire, sans la Lombardie. La paix s’installe, pour longtemps.

