
|
Chapitre VI.
L’entre-deux-guerres (1918-1939).
Emigrations
Défense des
frontières et construction de fortifications.
Travaux hydro-électriques.
Emigrations
En 1917, il faut des “bras” en France. Un office du travail est créé,
qui passe des accords avec l’Italie. Les industriels des houillères
du Nord, des soieries de Lyon “importent” des italiens par trains entiers.
Ils reviennent, dès l’armistice signé, poussés par
la crise de 1920-21, puis par l’avènement du fascisme. Ils sont
jeunes et, parmi eux, un tiers sont des femmes. Cet afflux d’italiens ne
met pas fin à la mobilité des métiers : enfourneur
dans les tuileries et briqueteurs, tailleur de pavé, de rebords
de trottoir ou de monuments funéraires dans les exploitations de
granit et de quartz, mais surtout travailleurs dans le bâtiment.
Les maçons italiens se dispersent dans tout le pays.
En 1919, mes grand-parents paternels émigrent de Bellino à
Caromb, Vaucluse.
L’après-guerre apporte une prospérité considérable
et le tourisme se développe. On construit des hôtels jusqu’au
fond des vallées. En Ubaye, St Paul et Jausiers construisent les
leurs. L’alpinisme se développe. [66]
Entre les deux guerres, l’économie savoyarde se porte bien : les
usines sont en plein développement, le tourisme croit, d’abord par
les étrangers jusqu’en 1930, puis par les français. Le chemin
de fer arrive à Bourg St Maurice, en 1919.
Les agriculteurs italiens colonisent tout le Sud Ouest, venant de Toscane,
d’Ombre, du Foiral et du Trentinois, compensant l’exode rural. Vers 1930,
ils sont 100.000, au deux tiers en haute Garonne, et dans le Gers, coulés
au sein d’une paysannerie qui n’en comptait aucun avant 1920.
Aprés la guerre, en 1921, les étrangers sont 1,55 Millions
en France, compensant les 1,4 Millions de morts de 14-18. 38% sont italiens.
A Grasse, la parfumerie se porte bien : 20 grosses usines traitent la
production régionale de fleurs. 4500 producteurs vivent des fleurs,
près de 900 hectares sont cultivés. Les italiens viennent
aider pour les récoltes.
L’année 1921 marque le début du fascisme en Italie, avec
l’arrivée de 25 députés et leur participation au gouvernement.
En 1922, ils organisent une marche sur Rome de 30.000 participants, et
Victor Emmanuel III doit appeler le “Duce” Benito Mussolini à former
le gouvernement. En 1924, ils modifient la loi électorale et obtiennent
une majorité écrasante au Parlement. Ils utilisent la terreur
contre l’opposition, et parfois même, les assassinats. En 25/26,
ils abolissent les partis politiques et les syndicats et la dictature devient
totale.
Avec de telles conditions politiques, l’émigration vers la France
continue : en 1927, 70% des 45.000 mineurs lorrains sont italiens. Dans
le Nord Est, où la reconstruction des houillères endommagées
par la guerre et le développement de la sidérurgie leur
ouvrent une voie royale, ils sont 100.000 en 1931.
La crise économique de 1929/30,
crise mondiale, n’arrange pas les choses. Elle pousse Mussolini a s’aligner
sur l’Allemagne. Elle a pour conséquence des réactions xénophobes
en France : la haine de l’étranger affecte tous les milieux, même
le monde ouvrier où des travailleurs belges, italiens, marocains
et polonais sont assassinés. Des restrictions à l’immigration
sont demandées, aussi bien à droite qu’à gauche. On
fixe des quotas, on chasse les clandestins, on fait signer des demandes de
rapatriement. En 1931, les pouvoirs publics français stoppent l’immigration,
renforcent le contrôle aux frontières et encouragent les “étrangers”
à repartir : ils sont alors 2,9 Millions, soit 7% de la population,
installés surtout avant 1926, dont 800.000 italiens.
En 1936 il y a plus de 10% “d’étrangers” dans les départements
du Sud-est : Bouches du Rhône, Var, Alpes maritimes, Basses Alpes
et Savoie. Ils représentent plus de 5% de la population des Hautes-Alpes.
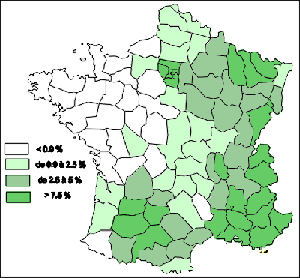
Pourcentage d'italiens en France en 1936
par rapport à la population totale.
Défense des frontières
et construction de fortifications :
Entre 1931 et 1940 les armées de Mussolini consolident les défenses
alpines et construisent un grand nombre de fortifications, fortins ou blockhaus
jusqu’au fond de nos vallées. A Bellino, elles sont nombreuses :
Bosco di Ceiol, Buc des Sparviers, Buc Faraut, Coletto Balma, Grange Cruset,
Grange Malbuiset, Piatto Rosso, Rocca Senghi, Torrente Bruient, Varaita del
Rui. Toutes nos vallées sont protégées contre une éventuelle
invasion française. Il en est de même à Pontechianale
: Costa Buscet, Grange del Petegran, Pian dell’Agnello, Pian Vasserot,
Pontechianale, Pra Giusna, Sela. Les fortifications de Casteldelfino sont
elles aussi très nombreuses et constituent une ligne d'arrêt
pour une invasion française : Bertines, Monre Morfreid, Ponte Nuovo.
Les chemins sont empierrés pour faciliter l’accès aux cols,
parfois jusqu’à des altitudes impensables. Les débouchés
des vallées sont protégées par des postes bien placés
: c’est le cas par exemple pour les blockhaus du plan de Ceiol, ou pour
le fort caché près de la roche Senghi qui surplombe le fond
de la vallée de Bellino et qui devait empêcher une invasion
venant du col de l’Autaret, ou de la vallée de Ruy. Les crêtes
accessibles sont équipés de fil de fer barbelé,
barbelés que l’on retrouve encore de nos jours sur les sommets.
Ces travaux servaient aussi d’entraînement intensif pour les troupes
de Mussolini.
Travaux hydro-électriques.
Entre 1936 et 1942, d’importants travaux hydro-électriques transforment
la haute vallée Varaita. A Castello, une digue haute
de 75 m. et d’une longueur de 247 m. est construite et retient l’eau de la
Varaita de Chianale. Quelques maisons disparaissent sous les eaux, les près
les plus faciles d’accès sont inondés et se forme le lac
de Pontechianale.
L’eau du torrent Varaita de Bellino est détournée de son cours
ancestral par une galerie de 4.482 m. qui passe sous la montagne de la Battagliola
et vient alimenter ce nouveau lac. A partir de Prafauchier jusqu’à
Casteldelfino, le torrent a disparu et n’est plus qu’un filet d’eau.
|
 La centrale de
Casteldelfino
La centrale de
Casteldelfino
|
Une galerie souterraine de 2.600 mètres
et une conduite forcée amène l’eau de Castello à
la centrale de Casteldelfino où les turbines produisent de l’électricité
depuis 1939. Le débit varie de 3 à 40 m3/seconde.
Plus bas dans la vallée, la centrale
de Sampeyre est construite en 1941, celle de Venasque en 1943 et, au total,
plus de 32 km de galeries conduisent les eaux vers ces centrales.
Suite
©
Copyright JG
|
|



