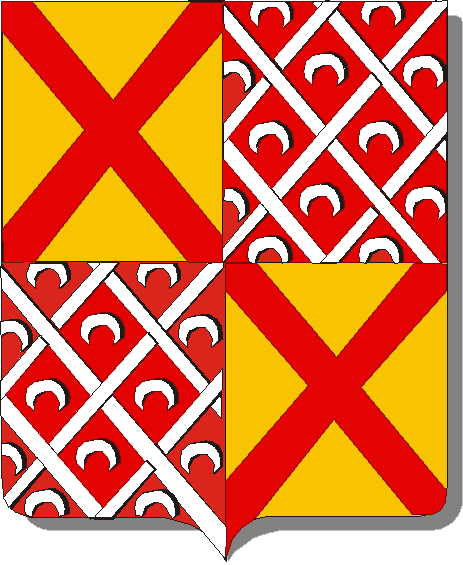Claude de Gerente (Taulignan, Pernes)
épouse Marguerite de Maulsang vers 1510.
 Généalogie
Généalogie

Page 1a : les origines, sg de Sénas
Page
1b : baron puis marquis de Sénas, marquis d'Orgeval
Page
2a : branche des marquis de la Bruyère à Avignon
et à Marseille.
Page
2b : branche des sg de Vénelles, de Jarente-Andréa
Page
3a : branche des barons de Monclar en Provence
Page 3b : branche
de Pernes et de Taulignan, d'où les Sainte-Marie de Jarente.
Familles associées
: Maulsang, Allamanon, Fabricii, Pontevez (Lambesc,
Cabannes), Guiramand, Isnard, Glandevez, Lascaris-Tende, des Rollands,
Sade, Agoult (-Mouriès, -Ollières, -Seillon)), Puget,
Castellane (-Esparon, -Entrecasteaux), Albertas, Mark, Bermond de Bouzène,
Vintimille, du Puy-Montbrun, L'Huilier, Montaigu (la Palud), Le Blanc,
Lallier-de-la-Tour, Maret, Cabassole, Merles, Féraud, des Rainauds,
Viarron, Fortia, Pol, Blégiers, Serres, Marguerit, Astres, Imbert,
Vivaud, Allègre, Escalis, Garnier, La Cépède,
Capel, Domergue, Bionneau, Andréa, Damian, Armand, Bausset, Villeneuve,
Baschi, Serres, Astoaud, Brassier
Fiefs : sg de
Montclar, Gémenos et Auriol, Carry et Rouët, Vênelles
(Marseille), marquis de Sénas, en Provence ; sg de Vauvenargues,
la Bruyère, Bras, Vrüe, Auriac, St-Estève, Lux,
Orgeval, Pierredon, Cabannes.
Dictionnaire véridique des origines des famlles nobles ou anoblies
de France.
Illustre et ancienne maison de chevalerie du comté de Provence,
et non pas de Bourgogne, comme l'insinue l'abbé Robert de Briançon,
sur ce qu'on voyait en 1105
le tombeau de l'abbé Jarento dans l'abbaye de Saint-Bénigne
à Dijon; cette maison florissait avant cette époque en
Provence. La Chenaye, sur un Mémoire de famille,
lui donne pour auteur Imbert de Châtillon-sur-Marne, gouverneur
de Damas, commandant en 1037 les troupes de Champagne. Son arrière-petit-fils,
Lantelme de Jarente,
baron de Montclar, assista aux états en 1352. On voit, par
conséquent, que les quatre premiers degrés de cette généalogie
renferment une période de 315 ans, ce qui est hors de toute vraisemblance
chronologique, parce qu'en matière de filiation, il est de principe
que trois degrés équivalent à l'espace d'un siècle.
On doit donc s'en tenir, pour l'origine de cetle maison , à reconnaître
la Provence pour son berceau, et rejeter, comme dénuée de
fondement, la tradition qui la fait descendre des anciens comtes de Châtillon-sur-Marne.
Dans le cartulaire des églises de Sisteron et d'Embrun, sous
l'an 1125 et l'an 1130, on voit Gérente de Gérente commandant
une compagnie de croisés.
Le moine Baudouin, dans l'histoire de cette croisade, rapporte que
Guillaume de Gérente se signala dans deux différents combats
que les croisés livrèrent aux infidèles ;
et l'on trouve encore plusieurs chevaliers de ce nom parmi ceux qui
signalèrent leur courage à la Terre-Sainte.
Cette maison a donné des ambassadeurs en diverses cours de
l'Europe, des chevaliers de l'ordre du roi avant l'institution de celui
du Saint-Esprit, des capitaines de cent hommes-d'armes, des gentilshommes
de la chambre, un maître-d'hôtel du roi René, gouverneur
de Jean d'Anjou en 1470, des officiers-généraux, des gouverneurs
de provinces et de places, des maîtres des requêtes, des conseillers-d'état,
etc., etc.
La seigneurie de Sénas
fut érigée en marquisat, par lettres-patentes du mois
de février 1643, registrées le 7 décembre suivant,
en faveur de Balthasard de Jarente,
IIIe du nom , et pour ses successeurs mâles et femelles.
Un évêque de Die en 1193. Thomas de Jarente fut élu
évêque de Grasse en 1382. Balthasard de Jarente fut archevêque
et prince d'Embrun, ambassadeur extraordinaire
à Rome, puis à Constantinople ; il testa en 1553, et
vivait encore en 1555 ; Louis Sextus de Jarente fut évêque
d'Orléans en 1758.
Manuscrit bibliothèque Avignon (Mr Lafonta )
Fol. 134. « Extraict de verbal faict par messire Louis Balthezard
de Jarente, seigneur deLaBruyere, Cabannes et autres lieux, viguier pour
nostre Sainct Pere le Pape en la ville d'Avignon. ..27 décembre
1676.
Les maintenues de noblesse en Provence, par Belleguise (1667-1669).
Cette famille est originaire de Provence, non de Bourgogne, d'où
l'auteur du nobiliaire la tire. Sur un monument de l'abbaye
de St Bénigne à Dijon, il dit qu'on y lit une épitaphe
de l'abbé Gérente, de 1105. Mais cet abbé, mort en Bourgogne,
pouvait bien
être originaire de Marseille, puisque je trouve la tige de sa famille
dans le XIe siècle. Les croisades de cette antiquité nous font
trou-
ver les plus anciens noms qui se sont conservés jusqu'à nous.
On enrégistrait le nom des croisés dans les cartulaires des
églises
métropolitaines et ils s'y assemblaient sous leur croix. On y lit
encore tous les chefs de bande qu'on choisissait dans la principale
noblesse, illustres pardes faits d'armes. Si nous n'avions les chartes des
croisades, il ne nous resterait presqu'aucune connaissance de
l'ancienne noblesse dans ces siècles d'ignorance, où il n'y
avait guère que les ecclésiastiques qui sussent écrire.
Nous avons le
moine Hédouin [?] qui a fait l'histoire des Croisades. Mais aussi
si elles ont fait connaître les anciennes familles, elles les ont rui-
nées. Les gentilshommes s'épuisaient pour se mettre en équipage
et pour avoir de l'argent pour d'aussi longs voyages. Plusieurs y
mouraient, ou de maladie ou par l'épée des infidèles.
Leurs veuves et leurs pupilles étaient la proie des plus forts. Ils
étaient dépouillés
de leurs fiefs, quelques uns même de leur souveraineté. J'ai
trouvé dans les cartulaires des églises de Sisteron et d'Embrun,
de 1125
et 1130, Jarente de Gérente commandant une compagnie des croisés.
Il est fait mention, dans l'histoire de cette croisade, par
le même Hédouin, que Guillaume de Gérente se signala
dans les combats contre les infidèles, que Jarente de Gérente
se distingua
dans un autre combat de la croisade et que, portant l'étendard de
la Ste Croix à la célèbre bataille de 1260, il eut une
apparition
divine dans le temps que l'armée se préparait au combat, qui
lui présagea la victoire que les croisés remportèrent
contre les turcs.
Que cette vision fût véritable ou non, elle encouragea les
siens, qui remportèrent une victoire signalée (1). Il me suffit
que je
puisse inférer de cette histoire ou de cette vision que la famille
de Gérente est de la principale noblesse de Provence, depuis cette
antiquité par le témoignage du moine Hédoin et par
les chartes de ce temps là.
Lantelme de Gérente fut député des états du
pays à la reine Jeanne, comtesse de Provence, pour lors en son royaume
de Naples,
pour la supplier de ne pas aliéner ses domaines, aux archives du
roi. Guigonet, son fils, fut pourvu par la reine Jeanne de l'office
de son maître rational en 1364 (2). Il fut député de
la communauté de Marseille, après la mort de Louis 1 d'Anjou,
comte de Provence,
à Louis II, son fils, aux archives de la ville de Marseille de l'an
1384. Il fut surnommé le grand Gérente par son éloquence
et
mérita de faire la proposition aux états généraux
assemblés à Aix en 1390, sous le règne de Louis II d'Anjou
et de Marie de Blois,
sa mère régente, au sujet des incursions du vicomte de Turenne,
qui ravageait la Provence, par sa rébellion contre Louis II, son
souverain seigneur. Il est qualifié baron de Monclar, maître
rational de la grande et superbe cour; il était aussi seigneur de Géme-
nos. Balthazar de Gérente, fils de Guigonet, sgr de Senas, assista
au traité de paix entre les Catalans, qui assiégeaient Marseille
et
les Marseillais, aux archives de la même ville, de 1431. Ce Balthazar
de Gérente, sgr de Monclar, porta la nouvelle au roi René,
prisonnier avec son fils en Lorraine, depuis sa défaite en la bataille
qu'il donna contre le comte de Vaudemont, de la mort de Jeanne
de Duras, reine de Naples, qui l'avait institué en 1435 (3). Jean
de Gérente assista à la confirmation des privilèges de
la ville de Mar-
seille par Charles d'Anjou, dernier comte de Provence, en 1480.
Balthazar de Gérente fut évêque de St Flour, ensuite
de Vence, après, archevêque d'Embrun. Il fut pourvu, en 1515,
de la charge
de premier président de la chambre des Comptes et de président
à la chambre rigoureuse, que nous appelons, aujourd'hui, juris-
diction de lieutenant de sénéchal des soumissions. Claude
de Gérente fut pourvu d'une charge de conseiller au parlement d'Aix
en 1534. François, son fils, fut président de la chambre rigoureuse,
emploi qu'avait exercé l'archevêque d'Embrun, son oncle. Il fut
ensuite pourvu d'un office de conseiller au parlement de Toulouse, en 1538.
L'évêque et le président furent condamnés à
une amende,
pour désobéissance à l'exécution de l'édit
de réformation de la justice en Provence par le roi François
I, l'an 1534. Les Gérente
d'aujourd'hui prennent leur filiation depuis Lantelme de Gérente,
qui descendait des anciens croisés, jusqu'à Charles de Gérente,
marquis de Senas, aujourd'hui chef d'une branche, et jusqu'à Jean-Baptiste
de Gérente, sgr de Venelles, chef de la branche habituée
à Marseille. Il s'en est formé une autre à Avignon,
qui n'est pas de mon sujet.
Celle de Marseille a subi des dérogeances. Les familles sont sujettes
à des maladies, comme le corps. Les vieux étant plus su-
jets aux infirmités que les jeunes ; les anciennes sont plus sujettes
aux déchéances que les récentes. Les esprits nobles d'une
famille,
qui coulent avec le sang, sont empêchés d'agir en quelques
uns des descendants, par la mauvaise conformation de leurs organes.
Il en est des familles nobles comme des rivières, qui roulent les
belles eaux de leurs sources. Cette eau claire s'embourbe, devient
trouble, sale et boueuse, en passant par des terrains boueux. Mais, d'abord
qu'elle est sortie des marécages, elle laisse la boue dans le
gravier par où elle coule et reprend la beauté qu'elle avait
à sa source, parce que c'est toujours la même eau, qui n'avait
été salie
que par accident. Les dérogeances font aux familles nobles ce que
les marécages font aux rivières. Lorsque ce sang noble passe
à une
personne vicieuse ou avilie par les infortunes, la famille en est obscurcie
et salie. Mais ce sang noble, passant à un autre sujet de
la même famille, qui a de l'honneur et de la vertu, il reprend son
état naturel et la noblesse de sa source. Un corps est toujours le
même, quoiqu'il ait été malade, lorsqu'il a repris la
santé.
Pour moi qui ai vu la plupart des actes des anciennes familles, ou par moi,
ou par mon père et mon aïeul (4), je n'en ai point
trouvé où je n'ai vu quelque déchéance, abaissement
ou dérogeance et des personnes d'une âme basse et avilie, qui
sont comme les
bourgeons à un visage. Les dérogeances, sous la première
et deuxième race de nos rois, ne changeaient rien à l'état
de l'ancienne
noblesse. Elles étaient comptées comme non avenues, lorsque
le gentilhomme, qui avait dérogé, avait quitté la fonction
dérogeante,
pour rétablir ses affaires. Il n'avait pas besoin de lettres de réhabilitation.
Elles ont été introduites pour avoir de l'argent et pour
maintenir davantage la puissance royale, moyen qui a donné lieu au
grand abus qui s'est glissé, dans ce siècle, par ceux qui s'en
sont servis pour devenir nobles d'origine ou de race, en impétrant
des lettres de réhabilitation avec des titres usurpés.
La famille de Gérente, qui m'a donné lieu de m'étendre
sur les dérogeances, n'en est pas moins noble, pour en avoir souffert.
Elle porte : d'or, au sautoir de gueules. Son sobriquet est : Subtilité
de Gérente.
# Cette notice sur les Jarente n'a d'autre intérêt que celui
de prouver l'identité textuelle entre la Critique et la Principale
Noblesse de Provence,
pour le hors d'œuvre concernant les croisades. Le lecteur comparera facilement
les deux textes et en tirera la conclusion. Ce ne sont pas,
d'ailleurs, les seuls passages qui sont reproduits mot pour mot. — Cf. Histoire
Véridique, p. 94 et 197, et Inv. des Arch. de Barbegal.
(1) Toute cette histoire ne signifie pas grand chose. Maynier place la vision
en 1260, Pithon-Curt (T. II, p. 143) la mentionne en 1098.
Il ne vaudrait pas la peine d'en faire état, si Maynier ne prétendait
avoir rencontré les Jarente dans des cartulaires de Sisteron
et d'Embrun, au xne siècle, et les chartes de ce temps là,
pure invention, qui doit mettre en garde contre ses autres affirmations,
tout aussi arbitraires.
(2) Lisez : 1380.
(3) Ce dernier détail paraît inexact. C'est Vital de Cabanes
qui rapporta au roi René les évènements de Naples. Voir
: Lecoy de la Marche,
le roi René, I, p. 112, et l'article Cabanes, ci-devant.
(4) Les erreurs grossières et sans nombre de la Critique démentent,
de la façon la plus formelle, la prétention de l'auteur d'avoir
eu
connaissance des actes des familles. Il vaut mieux pécher par ignorance
que par mauvaise foi. Et, si l'on veut être plutôt indulgent
pour Maynier, il est préférable d'admettre que ni lui, ni
son père, ni son aïeul n'ont jamais eu la moindre notion de la
véritable généalogie
des maisons provençales. Cette prétention n'est qu'une vantardise
pour impressionner le lecteur. Au cas contraire, on ne saurait trop flétrir
la bassesse de caractère de Maynier, falsifiant la vérité
et étalant son esprit de mensonge et de honteux dénigrement.
© JG 2015
 . . . .
. . . .