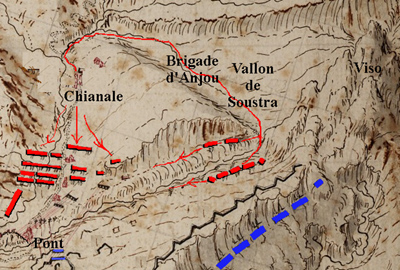| |
|
|
La campagne de 1743.
Les premières troupes
piémontaises dans les vallées.
" Le Roi fait monter des troupes dans nos vallées, entre
autres les régiments de Déespac et Keller suisses avec le bataillon
de Pignerol. Les premiers campèrent aux près de l’ubac de l'Église
de Pont et les autres s'arrêtèrent à Château Dauphin,
et ici à la Chanal on envoya les Vaudois au nombre de près
de deux mille hommes qui logèrent pour quelque temps tous dans les
maisons, ce qui causait une confusion la plus extraordinaire, on ne pouvait
point se remuer dans le pauvre village ; mais ce qui est le pire c'est que
ces gens accoutumées aux vols et aux butins d'autre fois commettaient
mille brigandages ; ils écorchaient les brebis, les moutons et autres
bêtes à la campagne et chargeaient nos pauvres bergers de coups…
Ils se servirent de toute sorte de ruse pour nous faire passer
pour rebelles auprès des commandants, … pour nous rendre haïssables
et pour nous faire passer pour des rebelles auprès des Piémontais,
qui ne nous ont jamais aimes, qui au contraire nous tiennent pour des traîtres,
pour des sujets infidèles [105] ".
…
Premiers travaux de défense.
" L'Espagnol s'avançant du côté de Barcelonnette
on croyait, qu'il tenterait le passage par col de Longet, et pour lui boucher
cette entrée l’ingénieur Arducis crût n'avoir d'autre
moyen plus propre que de faire enfler le lac qui est au dessus de l'Antoline,
et au dessous des portilloles sur les chemins de Maurin. Pour exécuter
ce vaste dessein, il fallut faire une muraille fort épaisse à
l'embouchure du lac entre les deux roches, au dessous du lac ; pour ce faire
il fallut une grande quantité d'ouvriers, on commanda donc depuis
Saluce jusqu'ici tous les travailleurs de campagne pour venir travailler à
cet ouvrage, et après de pénibles fatigues on vint à
arrêter l'eau qui fit enfler le lac jusqu'au milieu de la plaine qui
est au dessus, tirant vers le vallon de la Niere, et occupèrent le
chemin ordinaire qui conduit à Maurin ; mais y avait autre lieu à
passer, ou ne pouvait on pas facilement déboucher le lac, je me portai,
et j'examinai, le dessein et l'ouvrage, et je jugeai de son inutilité
dans mon cœur en l'applaudissant à Monsieur l'ingénieur : on
serait cependant passé plus commodément en faisant le tour
à main droit du lac, et en moins d'une heure rendus tous les travaux
inutiles. On fit voir a ce pauvre ingénieur que l'infanterie pourrait
facilement descendre par les herbes gorgé qui va aboutir au vallon
de la Niere.
Il ordonna qu'on fit un gros fossé au bout des herbes
passant d'un roc à l'autre, d'une largeur et profondeur considérable.
Plus de quatre cents travailleurs furent employés à ce grand
ouvrage, et en moins de huit jours les herbes furent coupées dans la
Niere. "

Col Longet ( 2649m )
" Pour fermer donc absolument l'entrée
aux Espagnols, qui trouvant le col de Longet bouché par le lac, et
par ces fosses insurmontables, auraient pu faire le tour et venir par le
col de l'Agnel, il porta toutes ses attentions de ce côté là
; faisant toujours redoubler le nombre des travailleurs, il se porta à
la tête de cette armée laborieuse au col de l'Agnel ; la première
des ses vues fût le pas du Crapon : il le fit couper ; les mines y
jouèrent pendant quatre ou cinq jours et on parvint à empêcher
le passage aux gens à cheval, et prévoyant qu'ils auraient pu
descendre par le col viel il ordonna qu'on y fit un fossé semblable
à celui des herbes. Il y avait encore le vallon de la Lauzette à
boucher après quoi nous allions être à l'abri de toute
incursion et insensiblement cette vallée allait devenir une citadelle
bien flanquée de bastions et de profondes fossés ; il y fait
faire les mêmes travaux et le tout fût fait presque dans le même
temps parce que la grande quantité du monde qu'on avait fait monter,
pouvait suffire à tout en la divisant comme on fit.

Haut vallon Vallanta.
Au bas de la pente : les vallées Varaita.
Nous voilà bien assurés, les travaux sont achevés,
on peut attendre l'ennemi de pied ferme. S'ils viennent par Longet, ils se
noient dans le lac ; si par les herbes, ils resteront dans le fossé
; si par l'Agnel, le chemin y est rendu impraticable ; enfin par la Lauzette,
outre qu'ils y trouvent un fossé, les Vaudois qui sont campés
au Patagon leur disputeront l'entrée avec valeur à moins, qu'à
leur ordinaire, ils ne décampent à la vue de l'ennemi, …
Il fallait se prémunir contre tout événement
c'est pourquoi les travaux de nos montagnes étaient réduits
à leur accomplissement ; Arducis jeta les yeux sur le Château
de Pont, ce roc lui parut inaccessible aux Espagnols, au cas que ces premières
fortifications étant forcées, on descendit plus bas, il y fait
encore travailler, il entoure le roc de moles, et de facines et y construit
à la fin un faible retranchement ; qu'on me dise après tout,
si on ne se plaisait pas à faire dépenser d'argent au Roi et
à mettre les habitants surnommés dans la dernière gêne
[105].
Lorsque tout fût achevé, et qu'on attendait de
jour en jour de voir échouer le dessein des Espagnols, par de mesures
si justement prises on eut avis qu'il allaient camper à Guillestre
et de là à Briançon. "
" L’avant-garde de cette armée partit pour se rendre
en Savoie, passant par le col du Galibier. Monsieur le comte de Glimes qui
conduisait cette armée entra dans ce duché. Monsieur de Las
Minas y entra dans peu de temps après.
Plus d'ennemi, plus d'alarme, et plus de passage à défendre.
Les Vaudois décampèrent d'ici vers le douze septembre pour se
rendre au col de la Rocie, et de la en Savoie, tout le reste des troupes en
fit de même, et nôtre vallée resta évacuée
jusqu'à la Saint Luc, pendant le quel temps le monde respirait un peu,
en se consolant de soins, des peines, et des fatigues passées [105]
".
La vie reprit normalement à Pont, à Chianale ou
à Bellino. Il était cependant interdit de se rendre en France
ce qui valut à Don Tholosan d’être arrêté pour
être allé à la foire. Il fut conduit à Saluces
où il fut libéré par le gouverneur.
Laissons nos vallées quelques instants pour écouter
un militaire français, Pierre Joseph de Bourcet. Il nous raconte la
stratégie franco-espagnole :
" Le roi de Sardaigne, sachant l'armée d'Espagne en Savoie
pendant la campagne de 1742 et au commencement de 1743, avait pris des précautions
sur tous les débouchés de la frontière du Piémont
pour empêcher le passage des Espagnols, dont l’unique objet était
d'entrer en Lombardie pour y faire diversion ou pour rejoindre l'armée
de Montemar, devenue ensuite l'armée de M. de Gages. Dès que
la cour de Madrid eut fait déclarer celle de France en sa faveur en
qualité d'auxiliaire par le nombre de quatorze bataillons d'infanterie
qu'elle lui fournil, elle envoya ordre à son général,
M. de La Mina, de rassembler l’armée sous Montmeillan et de marcher
sur la frontière de Piémont du côté de Briançon.
La cour de Versailles donna en même temps l’ordre au sieur Bourcet,
pour lors ingénieur en chef à Mont-Dauphin , de se rendre auprès
de M. de La Mina, qui l’établit maréchal général
des logis pour la marche qu'il projetait de faire faire à son armée
; et cet ingénieur lui ayant donné son projet de mouvement,
l’armée partit de Montmeillan [107].…
Les quatorze bataillons français marchèrent par
le côté de Gap et Embrun, et campèrent dans le même
temps au village de la Bessée. [107]
L’objet de celle marche regardait le siège d'Exilles, pour
l'attaque duquel on avait dirigé, par la grande route de Grenoble
à Embrun et Briançon, le canon et autres effets d'artillerie
nécessaires, et on l’avait combiné pour arriver au plus tard
sur le Mont Genèvre le 8 ou le 10 septembre, par conséquent
assez tôt pour se flatter d'avoir assujetti Exilles avant la fin de
septembre ; mais les négociations de la cour de Madrid avec le roi
de Sardaigne ayant fait suspendre l'achat des vivres et la marche du canon,
qui fut arrêté à Lesdiguières, on ne songea plus,
à l'époque du 8 septembre, qui fut celle de l'arrivée
de l'armée d'Espagne sous Briançon, qu'à préparer
les routes pour entrer en Piémont en qualité d'amis du roi
de Sardaigne ; mais la négociation n'ayant pas eu le succès
qu'on attendait, et le roi de Sardaigne ayant fait sur-le-champ un traité
à Worms avec la reine de Hongrie, le général espagnol
eut ordre d'entreprendre sur ce souverain par quelque acte d'hostilité
[107] ".
Pendant l’hiver 1742-43, un détachement de Vaudois était
resté en poste dans la haute vallée Varaita, et au début
de l’été ce sont deux compagnies de Vaudois qui arrivèrent
et s’installérent. Comprenant que les Gallispans faisaient mouvement
de la Savoie vers le Briançonnais, l’armée piémontaise
vint renforcer les défenses.
" Les troupes campèrent à la Levé c'est
à dire depuis les Alpiols jusqu'au Villaret, et il y en avait même
un régiment dans les bois du Sapé, du côté de Bellino,
il avait un camp aux Espeirrasses, et un autre a Bondormir, et nôtre
armée passa tout l'été dans cette position sans faire
aucun mouvement.
Les habitants étaient d'autant plus fatigués
par les fournitures qu'ils étaient obligés de faire à
l'armée en paille, fourrage, et bois, mais en une quantité
qui parait incroyable ; cette seule communauté avait formé
un magasin au Château de Pont, à la Chanal, au Villaret, et
plusieurs autres endroits de sorte qu'on portait aux susdits magasin près
de trois milles rubs de foin par jour. Jusque là cependant on était
pas bien assuré si l'ennemi passerait dans cette vallée, ou
s'il prendrait le chemin de Nice, on ne fit pas de grands retranchements,
chaque régiment, ou bataillon, s'était remparé à
l'hâte de front à l'ennemi, et à dire le vrai on croyait
qu'il y eût de l'intelligence, et on se persuadait facilement que l'armée
n 'était ici que pour parade ou pour couvrir quelque fin [105] ".
Pourtant les Espagnols préparaient leur attaque et définissaient
leur stratégie offensive :
Figure : Guerre factice 1743

" Le général, qui ne reçut
ses ordres que du 20 au 22 septembre, prévoyant que, quelque diligence
qu'il pût faire pour remettre l'artillerie en marche, elle ne pourrait
arriver sur le Mont Genèvre qu'au mois d'octobre et dans un temps
où les nouvelles neiges menacent d'interrompre toute communication
aux voitures à roues, abandonna le projet de siège d'Exilles
et proposa d'entrer par la vallée de Château Dauphin qui se
trouvait dégarnie de places fortifiées.
Lorsqu'il fut déterminé qu'on marcherait
dans la vallée de Château Dauphin pour faire quelque acte d'hostilité
contre le roi de Sardaigne, on tint un conseil de guerre auquel prirent part
l'Infant, M. le marquis de La Mina, M. le comte de Marcieux et tous les principaux
officiers de l’armée. Le sieur Bourcel commença par y établir,
par la connaissance du pays, la disposition des débouchés sur
l'ennemi, la position de ses troupes derrière les retranchements qu'il
avait fait construire dont la droite appuyait au mont Viso, le centre à
la tour de Pont et la gauche à Pierre Longue ; et, d'après les
réflexions auxquelles ces connaissances conduisirent, il proposa de
déboucher en Piémont sur trois colonnes, dont celle de la gauche
marcherait par le col de Lagnel, celle du centre par le col de Saint-Véran
et celle de la droite par le col du Longet ; les deux premières dans
le projet d'arriver sur la Chenal, et la troisième dans celui d'arriver
dans la vallée de Bellins, d'où on pourrait tourner par Château
Dauphin la position et les retranchements des ennemis situés au-dessus
du Villaret, tandis que les deux premières colonnes les attaqueraient
de front.
Cette proposition était relative à
la disposition de la frontière et fut approuvée par tous les
officiers généraux qui formaient le conseil de guerre, excepté
par M. de La Mina, dont l’avis ne se trouva pas prépondérant
et qui ne voulut pas admettre la marche de la colonne de la droite pour des
raisons qu'on n'a jamais pu savoir. Le projet de marche fut donc réduit
à deux colonnes pour déboucher seulement par les cols de Lagnel
et de Saint-Véran ; et comme pour arriver sur Molines, qui sépare
les deux vallons ayant rapport à ces deux cols, il y aurait eu beaucoup
trop de retardement à faire marcher toute l'armée par un seul
chemin, on disposa la marche de façon que quinze bataillons espagnols,
aux ordres de M. de Camposanto, s'avancèrent jusqu'à la Roche,
traversant le camp des Français établi à la Bessée,
d'où on les dirigea par Guillestre sur Seillac et le petit col du
Fromage, pour les faire arriver à Molines; on fit suivre la même
route aux quatorze bataillons français, et le reste de l'armée
d'Espagne marcha par Cervières, le col d'Hizouard et le château
de Queyras sur Molines, qui devenait le lieu d'assemblée, et d'où
la division destinée à passer le col de Saint-Véran
fut camper à la Chalp, et celle du col de Lagnel à Fongillarde
[107] ".
Au mois de septembre 1743, le roi de Sardaigne
se rendit dans la haute vallée Varaita et la population commenca à
se rendre compte que la guerre était proche.
" On ne douta plus que l'affaire ne fût
des plus sérieuses ; nous nous rendîmes cependant tous les curés,
consuls, et secrétaires de la vallée dans la maison de Monsieur
Antoine Richard feu Mathieu ou il se logea, et là nous eûmes
l'honneur de lui offrir nos respects, en assurant Sa Majesté que nous
étions près à sacrifier nos corps et nos biens pour
son service ; il nous reçut avec beaucoup de bonté, et répondit
à nos offres en nous disant, qu'il savait bien que ses troupes nous
faisaient beaucoup de mal, mais que l'Espagnol en était la cause, qu'il
nous payerait tout dans la suite ; quoique accablés de tant de travaux
et obérés de tant de fournitures, une réponse aussi
gracieuse nous consola beaucoup, et nous engagea de nouveau à faire
tout pour son service, en un mot nous retirâmes chez nous contents et
satisfaits [105].
Sur ces entrefaites un envoyé de la
Reine d'Hongrie se rendit à la cour suivi de Monsieur le marquis d'Ormea
et après une longue conférence, on signa le traité d'alliance
qui nous fût manifesté par les cocardes vertes que les soldats
et officiers de nôtre armée prirent incontinent. Le Roi visita
tous les postes tant du côté de Bellino que du côté
deAlpiols et dans cette position l'armée attendit de pied ferme l'ennemi
[105] ".
Figure : Les distances en Val Varaita
(Carte de B. de Monthoux).
Les troupes dans le Queyras.
Les "Transitons" de Molines , ces fameux manuscrits écrits
au jour le jour par les habitants du village, nous racontent le passage des
troupes :
" L'an 1743, au mois d'octobre, dom Philip, fils du roy d'Espagne,
avec son armée étant de cinquante mille hommes, ont commencé
à passer au présent lieu de Molines, pour s'en aller en Italie,
ayant fait un camp au lieu du Serre appelé la Chirouse et un autre
à Costeroux, à la Gravière des plans, à Revelet,
au clot dal Cougnas, au clot de Coste Laurière ; de même, il
y en avoit aussi au pont des Marous, au pra dal Bois, à la Chalp-Ronde,
sans compter ceux que nous avions dans les maisons, plusieurs capitaines et
soldats avec leurs ordres et plusieurs artilleries et brigades dont nous
avons été obligés et même forcez à fournir
quantité de foin et de paille et outre le bois qu'ils ont coupé
dans la commune, étant au nombre de cinquante mille pieds d'arbres,
il nous a fallu fournir quantité de bois, tant pour la cuite du pain
de munitions que pour le corps de garde."
" Le général espagnol Las Minas dispose de 14
bataillons espagnols auxquels se joignent, sous les ordres du prince de Conti,
12 bataillons français venus par Guillestre et Ceillac. Il dispose
en outre de 20 canons ".
L’ensemble des forces franco-espagnoles est sous les ordres de
l’Infant Don Philippe d’Espagne.
Les sardes pratiquent la politique
de la terre brûlée.
" D'abord que l'ennemi approcha ses piquets vers nos montagnes,
nos tourments sans conter nos alarmes redoublèrent, car pour ne pas
laisser de substance à son armée, on ordonna de vider toutes
les maisons au-dessus de Château de Pont.
Il fallut cependant obéir et pour parvenir plus vite
à cette évacuation, on envoya pendant dix jours près
de trois mille mulets avec des fourrageurs pour emporter tout le fourrage
au camp.
Nous fîmes une estime qui montait à près
de cinquante mille rubs en fourrage seulement, parce que l'année avait
été des plus abondantes, sans conter celui qu'était
allé aux magasin.
L'ennemi s'étant approché du sommet de la montagne,
on ordonna que tout le foin et la paille qui restait encore dans les maisons
fût porté au tour de la Chanal à cinquante pas de distance
des maisons afin d'y être brûlé. Tout fût exécuté
à la lettre, et ceux qui n'avaient pas de monde étaient obligés
de payer des soldats pour sortir leur récolte. Pour les orges ils étaient
encore en campagne parce que ayant occupés de cette façon les
habitants, ils ne purent pas les ramasser ; il y en avait une belle récolte
mais tout fût perdu [105].
L’armée piémontaise avait organisé une importante
logistique pour apporter le ravitaillement nécessaire aux 18 bataillons
du bois de Levée, aux 11 bataillons installés à Villaret
et aux milices du fond de la vallée. Il fallait, par exemple, apporter
quotidiennement 277 quintaux de fromage.
Le passage des cols.
L’avant-garde espagnole apparut sur le col Agnel. C’était
un corps de fusilliers de montagne que l’on appelait "Mignones" ou "Miquelets",
une infanterie légère, habilitée à des mouvements
rapides en zone alpine, seulement équipée de cordes et de pistolets
enfoncés sous la ceinture.
Ensuite, les 14 bataillons espagnols, soit 14.000 hommes, commencèrent,
le trois octobre, à s'emparer du col de l'Agnel à 2.748 m d’altitude.
La passe du Crapon ayant été minée, l'artillerie passa
par le vieux col Agnel. Les 12 bataillons français, soit 16.000 hommes,
sous le commandement du général comte de Marcieux, franchirent
le col de Saint Véran (2.848 m).
A Chianale, Don Tholosan alla au-devant des troupes jusqu’au Pont
des Bernardi.
" D'abord que les miquelets furent sur le pas de Loule nos
piquets consistant en milices, Vaudois, et quelques soldats d'ordonnance
se replièrent vers Pont.
Carte : les troupes face à face dans nos
vallées.
En se repliant ils mirent le feu aux pailles et fourrages
qui étaient autour de la Chanal en plusieurs endroits de Pont ; triste
spectacle, on vit dans un instant un feu mêlé de fumée
qui entourait tout le village. Les cris des hommes et des femmes, les pleurs
des enfants mêlés avec le bruit de ces flammes formaient un fracas
inouï, et on ne s'entendait pas les uns et les autres [105].
Après une court halte que firent les Espagnols sur Loule
ils descendirent en bas jusqu'au Pont des Bernardi.
Don Tholosan fut bien reçu par les officiers qui lui assurèrent
qu’ils ne feraient aucun mal à ses paroissiens.
Le général Las Minas et le marquis de Castelar
arrivèrent au dit pont, et il nous firent sonne par un sergent et
deux soldats de nous présenter.
Nous ne partîmes pas assez tôt pour avoir le bonheur
de faire nôtre révérence à Las Minas qui laissa
à son poste le marquis de Castelar qui nous reçut avec toutes
les politesses possibles, nous offrant de son tabac et sa protection et nous
assurant de ne permettre jamais qu'aucun mal nous fût fait. C'était
peut être de tous les Espagnols, le plus poli, le plus affable, et
le plus complaisant.
Le marquis cependant pour nous donner des marques de la bonne
conduite qu'il voulait faire observer défendit de ne rien prendre
qu'en payant et le peu de pain que nous leurs avions porté fût
distribué à qui en voulait avec de l'argent. Nous quittâmes
au commencement de la nuit ce seigneur, et nous retirâmes dans nos
maisons ".

Descente des col Agnel et de St Véran.
Pendant la nuit, les habitants de Chianale allumèrent des
feux dans le village car ils craignent une attaque des uns ou des autres.
" Le quatrième jour étant venu voilà que
toute l'armée se mit en marche et les miquelets qui le soir d'auparavant
s'étaient repliés au bout du col de l'Agnel descendirent les
premiers suivis de toute l'armée espagnole ; pour les Français,
ils descendirent par le col de Saint Véran. C'était un coup
d'œil admirable que cette descente, les différentes colonnes formaient
comme autant de torrents qui descendent avec impétuosité du
haut des montagnes, avec cette différence seulement que ces troupes
marchant avec gravité recréaient la vue par la variation des
couleurs dont leurs régiments étaient habillés. Cette
descente dura tout le jour, même jusqu'à bien avant dans la
nuit, le tout entra cependant avec ordre, et personne ne vint dans nos maisons
qu'après que tout fût campé. Les Espagnols campèrent
depuis le plan de Verney jusqu'au pré de la Pierre, et les Français
campèrent à la Chalme (Chalane). La cavalerie et l'artillerie
était autour de la Chanal, et heureusement pour nous tous les officiers
généraux occupèrent nos maisons, et par leurs logements
ils les garantirent de toute insulte, à l'exception de celles qui
n'eurent point d'officiers qui furent en quelque façon détruites.
Pour l'Infant Don Philippe il logea à la mission, les autres furent
logés par billet que je fis moi même avec le fourrier général
de l'armée.
Cette armée se forma dans trois jours qu'elle séjourna
ici, et fit descendre leurs canons. Comme le pas du Crapan était coupé,
ils firent un chemin par le col vieux, et le descendirent avec une si grande
facilité, que leur arrivée ne retarda presque point la marche
de l'armée. Arrivés au pont neuf quoiqu'il fût bien voûté,
ils ne jugèrent pas à propos d'y passer dessus, mais ils firent
un autre pont un peu au dessus au pied du pré de la cure et en suite
ils ne s'écartèrent plus du grand chemin, qu'à la Rua
Gensanne où ils firent le tour de la première maison à
main gauche et dernière le four à main droite". [105]
Les armées franco-espagnoles
à La Chanal.
Le 6 octobre, toute l'armée à l'effectif de 25.000
hommes était en position autour de La Chenal (Chianale), face à
Charles Emmanuel installé à Pont, derrière ses fortifications.
Des centaines de soldats de l’artillerie avaient descendu les 12 canons de
campagne, de 8 et de 12, jusqu’à Chianale.
" Pendant le triste séjour de cette armée autour
de la Chanal dans une saison ou le froid se faisait extrêmement sentir,
nos bois furent entièrement abattus, et selon l'estime qu'en fût
faite plus de vingt mille pines furent coupées, perte des plus sensibles
et plus considérables que nous ayons faite ; on entendait que coups
de hocches (haches), et fracas d'arbres renversés, il y périt
même plusieurs soldats que les arbres en tombant avaient écrasés,
le jour était obscurci par la fumée des corps de garde, et la
nuit semblait un jour, par les feux en si grand nombre allumés. Le
cinq, le six, et le sept octobre se passèrent sans que cette armée
fit aucun mouvement seulement pour attendre les provisions nécessaires,
ce qui avait jeté une si grande disette dans cette armée que
le pain y valait vingt quatre sous la livre, et le vin cinquante sous le
pot ; encore n'en trouvait-on pas, les chevaux et mulets morts servaient
de nourriture exquise aux pauvres soldats : aussi en mourait-il une grande
quantité, faute de fourrage, il n'y eût pas grange ni recoin
des montagnes qui ne fût fouillé tant pour avoir du fourrage
que pour trouver d'autres nourritures, et nous pouvons dire qu'il est venu
de paille de Gap ici, enfin c'était la plus grande détresse
du monde [105] ".
Position des armées
sardes.
Les cartes militaires de 1743 nous indiquent la position des régiments
piémontais : Si l’on regarde vers le fond de la vallée, les
bataillons de la droite sont les deux des Gardes, d‘Audibert, Turin, Baden-Reith
et Riethman. Ceux du centre sont Rebinder, les fusiliers de Savoie, Montferrat,
Saluce, la Reine et Mondovi. Ceux de la gauche sont de Montferrat, les fusiliers
Guibert, Tarentaise, de Diespack et la Marine. Les carabiniers des Dragons
du Roy sont vers le mont Viso, ceux de Piémont sont aux batteries
de Pont. Sur la crête de Bellino se tiennent les bataillons du Genevois,
à droite, et ceux de la Reine sur la gauche.
La Bataille.
Après 3 jours d’arrêt les armés gallispanes
descendirent vers le château de Pont. Un détachement chercha
à pénétrer dans la vallée de Bellino, mais fut
repoussé par les Piémontais.
M. de Bourcet précise que " L’ objet était d'attaquer
le retranchement que le roi de Sardaigne avait fait faire entre le mont Viso
et Pierre-Longue, qui sépare la vallée de la Chenal de celle
de Bellins, et de marcher sur Saluces, d'où on aurait été
en état de ravager la plaine de Piémont ou de la traverser pour
se porter sur le Parmesan et sur le Plaisantin ; mais pour cet effet il aurait
été nécessaire de se précautionner de vivres
et de tout ce dont on aurait eu besoin, au lieu que l'armée d'Espagne
entra dans la vallée de la Chenal, ayant à peiné pour
quinze jours de subsistances assurées [107].
Pour en revenir à ce qui fut fait relativement aux retranchements,
on les avait reconnus d'assez près et on en projeta l'attaque de celte
sorte :
- une colonne à la droite devait attaquer les retranchements
de Pierre-Longue;
- une seconde colonne, ceux du Villaret, toutes deux à la droite
du château de Pont ;
- une troisième colonne était dirigée par le château
de Pont et en devait former l'attaque,
- une quatrième colonne était chargée d'attaquer
les retranchements à la gauche du château de Pont, sur le penchant
qui bordait la rive gauche du ruisseau de Valante,
- et une cinquième colonne s'était rendue au pied du mont
Viso, à la source dudit ruisseau de Valante [107].
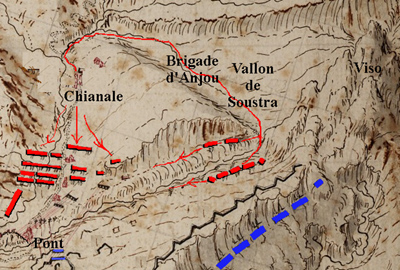
Itinéraire de la brigade d’Anjou.
Cette disposition embrassait l'étendue des retranchements
sur tout le front et ne pouvait être mieux arrangée; mais il
est aisé de s'apercevoir que les ennemis n'avaient aucun sujet de
crainte, ni pour leur droite à cause des escarpements du mont Viso,
ni pour leur gauche puisqu'on n'avait dirigé aucune troupe dans la
vallée de Bellins, d'où on pouvait tourner Pierre-Longue et
revenir sur les derrières des retranchements du Villaret.
Pour favoriser la marche de la colonne qui était destinée
à attaquer le château de Pont et celle de la colonne qui lui
était contiguë par la gauche, on avait disposé dès
la veille une batterie de huit pièces de quatre sur le village, et
un détachement fut commandé pour aller mettre le feu audit village,
afin d'ôter à l'ennemi la facilité qu'il aurait trouvée
de défendre le débouché de ces deux colonnes par l'occupation
des maisons, qu'il avait fait créneler [107].
Don Tholosan raconte le début de la bataille :
" Le jour de Nôtre Dame du Rosaire les officiers se confessèrent
presque tous et le jour d'après, qui était le huit, l'armée
partit pour Pont en deux colonnes, les Espagnols allèrent passer aux
granges du Clot et les Français à la droite au dessus du chemin
royal. La cavalerie, artillerie, et équipages gardèrent le
grand chemin ; ils campèrent depuis les routes jusqu'au Château
du Pont, et Don Philippe se logea chez Sieur jean Gaudessard, notaire de Pont,
d'abord qu'ils furent campés on approcha l'artillerie à Saint
Chaffré pour battre le Château. [105] ".
Et M. de Bourcet nous donne la version " française " :
" Pendant que la cinquième colonne marchait du vallon de
Soustras pour se rendre au pied du mont Viso, les Piémontais abandonnèrent
le château de Pont et le village, et s'étant retirés derrière
leurs retranchements, d'où ils ne se montraient d'aucune part, on
crut qu'ils les avaient entièrement abandonnés et que rien
ne s'opposait plus à la marche de l'armée le long de la vallée
de Château Dauphin; et la confiance dans laquelle se trouvèrent
l’Infant et M, le marquis de La Mina de cette retraite fit donner l'ordre
à la cinquième colonne de ne point attaquer et de rejoindre
l'armée par le vallon de Vallante qui était le plus court chemin;
cet ordre arriva au moment qu'on se disposait à l'attaque ; à
sa réception le maréchal de camp espagnol qui commandait une
colonne composée de la brigade d'Anjou, des troupes françaises
et d'environ huit cents Espagnols, se mit en marche le long du chemin qui
était établi à mi-penchant sur la rive droite du ruisseau
de Vallante, n'apercevant que quelques paysans dans les retranchements des
ennemis qui bordaient le sommet du penchant de la rive gauche, et ne doutant
pas qu'il n'y eût depuis la veille quelque nouvelle d'accommodement
entre l'Espagne et le roi de Sardaigne [107]. "

La bataille de Pont
Dans le même moment, M. de La Mina, avec l'opinion
que les ennemis avaient abandonné leurs retranchements, fit partir
un détachement pour établir un pont sur le ruisseau de Valante
entre le château de Pont et les retranchements, afin de faire avancer
l'armée sur le Villaret; mais les ennemis, qui jusque-là ne
s'étaient pas montrés, sortirent des bois qui se trouvaient
derrière leurs retranchements et firent feu non seulement sur le détachement
qui avait ordre de travailler au pont, mais encore sur la colonne de la gauche,
qui, descendant le vallon de Valante, parcourait un défilé subordonné
à leurs retranchements et d'où on ne put opposer aucun contre-feu,
soit parce qu'il n'y avait qu'un escarpement à la droite du défilé,
soit parce que la troupe aurait été doublement exposée
en s'arrêtant pour tirer, et que d'ailleurs les ennemis se trouvaient
couverts par le parapet de leurs retranchements de façon qu'on ne
voyait que le bout de leurs chapeaux. Cet éveil si peu espéré
donna l'alerte à M. de La Mina, qui, en même temps des coups
de fusil qu'on tirait dans le vallon de Valante, sentit, mais trop tard,
combien il avait exposé la cinquième colonne en lui donnant
ordre de rejoindre l'armée par le vallon de Valante, dans la confiance
où il fut qu'il n'y avait plus de troupes ennemies dans les retranchements
; et pour remédier autant que possible au danger dans lequel était
cette colonne, il fit marcher les grenadiers et piquets de l'armée
entre le château de Pont et les retranchements, comme pour les attaquer;
on disposa deux batteries de pièces de canon de campagne et de montage
: sur la partie desdits retranchements la plus exposée dudit château,
afin d'attirer l'attention des ennemis et de les obliger à se dégarnir
sur leur droite et à diminuer par conséquent le feu qu'ils opposaient
à la marche de la cinquième colonne; mais le contre-feu ne
produisit aucun avantage, la colonne perdit quatre ou cinq cents hommes et
ne put s'éloigner du danger qu'à la fourche des chemins, un
peu au-dessus des cassines, d'où la tête de colonne s'avança
sur les cassines, et la queue par impatience suivit la direction du chemin
le plus rapproché du ruisseau et y souffrit beaucoup, L'inquiétude
dans laquelle on était sur cette colonne avait fait détacher
un aide de camp pour porter le contre-ordre au maréchal général
espagnol et l’avertir du danger qu'il trouverait à suivre le vallon
de Valante, Mais cet aide de camp marcha par le vallon de Soustras et n’arriva
au pied du mont Viso par le col de Valante que deux heures après le
départ de la colonne. [107].
Don Tholosan vécut tout cela dans son village et le mémoire
qu’il nous a laissé donne une version semblable de cette bataille :
" Le 9 octobre l'armée se mit en bataille, partie aux
hubacs de l'Eglise de Pont, et partie sur la gauche au dessus du Château,
on attaqua vigoureusement le dit Château qui était palissadé,
je veux dire le village et le fort qui n'était que de fascines et de
gazons [105].
Encore que Monsieur Boregard qu'y commandait se fût préparé
à une vigoureuse défense avec des pierres et des fauls en cas
qu'on vint à l'assaut, il ne résista pas longtemps et passant
par un chemin qui était par derrière allant au pré du
curé, il se retira dans son camp laissant tout aux Espagnols qu'y
entrèrent sans coup férir. Le dix fût un peu plus rude
car Las Minas étant allé sur la servière de la Para
reconnaître la position de nôtre armée aux bois de la
Levé, il vit qu'il était nécessaire de l'attaquer sur
l'aille droite qu'était auprès des monyers au pied des Alpiols.
Pour ce faire il ordonna à la brigade d'Anjou avec quelques Espagnols
commandés par Monsieur De Courvolan de passer par Soustra, et aller
au bout du vallon du Château descendre par le même et se porter
aux granges des Chaulieres pour attaquer le camp du régiment des gardes
qui occupait le poste susdit. Tout cela fût exécuté, on
partit d'ici à l'entrée de la nuit, et on alla camper au bout
de Soustra au petit point du jour, ils se portèrent sur la crête
du vieux vallon du Château ou ayant reconnu nôtre camp ils descendirent
à petit bruit dans le vallon.
Au Château ayant reconnu que le plus fort de nôtre
armée se trouvait à la Vignasse et sur le ravin dit la ruine
grosse pour faciliter l'attaque que la brigade d'Anjou devait faire au pied
des Alpiols, on monta pendant la nuit, du neuf au dix, six pièces
de canons de six à huit livres de baIe, au champ qui est dessus Courbiére
et dressèrent une batterie qui incommodait beaucoup nos troupes, tandis
que ceux du Château faisaient un feu continuel sur les mêmes,
mais étant couverts de quelques retranchements faites avec des arbres
renversés, ils n'en furent pas beaucoup endommagés. Tout étant
ainsi disposé on attendait de moment en moment le succès de
l'attaque, mais la susdite brigade étant arrivée aux Chaulieres,
soit qu'ayant reconnu que le camp des gardes fût inaccessible, soit
ils aient reçus ordre de descendre par le grand chemin, et se rendre
au Château sans faire aucune attaque ils descendirent sans rien faire,
et arrivés à la descente du Ponteillat ils essuyèrent
le feu de toute nôtre mousqueterie jusqu'au moulin des Alpetes, et là
une partie suivit le grand chemin jusqu'au Château, et les autres passèrent
aux Alpetes et de là au travers du sentier de Courbiere même
avec leurs chevaux dont il s'en précipita une grande quantité.
Il faut cependant remarquer qu'en égard au grand feu qu'ils essuyèrent
des nôtres il n'y en eût pas beaucoup de tués. Le nombre
des blessés fût assez grand, et à dire le vrai, il ne
devait échapper personne de cette brigade, mais les nôtres ne
sortant pas de retranchements, se trouvaient en quelque façon hors
de portée, tandis que la dite brigade faisait ainsi sa retraite ;
il sortait du Château un feu vif et continué pour la favoriser,
il ne resta dans cette affaire aucune personne de marque que Monsieur le
baron D'Alles lieutenant colonel du régiment de Crésy qui vint
mourir ici de ses blessures et qui par ordre de Don Philippe fût enterré
dans l'église de Saint Laurent avec tous les honneurs militaires,
et l'aide de camp de Las Minas, la susdite brigade n'eût de morts,
à ce qu'on a pu reconnaître qu'une quarantaine d'hommes, ainsi
se passa la journée du dix [105] ".
Du côté de Pont on avait détaché
quelques troupes espagnoles qui passant par le vallon de Fioutrouse, le 8
octobre, se rendirent à Bondormir (2.651 m), pour tourner les défenses
piémontaises par la vallée de Bellino.
Mais ce col stratégique était bien défendu
par deux bataillons piémontais installés dans leurs tranchés
et les Espagnols durent arrêter leur avance, passer la nuit du 8 au
9 octobre sur les pentes du col jusqu’à recevoir l’aide d’une compagnie
de Grenadiers et de Miquelets. Une nouvelle attaque fut repoussée et
les Piémontais restèrent en possession du col. Une dernière
attaque, dans la matinée du 10 octobre, n’eut pas plus de succès
et les troupes redescendirent à Chianale.
Ils détachèrent un gros piquet de grenadiers
et miquelets au long du bois de Romagne, et allèrent pour attaquer
les nôtres qui étaient à la Bataïole, il se fit
un grand feu de part et d'autre sans aucun effet, et l'Espagnol vers la nuit
fût obligé de se replier dans son camp

Attaque du col de Bondormir
Retour des forces franco-espagnoles.
M. de Bourcet ajoute : " Après que cette colonne eut rejoint
l’armée, on assembla un conseil de guerre auquel assistèrent
l'Infant. tous les officiers généraux de l'armée espagnole
et ceux des quatorze bataillons français; on y fit le rapport de la
situation des ennemis, et d'après les réflexions auxquelles
conduisirent la bonté de leur position, le peu de subsistances qu'on
avait, et le danger de voir à chaque instant les cols de Lagnel et
de Saint-Véran fermés par les neiges, on opina qu'il fallait
se retirer; il n'y eut que M. de La Mina qui insista à tenter l’attaque
de la gauche des ennemis qui faisait la droite de l'armée combinée,
et pour laquelle on décida la marche de quatorze bataillons espagnols
ou français qui devaient s'avancer par le vallon de Fioutrouse et par
la Battayole sur Pierre Longue ; mais un courrier d'Espagne, qui arriva pendant
la nuit, suspendit, cette marche et il ne fut plus question que de penser
à la retraite, pour la sûreté de laquelle on fit marcher
quelques bataillons aux cols de Sainl-Véran et de Lagnel, pendant
que l'armée, ayant fait mettre le feu au château de Pont, fortifié
en fascinages, marcha par la Rua de Genzane sur le village de la Chenal[107]
".
Don Tholosan : " On s'attendait le onze à une attaque
général, mais il ne se tira que quelques coups de fusil de
part et d'autre surtout à la ribayaille ou les miquelets étaient
postés avec nos piquets qu'étaient dans les bois de la Plate
du Château. On tint un Conseil de guerre où, ayant mieux considéré
la rigueur de la saison, les Espagnols prirent la résolution de s'en
retourner sans entreprendre autre chose ; la nuit donc de l'onze au douze
ils mirent le feu aux retranchements du Château, et toute l'armée
se retira dans le camp à la Chanal dont les tentes n'avaient jamais
été levées [105]. "
M. de Bourcet : " Le feu mis au château de la Chenal
un peu trop tôt et, avant que l'armée se fût retirée,
occasionna plusieurs coups de canon tirés des retranchements, qui donnèrent
lieu à quelques mouvements indécents qu'on aurait pu éviter
si on avait mis l’armée en bataille plus en arrière avant d'avoir
fait mettre le feu audit château[107]."
Don Tholosan : " Cette retraite nous effraya plus que l'entrée,
et voyant qu'on avait mis le feu à cinq ou six maisons de Pont, comme
à celle de Jean Favre aux routes, à celles des Gallians au
Forest, à celles de Monsieur Lambert et Jean Pierre Gensanne à
la Rua Gensanne, nous pensions d'éprouver le même sort. Tout
ce pauvre pays était dans la dernière consternation car on
disait communément dans l'armée qu'on mettrait infailliblement
le feu aux quatre coins de ce village, pour éviter un si grand malheur
nous recourûmes à la clémence du Prince qui nous fit assurer
par Monsieur de Castelar, qu'il ne donnerait point de semblables ordres
".
La retraite par le col Agnel.
Don Tholosan : " A deux heures après minuit l'armée
commença à se retirer, et le Prince partit aussi à la
faveur de la clarté des flambeaux et lanternes car la nuit était
des plus obscures à cause d'un brouillard répandu et le jour
étant arrivé il neigeait à grande force, et faisait un
froid insupportable ; cette retraite se fit pendant le jour avec beaucoup
de gravité et sans précipitation, mais l'artillerie étant
embourbée au milieu de la montagne interrompit extrêmement la
marche, et fût cause que l'arrière garde dormit au milieu du
col de l'Agnel, de sorte que depuis les granges du Rio jusqu'à Molines
tout était rempli de monde, d'équipages, et munitions, et de
l'autre côté depuis la grange de pagé jusqu'à Saint
Véran c'était la même chose. On a jamais vue une armée
dans une si grande misère. Le froid étant excessif, il gela
une grande quantité de monde : et fût cause d'une grande désertion
; on voyait venir les compagnies entières, on ne peut point s'imaginer
la perte qu'ils firent, soit en équipages, en tentes, en munitions
de guerre, car leurs poudres, leurs boulets, leurs outils, tout y resta :
ils perdirent jusque leur chapelles, et plus de six cent mulets ou chevaux
[105] ".
M. de Bourcet : " Les ennemis ne sortirent point de leurs retranchements
et ne songèrent qu'à inquiéter la retraite de l'armée,
qui se fit en désordre à cause de la neige qui tombait, des
glaces qui couvraient les chemins des deux montagnes et du froid excessif
; il y eut des équipages pillés par les valets ou par les soldats
de l'armée ".
A l’époque les militaires nobles portaient encore une partie
de leur argent et quelques objets précieux.
Don Tholosan : " Nos paysans se seraient facilement dédommagés
du mal qu'ils avaient reçus de cette armée, si les troupes de
nôtre Roi ne se fussent portées à leur poursuite, mais
aussitôt qu'on sût que l'ennemi eût repassé le col
et qu'il ne restait en de ça que l'arrière garde, on envoya
d'abord tous les Vaudois, les grenadiers à leur poursuite et ce fût
eux qui eurent la meilleure portion du butin, il y eût des soldats
qui firent leur fortune parce qu'ils attrapèrent les argenteries ;
un entre autres en eût pour plus de dix mille livres, un autre rencontra
une bourse de deux cent louis d'Espagne, les vases sacrés, les burettes
d'argent et les soucoupes des chapelles, tout fût trouvé par
les Vaudois, et les soldats, et le Roi croyant que la chapelle de Don Philippe
y fût restée, ce que je ne crois pas, fit acheter tout cela,
et en fit un présent à la paroisse de Saint Eusèbe en
reconnaissance du séjour qu'il avait fait à Château Dauphin
et en action de grâce d'avoir repoussé l'ennemi avec tant de
gloire. Une chose que je ne pouvais pas souffrir, et que je ne veux pas passer
ici, fût que nos habitants allaient aussi vers la montagne pour voir
d'attraper quelque chose, mais on le leur enlevait tout par chemin, et on
ne laissait entrer qui que ce soit à la Chanal sans être fouillé,
tout leur était ôté jusqu'à ce qu'ils avaient
acheté des soldats, et au moindre refus de remettre, ils étaient
assommés. Ils entraient même dans les maison, et emportaient
non seulement ce qu'ils avaient eu des Espagnols, mais encore ce qui leur
appartenait. On aurait dit qu'on avait donné ce village au pillage,
je m'attendais bien à ce mauvais traitement de la part des nôtres,
parce qu'ils nous ont toujours regardés comme de traîtres, comme
gens aimants les Français, ils auraient voulu que l'ennemi nous eût
brûlés, et pillés, et cela n'étant pas arrivé,
les avait confirmé dans la mauvaise opinion qu'ils ont de nous, il
y eût encore quelques particuliers qu'eurent des bonnes rencontres,
et ceux qui surent cacher leur butin ne s'en trouvèrent pas mal [105]
".
L’abandon des canons.
Le grand froid fit geler les pieds de beaucoup de soldats et on
perdit plus de monde dans la marche de cette mauvaise journée qu'on
n'en avait perdu pendant les huit jours qu'on s'était trouvé
en présence de l'ennemi[107].
" Ce qui faisait retarder l'arrière garde espagnole
était l'artillerie qu'ils ne voulaient pas perdre. Pendant deux jours
consécutifs ils vinrent tenter de faire passer douze pièces
de gros canons, mais les chemins étaient si gelés qu'il leur
fût impossible de le faire, et malgré toute leur force ils furent
contraints de les abandonner après en avoir encloués quelque
uns, brisés les armes et les morillons aux autres de sorte qu'on peut
dire qu'ils s'en retournèrent débarrassés de tout l'attirail
de l'armée [105]. "
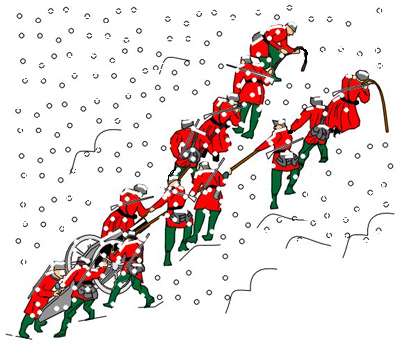
M. de Bourcet donne une explication plus tactique de l’abandon
des canons : " Il arriva à cette retraite que les douze pièces
de canon de quatre que les Espagnols avaient empruntées au roi de
France, ayant remonté les deux tiers de la montagne, sous prétexte
de la gelée M. de la Mina ne voulut pas qu'on continua à les
monter jusqu'au sommet, d'où on aurait pu les ramener jusqu'au Château-Queyras,
et que, n'ayant point voulu écouter le sieur Bourcet, qui lui assurait
qu'avec vingt ducats il ferait monter lesdites pièces à bras
d'hommes, il ordonna qu'on brûlât les affûts et qu'on précipitât
les pièces ; ce qui donna la tentation de croire qu'il l'avait fait
exprès pour piquer le roi de France et l'engager à soutenir
la guerre contre le roi de Sardaigne; et effectivement, pendant la campagne
de 1744, le Roi donnera quarante bataillons, etc. "
Don Tholosan : " On reconnut donc qu'ils avaient abandonnés
leurs canons, nos troupes s'empressèrent de les venir prendre et les
conduire en triomphe comme les trophées de leur victoire. On redoubla
donc les piquets, et on ordonna à tous nos habitants d'aller au col
de l'Agnel ou ils étaient afin de les traîner en bas, il aurait
fallu des cordages et des roues, et tout manquait, on voulait prendre celles
de nos cloches quelle ressource, cependant je ne sais comme l'on fit, à
force de maltraiter le consul et les conseillers pour avoir des pals de fer,
et cordes nécessaires, on parvint à les descendre [105].
Lorsque les canons arrivèrent au pont des Bernardi,
nous allâmes quelques prêtres ensemble à leur rencontre,
là je reconnus en quelle estime j'étais auprès de nos
officiers [105] ".
Le marquis de Seyssel reprocha au curé Tholosan son " entente
" avec les Français. Celui-ci protesta de son innocence.
On ne saurait finir cette année sans vous dire que la
descente des ces canons nous fût plus douloureuse que le séjour
des ennemis, car le froid étant rude on allumaient des feux en toutes
les rues de la Chanal, et nos maisons qui avaient déjà passés
tant de dangers semblaient n'être réduites en cendre que par
les mains de nos amis, et sans que j'eu la précaution de loger des
officiers la maison curial n'en échappait pas [105].
Conduite à Turin, attelée à des mulets pris
aux Espagnols, l’artillerie y fut exposée triomphalement [107], lors
d’une cérémonie à la cathédrale en présence
du roi et de la cour pour célébrer la victoire.
Les "Transitons" donnent le bilan de cette désastreuse
campagne de 1743 : "Etant donné la façon que les canons
et coups de fusil de l'armée du roy de Sardaigne ayant ronflé
sur l'armée dudit dom Philip, de sorte qu'il est resté à
la bataille 8.000 hommes, sans que l'armée dudit dom Philip en aye
peu tuer que 200. Il est vrai que les mignons (ou mignots) en ont tué
quelques-uns dans les montagnes. Dont il y avoit une grande extrémité
; le pain de munition se vendait 3 livres chaque pain. Et les espions ont
rapporté que la reine Dongrie (de Hongrie) avoit en chemin onze mille
hommes, avec douze pièces de canon pour ayder au roy de Sardaigne et
en cela le dit dom Philip a esté obligé, avec son armée
restante, de s’en retourner sur ses pas"
En fait, l’armée gallispane perdit un bon millier d’hommes
dans cette aventure et près de 3.000 prisonniers ou déserteurs
restèrent en Piémont.
Retour par le Queyras.
Les franco-espagnols retournèrent par le Col Agnel, harcelés
par l’ennemi et repassérent dans le Queyras. A Molines, ils brûlèrent
tout ce qu’ils trouvaient , planches ou portes de maison, pour se protéger
du froid.
Les "Transitons" : " le dit dom Philip a esté obligé,
avec son armée restante, de s’en retourner sur ses pas et ils ont encore
aussy passé au présent lieu de Mollines dont le passage nous
a fayt plus de mal en venant qu'en allant et ils ont brûlé les
planches des couverts, les portes des maisons, laditte armée estant
réduite à l'extrémité tant pour le pain que pour
la gellée de froid qui faisoit en ce temps-là, qu'il en resta
sur la montagne environ 150 hommes et 1’artillerie estant presque la dernière,
ne pouvant pas avancer, les Vaudois lui ayant donné dessus, et ils
ont pris la plus grosse partie de façon qu il y a des capitaines qui
ne leur est resté que l'habit qu'ils avoient sur le corps.
Epidémie.
Don Tholosan : " La neige étant tombée les troupes
sardes se retirèrent de cette vallée pour aller prendre leurs
quartiers d'hiver, et on ne laissa ici qu'un petit détachement des
Vaudois qu'y restèrent tout l'hiver et ainsi se passa cette année
1743, qui fût funeste à plusieurs, car l'armée espagnole
ayant laissé beaucoup de morts dans les chemins qu'en étaient
remplis depuis la Chanal jusqu'à Molines, outre plusieurs malades dans
les hôpitaux, il s'engendra une fièvre maligne parmi nos habitants
qui en réduisit au tombeau près de septante, dans l'espace
de trois mois, maladie qui ne donnait pas le temps de se reconnaître,
c'est pourquoi d'abord qu'ils s'en sentaient saisis, on les confessait et
communiait tout de suite [105] ".
Chianale perdit 70 personnes sur 500 habitants, à cause
de cette épidémie. Il en est de même dans le Queyras
:
Les "Transitons" : " Ledit dom Philip a quitté dicy
avec son armée nous ayant réduits en grand dommage ; nous a
laissé aussy plusieurs maladies savoir tant dirrées (diarrhées)
que fièvre maline quy a causé la mort à plusieurs personnes."
Une chose qui fût pour nous un motif de remercier Dieu
des grâces qu'il nous avait fait, au milieu de ces troubles fût
le respect qu'ils portèrent à nos églises, aux personnes
ecclésiastiques et religieuses et à celle du sexe, car il n'arriva
ni viol, ni autre affront, cas ordinaire aux gens de guerre dans le pays
ennemi. On ruina presque tous les moulins, et on détruisit bien de
maisons [105].
La campagne de 1743 terminée, les militaires français
tirèrent les conclusions de cette "Affaire de La Chanal".
Voici les réflexions de M. de Bourcet:
1. Les propositions qu’avait faites le roi de Sardaigne à
la cour de Madrid ne devaient point suspendre la marche du canon ni l’approvisionnement
des vivres; ces précautions n'ajoutaient ni ne diminuaient rien aux
articles dont on aurait pu convenir, et si elles avaient été
précises, on aurait eu encore le temps de prendre Exilles et de faire
repentir le roi de Sardaigne de son traité de Worms, puisque son pays
se serait trouvé ouvert par la campagne de 1744 et qu'on aurait pu
s'avancer sur Turin sans craindre le canon et la Brunette, trop éloignée
du penchant de la droite de la vallée de Suse pour en défendre
le débouché [107].
2. Quel succès pouvait-on espérer de la vallée
de Château-Dauphin en y débouchant au commencement d'octobre
et sans avoir une ressource de plus de quinze jours de subsistances ? Ne devait-on
pas, au contraire, craindre de s'y voir renfermer par les neiges; car si,
pendant que l'armée était devant le château de Pont,
il en était tombé trois ou quatre pieds, comment l'armée
combinée aurait-elle pu se retirer et de quoi aurait-elle vécu
? On ne peut penser à cette situation sans frémir, lorsqu'on
connaît le pays et le peu de moyens de vaincre les neiges lorsqu'il
fait du vent. Il y avait donc eu peu de réflexion dans la détermination
de s'avancer jusqu'au château de Pont à une époque si
reculée, et on serait bien tenté de penser que cette marche
s'est entreprise dans le seul objet d'engager les troupes de France à
un acte d'hostilité contre le roi de Sardaigne, afin de s'assurer
de leur concours dans les opérations de la campagne suivante ; et
effectivement le Roi, qui avait accordé avec beaucoup de peine les
quatorze bataillons, en donna quarante la campagne suivante, et quatre-vingts
dans la suite.[107]
3. [ Au sujet de la brigade d’Anjou] Si le général
espagnol, lorsqu’il fut désabusé de la prétendue retraite
des ennemis, avait fait partir de quart d’heure en quart d'heure quelques
exprès par le plus court chemin, son contre-ordre aurait pu arriver
à temps, et le maréchal de camp qui commandait cette cinquième
colonne aurait rejoint l’armée par le même chemin du col de
Valante et du vallon de Soustras par lequel il était arrivé
au pied du mont Viso et où il n'aurait eu rien à craindre;
au lieu que, par le défaut de prévoyance, on perdit à
cette fausse marche beaucoup de monde; et on pourrait ajouter ici qu’avant
de prendre la confiance sur la retraite des ennemis, on aurait dû s’en
assurer par quelque parti qui eut été reconnaître et au
moyen duquel on aurait su que cette prétendue retraite n'était
qu'une feinte et une ruse de guerre de leur part.
Cette campagne de 1743 fut un échec pour les armées
franco-espagnoles mais elle leur apporta une meilleure connaissance des montagnes
du Val Varaita et de leurs pièges et fut une
répétition générale pour ce qui se passa l'année
suivante.
Suite
Retour
|
|