Chapitre VI. Les
villes, en 1200 :
La forte croissance démographique
de la fin du XIIe siècle et la renaissance économique
avaient favorisé l'essor des villes, la création de
foires et marchés, la création de nouvelles agglomérations.
AVIGNON
La grande ville de la région
reste Avignon. La
construction d’un pont sur le Rhône, commencée en 1177
sous l'impulsion de Bénézet, dura huit années
Le pont
contribua encore à augmenter le flux de marchandises
passant par la ville.
Commerciale et cosmopolite, Avignon
est alors une des villes les plus riches, opulentes et peuplées
d'Europe et une des villes les plus puissantes du Midi. Protégée
par son enceinte, son pont assure sa renommée
et lui assure une source de revenu considérable.
Elle est en terre d'Empire,
indivis entre les comtes de Toulouse et ceux de Provence car ceux
de Forcalquier avaient abandonné leurs droits à
la communauté qui s'était érigée en
commune.
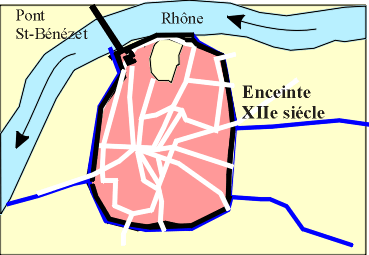


1. Sceau d'Avignon en 1220
On reconnait les quatre consuls, tête nue, et le gerfaut déployé.
Donation aux habitants d'Avignon, par Raymond, fils du comte de Toulouse,
de tous ses droits sur Caumont, Thor, les Jonquières, Touzon,
etc.
2. Sceau d'Avignon, en 1238
La ville crénelée, à trois tours; sur le
pont du Rhône, et le gerfaut déployé
Echange de terres sises à Avignon et dans l'île du Poulvier
ARLES
Arles sur la rive gauche du Rhône
et Trinquetaille en face sur la rive droite vivent du commerce fluvial
et de leur port.
La mer est plus proche d'Arles que de nos
jours
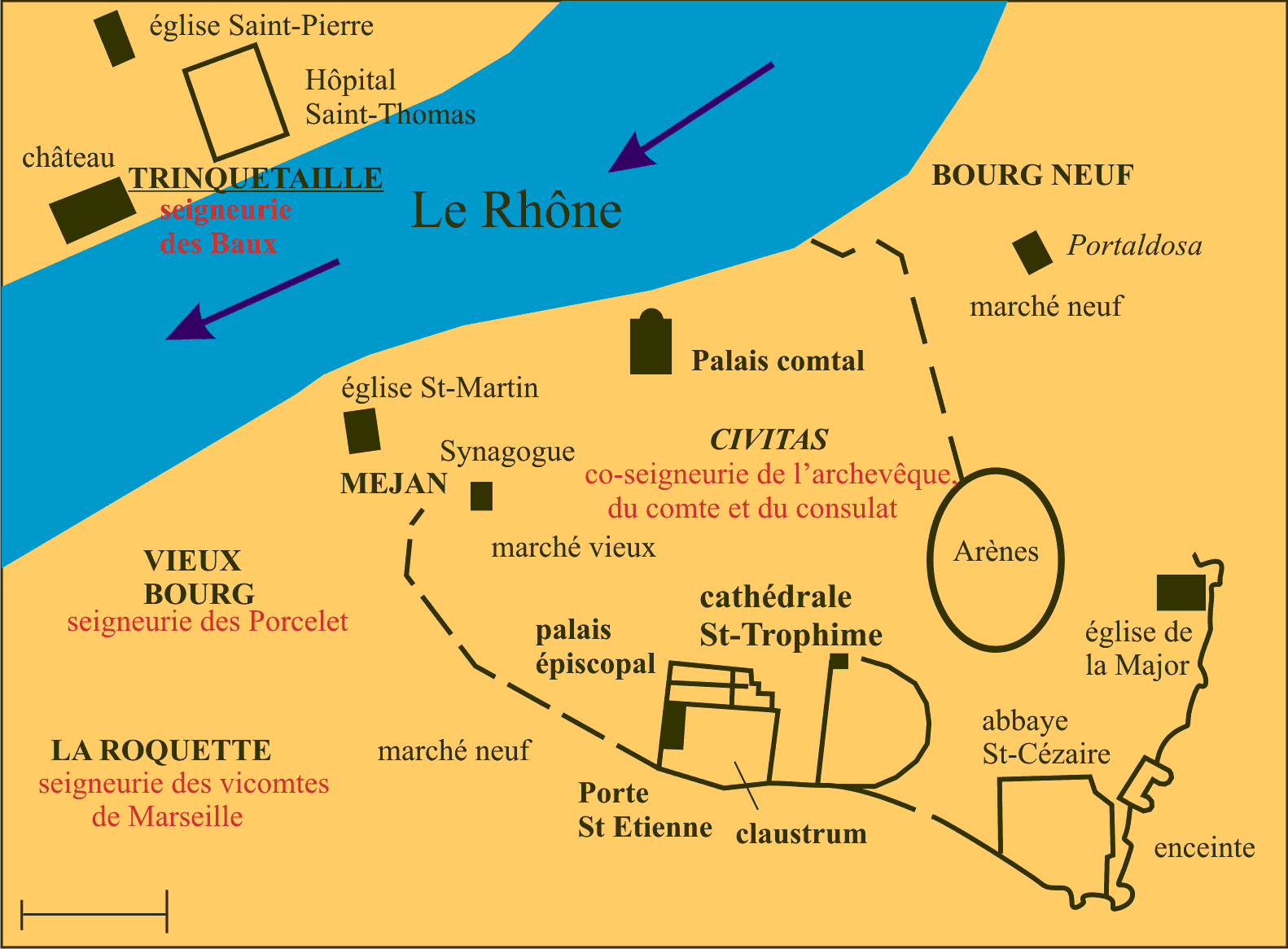
F. Mazel. La ville d'Arles
Arles
est le siège d'un archevêché. Forte de son glorieux
passé, La ville qui compte environ 5.000 habitants souhaite retrouver
son autonomie et a élu un podestat. Ce premier magistrat est chargé
de défendre les intérêts de la ville, contre la pression
féodale des seigneurs et des ecclésiastiques.
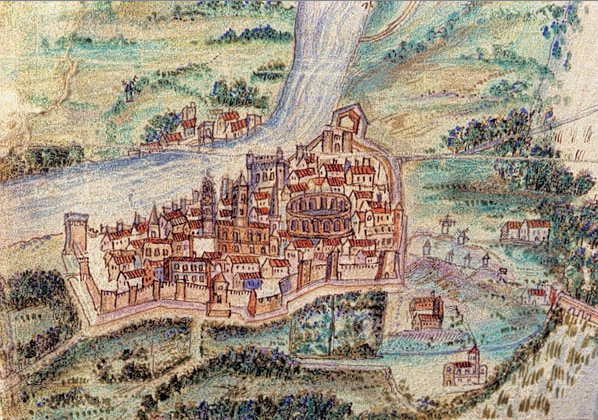 ...............
...............
L'abbaye de Montmajour
Fondée au Xe siècle et construite sur un
rocher entouré de marais par des moines bénédictins,
l'abbaye avait étendu son influence sur Arles et la Provence et possédait
un cinquantaine de prieurés. Elle était souvent en conflit
avec la ville d'Arles au sujet des limites de son territoire, des marais
et des droits de pêche et de chasse.
 .....
.....
MARSEILLE
A Marseille, en ce temps-là,
les vicomtes et les évêques se partagent la ville : les
droits sur la ville haute appartiennent aux évêques
alors que les vicomtes conservent le port et les commerces. L'abbaye
Saint Victor occupe la rive sud du port et connaît un grand
rayonnement culturel.
Une oligarchie de marchands essaie d'imposer
sa puissance pour administrer la ville. La lutte pour l'indépendance
de la commune est en cours. Les marchands ont tiré le vicomte
Roncelin de son abbaye de Saint -Victor et essaie de l'imposer
comme homme de paille à la tête de la ville
L'autorité seigneuriale s'exerce depuis deux châteaux : le
Château-Babon qui a perdu son importance et le Tholonée qui
cristallise les intérêts économiques de la cité
. Les fortifications, murs et tours,
entourent la ville et le port est protégé par une chaîne
commandée depuis la «tour de la chaîne» et par
un réseau de vigies, de «tours à signaux» qui surveillent
jour et nuit l'approche des bateaux.
La vicomté de Marseille (1209-1215)
Hugues
Fer, ancien viguier des vicomtes vient d’être excommunié
par le pape (1209) pour son entente avec Roncelin et la ville de Marseille
a été interdite. En 1210, les autorités marseillaises
sont toujours Roncelin et Hugues des Baux comme vicomtes, Hugues
Fer comme viguier de la ville et les consuls. Leurs envoyés sont
à Pise où ils déclarent en leurs noms, vouloir observer
fidèlement le traité de Paix entre les deux villes et
se défendre mutuellement contre leurs ennemis.
Il faut
aussi compter avec Giraud Adhémar, autre vicomte et avec le
prévôt de la Major, Pierre Bermond, quand ils permettent
l’établissement de cordiers dans une rue de la ville.
Les
consuls créent la confrérie du Saint-Esprit (1212) qui
est à l’origine de la commune de la Ville Basse.
Les vicomtes,
réunis au Tholonée de Marseille, règlent leurs
problèmes de copropriété, partageant par tirage
au sort, les terres et châteaux qu’ils possèdent en commun
hors de la ville (1212) :
• Le
sort donne à Hugues et à Barrale les châteaux
du Castellet, La Cadière, Ceireste, Seillons, un tiers d’Aubagne
et leurs dépendances en terres et en habitants.
• Roncelin
reçoit le deuxième tiers d’Aubagne, les châteaux
de Saint-Marcel, Roquefort, Jullans et Mazaugues.
• Giraud
Adhémar obtient le troisième tiers d’Aubagne et les
châteaux de Gardanne, Roquevaire, Gémenos, le Plan d’Aups.
Le 14 octobre de l’année suivante, avec son épouse Mabile,
ils promettent à Raymond des Baux de donner leur fille Eudiarde
en mariage à son fils Bertrand lorsqu’elle sera nubile. Sa dot
sera constituée des châteaux obtenus lors du partage précédent
sauf Aubagne. Mabile ajoute à cette dot l’héritage de
sa mère Laure, à savoir Saint-Julien, Artigues, Vinon,
Ginasservis, Manosque, Céreste, Rians, Pourcieux, Pourrières
et Rousset. Raymond des Baux donnera à son fils le château
de Meyrargues .
• Le
2 avril 1213, Alasacie de Marseille, fille de Hugues-Geoffroy de
Trets et son mari Raymond des Baux vendent leurs droits sur la vicomté
et le territoire de Marseille (le quart) à la commune représentée
par Hugues Fer, pour une somme de 80.000 sous de royaux coronats .
• Le
15 avril 1215, à Trinquetaille, Hugues et son épouse
Barrale vendent à perpétuité, à Hugues
Béroard, prévôt de la Major de Marseille, tous
les droits qu’ils ont sur le château Babon, pour le prix de cinq
milles sous de royaux coronats qu’ils déclarent avoir reçus.
• Ce
même jour, ils confirment à l’évêque de
Marseille et au prévôt de la Major l’accord signé
jadis par le grand-père de Barrale, Hugues-Geoffroi, son frère
Bertrand et leur neveu Hugues-Geoffroy le Sarde avec l’évêque
Pierre et déclarent en observer le contenu.
Les vicomtes,
s’étant disputés au sujet de leurs biens marseillais, décident
de faire la paix et de choisir des arbitres pour régler leurs
différends. Le 20 mai 1215, dans la maison du Temple, ils
signent un accord préparé par leurs arbitres, devant l’évêque
de Marseille, Reynier, et huit seigneurs provençaux, déclarant
se conformer à la sentence arbitrale qui donne à chacun
un tiers de Marseille, à l’exception du Tholonée. Il y a
là : Roncelin, Barrale et Hugues, et Mabile et Giraud Adhémar.
Ils se promettent de se défendre mutuellement et de ne pas aliéner
leur domaine au comte de Provence ou à d’autres, pendant 10 ans.
.

Roncelin,
dernier vicomte
de Marseille
|
Condamné par le pape, Roncelin se soumet
juste avant de mourir.
La ville entre
alors en conflit avec l'abbaye de Saint-Victor, alors que la
basse ville s'oppose à l'évêque (1216). La
ville est à nouveau interdite et ses habitants sont excommuniés
(1218), jusqu'à l'accord en 1220 avec l'évêque.
Hugues des Baux et l'abbé de St
Victor interviennent auprès du pape Honorius
III et obtiennent la levée de l'interdiction qui pèse
sur la ville.
La ville, par son syndic Pierre Bertrand
achète les droits des Baux sur la vicomté pour
40.000 sous de royaux coronats en 1224. Elle signer
un accord avec l'abbaye de Saint-Victor et rachète les
droits sur la vicomté qu'elle avait obtenus au moment de
la soumission de Roncelin.
La commune possèdera
20/24e des droits des vicomtes en 1224 et se proclamera indépendante
et "vicomtesse". Les comtes de Provence et ceux de Toulouse,
chacun voulant garder de bonnes relations avec Marseille,
reconnaitront ce titre.
L'achat des derniers droits
de Raymond des Baux par le podestat puis de ceux de
Giraud Adhémar aura lieu en 1226.
|
|
|
|

