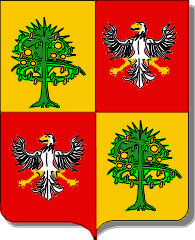Texte
Les Spiafame, appartenaient à une ancienne
et notable famille de Lucques. Dès 1100, ils habitaient vers
le baptistère San Giovanni et leur maison se nommait «
corte Spiafame »,
dans le quartierde Porta San Pietro, avec tour et
jardin.
En 1124 vivait Enrico di Spiafame, fils lui-même
de Signoretto.
Bartolomeo di Toso Spiafame fut propriétaire de
la « corte » au cours de ce siècle.
Rolando, fut consul « treguano» en 1186.
Deux d'entre eux firent, à plusieurs reprises,
partie du Conseil des Anciens : Giovanni, en décembre 1351-janvier
1352, janvier-février 1371, et
Simonetto, qui remplit les mêmes fonctions en
mars-avril 1378, juillet-août 1379, novembre-décembre
1381.
Leur rôle commercial ne fut qu'une des
formes de l'activité des Spifame. Ils étaient aussi
changeurs, prêtant au comte de Flandre, au duc de Bourgogne
et au roi.
Ils sont en relation avec les banquiers pontificaux
d'Avignon.
Branche parisienne :
Simon Ier, arrivé en France vers 1334.
I. Giovanni Spiafame, ° v 1260 Lucques, Notaire de Lucques,
fils de Filippo Spiafame, aussi notaire de Lucques
x Gianna Posarelli v 1280->1317
II. Barthélemy Ier ; † Paris, 15 sept 1385.
x1 Jacqueline de Honfleur ; † >1374.
x2 Jeanne de Pondolin ; † Paris, 11 oct 1381.
Du premier mariage :
III Ne, +>1385 x > 1368 Simon Boucel, , qui
travaille comme agent de son beau-père à Londres (-1368-1369-)
; sp.
III Jean Ier +> 1385, qui dirigea la
succursale d'Avignon et mourut avant son père, s.p.
Giovanni Spifame, directeur de la
compagnie familiale en Avignon, est au nombre de ceux qui assurent
le paiement de la pension accordée par le roi au comte d'Armagnac
(8 février 1372 :
Arch. de l'Aveyron, C 1.332, fol. 3)
III Simon II, +> 1406, seul héritier
de son père en 1385. Il était élu de Paris en
1400 et 1401, x Marguerite de Lesclat, fille de Jean, Maître de
la monnaie de Troyes & de Jeanne de Dammartin.
IV Barthélemi, maître de
la Monnaie de Paris en 1400 et de la Rochelle en 1401-1403 ;
Bartolomeo Spifame était
fournisseur de la Cour de Philippe VI de Valois et passait pour
un des plus importants banquiers de l'époque.
Il fut un des principaux bailleurs
pour payer la rançon de Jean de Hastings, comte de Pembrocke,
gendre du roi Edouard III d'Angleterre.
Il aida à constituer la flotte qui,
en 1370, ramena Urbain V à Avignon et fit des avances d'argent
au roi en 1373 et 1377.
IV Jean, + 1454, écuyer, capitaine
de Conflans-Sainte- Honorine,
x1 Catherine Col, dame de Passy, fille
de Gontier Col, secrétaire du roi, seigneur de Passy
et de Marguerite Ghasserat
x2 Denise de Lagny, + < 27 octobre
1434
Du premier mariage :
V Denise, morte jeune.
V Isabeau, religieuse en l'abbaye de
Chelles.
V Jean III, † 1500. Ecuyer, seigneur
de Bisseaux (77), de Brou (77) et de Passy (89), il est aussi seigneur
censier de Bourbuisson et Pimançon à Dixmont (89).
Il vit toutefois à Paris.
Notaire de Louis XI (1461-1483), conseiller et
secrétaire du roi, il devient commis au paiement des gages dus
aux généraux,
conseillers et maîtres des monnaies, fonction qu'il remplit
jusque vers 1493.
En 1494, Il se voit nommé trésorier
de l'extraordinaire des guerres. Il devient aussi receveur des aides
à Melun (1496-1500).
Le 2 juin 1494, il contresigne une lettre
missive du roi Charles VIII (1483-1498), puis il signe un accord en
parlement le 13 février 1495.
En 1499, il se rend à Genève,
en août et septembre, chargé par le roi Louis XII d'une
mission financière.
x1 > 1462 Jeanne Lamy, fille de Guillaume
; +> 1485. post.
x2 > 1485 Jacquette Ruzé,
fille de Louis & de Pernelle Gaillard ; † Paris, 10 juillet 1525
post.
V Marguerite.
x1 N. ;
x2 Jacques Le Mercier (dit «Du
Moulin»).
IV Antoine, chevalier de Saint- Jean-de- Jérusalem,
vers 1385-1422
II Giovanni Spiafame,v 1300-v 1377, changeur à
Avignon, dirige le comptoir avignonnais dès 1335 x Ne d’où
Branche d'Avignon :
I. N Spifame x Ne
II Guy Spifame +1423, évêque d'Avignon
1420-1423
II Balthazar Spifame, achète les droits
sur Caumont en 1471. Marchand d'origine Lucquoise , il
est maître des rues d'Avignon en 1452, 57, 61, 65,
maître des vivres en 1453, 58, 64, recteur
du pont en 1459, 81, assesseur en 1464, consul en 1462, 70, 80.
Il est député en 1465 auprès
du Pape Paul II pour le prier ne pas aliéner la Ville d'Avignon.
x Gillette Galliani, fille de Pierre, sg de Vedène
& d'Antoinette Capponi
III Delphine Spifame, codame de Caumont
x 27/11/1441 Avignon, Jean de Seytres ° 1407
Changeur et banquier à Avignon, ambassadeur de la ville
d'Avignon, sg de Novaysan & de Châteauratier en Dauphiné.
- Pierre Spifame, damoiseau est sont
proche parent. Il reçoit la terre de la Roque-sur-Pernes et
une partie de Caumont du pape Calixte III en 1458. .
I. Charles Spifame x Marguerite de La Roque
II. Catherine Spifame, d'Avignon
x1 12/6/1429 Louis de Genas 1407-1436 (contrat de
mariage le 12 juin 1429)
x2 23 octobre 1438 avec Laugier Guiran
Les Génas écartellent leurs armes avec celles de Spifame
:
écartelé ; aux 1 et 4, d'or au genêt de quatre branches
passées et repasssées en sautoir de sinople fleuri et boutonné
d'or (qui est de Génas ) ; aux 2 et 3, de gueules à l'aigle
d'argent becquée et membrée d'or (qui est de Spifame).
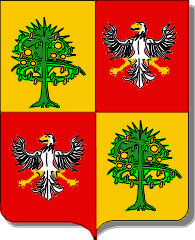
- Sara SPIFAME x 1596 Jacques de Seigneuret, fils de Jean Ier de Seigneuret,
sg de Bordes et de Françoise Viart
Les évêques de la branche parisienne :
Jacques II Spifame, avait déja rempli plusieurs places
dans la robe & dans l'Eglise, lorsqu'il fut nommé évêque
de Nevers par le Roi Henri II en 1547.
II assista aux Etats généraux assemblés
le 5 janvier 1557 & sa fin fut déplorable : il quitta
son évêché pour épouser une femme à
Genève et eut sa tête coupée pour crime d'Etat.
Gilles II Spifame, neveu de Jacques, fut élevé
sur ce siège par la résignation de son oncle en 1558.
II assista au Concile de Trente, & mourut à Paris le
sept avril 1578.
Source :
Mirot Léon.
Études lucquoises. L'origine des Spifame. Barthélemi
Spifame. In: Bibliothèque de l'école des chartes.
1938, tome 99. pp. 67-81.
Parmi les nombreux Lucquois(1) qui, depuis le XIIIe
siècle fréquentèrent la France et y fondèrent
de puissantes colonies, les uns ne s'y fixèrent que momentanément,
retournant toujours dans leur patrie, demeurée
le centre de leurvie familiale ; d'autres, tout en conservant,
au cours des siècles, des liens très étroits
avec leur parenté lucquoise,
s'établirent à demeure en France ; certains
quittèrent définitivement la Toscane et firent souche
de familles qui devinrent exclusivement françaises ;
tels furent les Spiafame,en français les Spifame.
Les Spiafame, appartenaient à une ancienne
et notable famille de Lucques. Dès 1100, ils habitaient
vers le baptistère San Giovanni ;leur maison se nommait
« corte Spiafame »,
dans le quartierde Porta San Pietro, avec tour et
jardin. En 1124 vivait Enrico di Spiafame, fils lui-même
de Signoretto (2). D'aprèsMatraja (3), Bartolomeo di Toso
Spiafame
fut propriétaire dela « corte »
au cours de ce siècle. En 1191, la tour s'écroula,
1. Léon Mirot, Études lucquoises. Paris,
1930, in-8° ; extrait de la Bibliothèque de l'École
des chartes, t. LXXXVIII (1927), p. 50-86, 275-314; t. LXXXIX
(1928), p. 299-329 ; t. XCI (1930), p. 100-168.
2. David Barsanti, Pantheon délie jamiglie
nobili di Lucca, mss. 1137 de laBiblioteca governativa di Lucca,
col. 133.
3. Lucca nel mille ducento. Memoria di Giuseppe Matraja.
Lucca, 1843, in-8°, p. 31, no 122.
faisant de nombreuses victimes(1). On la reconstruisit
et elle porte depuis le nom de Torre Spoletini. Si l'on ne peut
suivre d'une manière continue le rôle
des Spiafame dans l'histoire de Lucques, on sait que,
lors du mouvement populaire de 1308, ils furent exilés comme
riches et puissants. Ils allèrent alors
avec tant d'autres à Venise(2), où ils
portèrent leur fortune et leur activité. Mais, dès
1331, ils étaient rentrés à Lucques(3),où
ils prêtèrent serment
de fidélité au roi Jean de Bohême.
Deux d'entre eux firent, à plusieurs reprises,
partie du Conseil des Anciens : Giovanni, en décembre 1351-janvier
1352, janvier-février 1371, et
Simonetto, qui remplit les mêmes fonctions en
mars-avril 1378, juillet-août 1379, novembre-décembre
1381 ; il était, au reste, alors absent de Lucques,
et fut remplacé par Michaele Ciomei (4).
Cette famille, dont un membre, Rolando, fut consul
« treguano» en 1186, subsista à Lucques : en
1548, le 13 avril, les fils de Gherardo Spiafame
étaient réintégrés dans
la qualité de citoyens; ils s'éteignirent en 1643
(5). Mais la branche la plus célèbre avait, depuis le
XIVe siècle, abandonné
sa patrie pour la France.
Comme pour tant d'autres, ce furent des raisons commerciales
qui les attirèrent en France ; ils y arrivèrent par
la
Provence et le Languedoc. Dans la première
partie du XIVe siècle (6), on rencontre Simone et Giovanni
Spiafame.
1. Cronica di Giovanni Sercambi, éd. Salvatore
Bongi. Rome, 1892, 3 vol. in-8°, dans Istituto storico italiano.
Fonli per la storia, t. I, p. 11.
2. D. Barsanti, op. cit. — Salvatore Bongi, Su i Lucchesi,
dans Atti délia imp. et reale accademia di Lucca, t. XV,
p. 203, 212-213, cite Guido, Guiduccino di
Guace Spiafame comme habitant Venise au xive siècle.
3. Barsanti, op. cit.
4. Luigi Fumi, R. Archivio di Stato in Lucca. Registri,
vol. II. Carteggio degli Anziani. Lucca, Marchi, 1903, in-fol.,
lre partie, p. xxin ; 2e partie, p. xvin-xx.
5. Biblioteca governativa du Lucca, ms. 1137. — Je
dois ces renseignements à MM. Arnos Parducci, directeur de
la Bibliothèque, et Eugenio Lazzareschi, di
recteur des Archives de l'Etat à Lucques, dont
j'ai bien des fois éprouvé l'amicale et inlassable
complaisance.
6. Sur cette émigration lucquoise, voir Léon
Mirot, Études lucquoises ; Id., La fondation de la chapelle
du Vollo Santo en V église du Saint- Sépulcre à
Paris, dans Bollettino Storico Lucchese, anno VI (1934),
num. I, p. 3-28 ;
Bien que l'on ignore tout de leur venue en France,
de leur activitécommerciale, de l'importance et du développement
de leurspremières entreprises,
cependant tout laisse supposer qu'ilsdurent fréquenter
les grands centres économiques français dès
le début de ce siècle avec Simone et Giovanni ;
leur crédit était, en effet, assez grand
pour que, en juin 1342, le lieutenant du roi en Saintonge et en Languedoc,
Jean, évêque de Beauvais, ait accordé
à Bartolomeo Spiafame la qualité de
bourgeois de Paris, de Nîmes, de Montpellier et de tout le
royaume, avec les droits et privilèges attachés à
ce
titre, et, en janvier 1343, Philippe VI confirmait
les lettres de son lieutenant (1). Il est vraisemblable que cette
famille avait déjà rendu des services notables
au pouvoir royal, et, en 1345, Barthélemi
« Epifain », marchand de Lucques, prêtait au
roi 70 livres 9 sous parisis (2).
De même que tous les Italiens d'alors, Barthélemi
Spifame pratiquait le commerce de « mercerie » dans
le sens vague de l'époque, étant à la fois
marchand de draps, de soies, de damas, de velours
et de toutes sortes d'étoffes précieuses, trafiquant
de joyaux, au besoin maquignon, mais
surtout se livrant à l'industrie fructueuse
du change et de la banque, tant à Paris, où il s'établit
de bonne heure, que dans les nombreux centres
où il eut soit des succursales, soit des représentants
ou facteurs.
Marchand de tissus de soie, de draps, de fils d'or
et autres étoffes de prix, Barthélemi Spifame fut
un des fournisseurs attitrés de la cour des Valois
et de celles des maisons princières.
En 1352, il vendait, pour 640 écus, «
v mars de perles achetées de luy par les trésoriers
et baillées audit Nicolas [Wagnier] pour faire les pointes
de III estoilles et mettre autour d'icelles et pour
faire XLVIII gros boutons pour les XII quarreaux dessus ditz, lesquelles
estoiles furent assises
et mises en la courtepointe, ciel et cheveciel d'une
chambre
Id., Forieguerra de Forleguerra et sa succession,
dans Bibliothèque de V École des chartes, t. XGVI
(1935), p. 101-137.
1. Arch, nat., JJ 74, n° 549 ; publié par
Jules Viard, Documents parisiens du règne de Philippe VI
de Valois, dans Société de l'Histoire de Paris et de
V Ile-de-
France, 1899-1900, 2 vol. in- 8°, t. II, n°
CCCXI, p. 194.
2. Jules Viard, Journaux du Trésor de Philippe
VI de Valois, dans Collection de documents inédits sur l'histoire
de France. Impr. nat., 1899, in-4°, n° 665.
de velours semée de fleurs de lys, pour le
roi (1) ». En 1353, il fournissait huit pièces de
cendal en graine pour les courtines de l'oratoire de Blanche de
Bourbon,
reine de Castille (2), et il vendait cette même
année cinquante-sept marcs et une once d'argent baillés
à Jean Le Brachier, qui en fit deux douzaines d'écuelles
d'argent blanc pour l'hôtel du roi, des garnitures
de ceintures pour le dauphin et ses compagnons et une écuelle
d'argent pour remplacer une autre appartenant
à Jean de Pacy et qui, prêtée
par ce dernier au roi lors d'un dîner offert au duc de Lancastre
au Palais à Paris, avait été perdue ; le tout
se montait à 404,75 écus (3).
C'est lui qui fut chargé de tout ce dont on
eut besoin pour le sacre de Charles V en 1364 ; on lui payait pour
ces fournitures 3.437 francs (4); c'est à lui que l'on
s'adressait pour l'achat des étoffes de prix
offertes par le roi aux Célestins, à l'abbaye de
Montmartre, aux églises de Saint-Cosme, de Notre-Dame de
Boulogne,
à l'abbaye de Longchamps (5); il vendait également
des toiles peintes; on lui achetait un gobelet d'or, donné
à la dame de Ternant, pour être offert à l'église
de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers.
Maquignon, il s'occupait, en avril 1363, de l'achat
de coursiers pour celui qui n'était encore que le dauphin
de Viennois (6).
Si Charles V s'adressa souvent à Barthélemi
Spifame, son frère, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne,
compta le Lucquois au nombre de ses fournisseurs habituels.
Dès le 10 avril 1364, c'était un achat
de draps et de cendaux de soie (7); en 1367, c'étaient des
houppelandes, des rubans d'or, du damas pour des chaperons,
des soies de diverses couleurs (8) ; le8 septembre
1383, on lui payait 400 francs pour un fermaillet
1. Arch, nat., KK 8, fol. 102 v°, compte de la
Saint-Jean 1352.
2. L. Douët d'Arcq, Comptes de V argenterie des
rois de France au XIVG siècle, dans Société
de V Histoire de France. Paris, Renouard, 1 vol. in-8°, 1851,
p. 186.
— Il s'agit de la femme de Pierre le Cruel.
3. Arch, nat., KK 8, fol. 164 et 184.
4. Leopold Delisle, Mandements et actes divers de
Charles V, dans Collection de documents inédits... Paris,
Impr. nat., 1874, in-4°, n° 151, p. 73.
5. Ibid., n° 151.
6. Bibl. nat., Pièces orig. 2724, Spifame,
n° 5.
7. B. et H. Prost, Inventaires mobiliers et Extraits
des comptes des ducs de Bourgogne. Paris, Leroux, 1902-1913, 2
vol. in-4°, n° 396.
8. Ibid., n° 666.
d'or et quatre grosses perles et un « balai
» destinés au chapelet que Robert de Varennes faisait
pour le duc (1); c'était cette même année une
importante commande
de vingt pièces de baudequin pour robes et
pourpoints destinés à l'entourage du prince (2),
et quand, au début de 1370, Philippe le Hardi tint sur les
fonts baptismaux
la fille de son secrétaire Jean Blanchet
et qu'il offrit un présent de noces à la soeur de
Philippe de Savoisy, son conseiller, ce fut Spifame qui fournit les
aiguières
dorées et émaillées, cadeaux
du duc de Bourgogne (3).
Toutefois, ce rôle commercial ne fut, comme
pour tant d'autres trafiquants italiens, qu'une des formes de l'activité
des Spifame. Barthélemi était changeur,
c'est-à-dire prêteur sur gages, manieur
d'argent et banquier ; c'est comme tel qu'en 1367 il prêtait
au comte de Flandre, Louis de Maele, des sommes gagées
par « la bonne nef d'argent (4) » du prince.
Ses opérations financières sont surtout
connues avec la France et la Flandre, et la maison de banque qu'il
dirigeait paraît avoir été l'une des plus importantes
de cette époque. Aussi n'est-il pas étonnant
de voir à maintes reprises le nom de Spifame figurer au nombre
des banquiers auxquels s'adressa le pouvoir royal.
Déjà, en 1345, il avait avancé
certaines sommes à Philippe VI (5); en 1354, on lui remboursait
200 livres tournois (6); l'année suivante, il était
encore en compte
avec les trésoriers de France pour une
somme de 3.414 moutons d'or et 3 /4 de mouton, prêtés
le 31 décembre 1355, et sur laquelle on lui remboursait,
le 18 février 1356, un premier acompte de 2,414
deniers d'or, dont il donnait quittance à Bon Jean de Sissonne,
receveur de Vernon (7) ;
il était au nombre des financiers qui fournissaient
de l'argent pour l'hôtel du roi Jean, durant sa captivité
à Londres où Spifame paraît avoir eu une succursale
1. B. et H. Prost, Inventaires mobiliers..., n°
945.
2. Ibid., n° 955.
3. Ibid., n°1217.
4. Chrétien Dehain.es, Documents et extraits
divers concernant l'histoire de l'art dans la Flandre, l'Artois
et le Hainaut a.vanl le XVe siècle. Lille, Danel, 1886,
3 vol. in-fol., t. I, n° 476.
5. Voir plus haut, p. 69. G. Arch, nat., JJ 82, n°
147.
7. Bibl. nat., Pièces orig. 2724, Spifame,
n° 2. — Au bas se trouve la signature autographe « Bartolomeo
Spiafami » et sa marque commerciale.
dirigée, en 1368, par son gendre, Simon Boucel
(1); en effet, le 15 mai 1360, le receveur de Nîmes remettait,
d'ordre de Pierre Scatisse, trésorier de France,
2,000 moutons d'or « pour change fait à
Barthélemi Spifame (2) ». Quand il s'agit de la rançon
du roi Jean, Spifame fut un des principaux bailleurs de fonds ;
son agent à Londres, Simon Boucel, remettait
à cet effet, au début de 1369, au comte de Tancarville,à
Guillaume de Dormans, à Jacques Le Riche, doyen
de Paris, et à Nicolas du Bost, conseiller
de Charles V, 1.540 francs d'or, dont il était remboursé
le 16 février 1369, par Jean Luissier, receveur général
des aides pour la rançon du roi Jean (3).
Lorsque, en 1370, après un séjour de
deux ans à Rome, le pape Urbain V se décida à
revenir à Avignon, Charles V, aux souhaits de qui ce retour
répondait,
comme aussi à l'intérêt du royaume,
mit à la disposition du pontife un certain nombre de navires,
qui devaient être réunis à Marseille et à
Gênes.
Mais, pour les équiper, il dut chercher des
ressources financières : Barthélemi Spifame fut un
de ceux à qui il s'adressa ; le Lucquois, n'ayant pas assez
d'argent
disponible, offrit mille marcs de vaisselle d'argent
qui furent portés à la Monnaie de Paris et fondus
(4). Ses avances se répétaient ; le 18 février
1373, il donnait
quittance à Jean Le Maréchal, receveur
général des subsides et aides du royaume pour le
fait de l'armée de la mer, de 8,000 francs d'or, dont le gouvernement
lui était redevable (5). En 1377, il était
créancier de 200 francs d'or, que le roi paraît avoir
avancés à la papauté (6), et, très
apprécié de Charles V et
de ses conseillers pour son habileté financière,
il était chargé, semble-t-il, de la garde d'une partie
du trésor royal, déposé chez les religieux
1. On voit deux personnages de ce nom de Boucel parmi
les noms figurant dans les Journaux du Trésor de Philippe
VI (J. Viard, ouvr. cité, nos 2142, 2352).
— Sur cette famille, voir C. Piton, Les Lombards en
France et à Paris. Paris, H. Champion, 1892, 2 vol. in-8°,
t. I, p. 147.
2. L. Douët d'Arcq, Comptes de V argenterie...,
p. 200.
3. Bibl. nat., Clairambault, vol. 104, n° 123.
4. Arch, nat., Z*b 56, fol. 68.
5. Bibl. nat., Pièces orig. 2724, Spifame,
n° 6.
6. L. Delisle, Mandements..., n° 1431.
de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers ; c'est
ainsi qu'il remettait, le 11 mai 1378, 2,000 francs d'or«
pour les besognes entre le roi et le roi d'Ecosse » (1),
et, le 12 mai de cette année, 9,000 francs
donnés à Olivier de Glisson pour les besoins de
la guerre (2).
Ces exemples suffisent à montrer quelle était
l'activité et l'importance de la maison de change que Barthélemi
Spifame avait fondée à Paris, et dont les ramifications
s'étendaient dans bien d'autres centres du
commerce international.
La plupart des Lucquois fixés en France avaient
deux villes de prédilection pour leurs opérations commerciales
: Paris et Bruges. Barthélemi Spifame suivit l'exemple
de ses compatriotes ; de bonne heure, semble-t-il,
il eut à Bruges une table de change, dont l'importance et
la renommée ne tardèrent pas à être connues
et appréciées.
En effet, il fut l'un de ces banquiers à qui
les évêques et les abbés de la région
flamande confiaient le soin de verser à Avignon les sommes
qu'ils devaient
à la Chambre apostolique, lors de leur accession
à leur siège episcopal ou abbatial. De 1352 à
1374, il servit ainsi d'intermédiaire aux évêques
de Cambrai,
de Thérouanne, aux abbés de Notre-Dame
de Boulogne, de Saint-Martin de Tournai, du Saint-Sépulchre
de Cambrai, de Blangi, de Saint-Amand-en-Pevele,
de Saint-Sauveur de Ham, de Saint-Nicolas de Furnes,
de Notre-Dame-du-Bois3. Cette continuité durant vingt-deux
ans de la confiance accordée à cette maison
est une preuve de la place qu'elle tenait à
Bruges ; aussi n'est-il pas étonnant que, le cas échéant,
on ait eu recours à elle pour certaines missions délicates
où se trouvaient mêlés les principaux
personnages du royaume. Tel fut le cas en 1373-1374. Au combat
naval livré devant la Rochelle, Jean de Hastings, comte
de Pembrocke, gendre du roi Edouard III d'Angleterre,
avait été fait prisonnier du roi d'Espagne, qui
l'avait remis à Bertrand du Guesclin. On négocia de
sa rançon,
et lorsqu'on se fut accordé, les mandataires
du connétable, c'est-à-dire l'évêque
de Bayeux et le comte de Sarrebrück, déposèrent
à Bruges, chez Barthélémi Spifame,
1. L. Delisle, Mandements..., n° 1712.
2. Ibid., n° 1714.
3. Georges Bigwood, Le régime juridique et
économique du commerce de l'argent dans la Belgique au
moyen âge. Bruxelles, M. Hayez, 1921, 2 vol. in-8°,t.
I, p. 190.
les sacs renfermant 50,000 francs d'argent et des
obligations de paiement (1). Le duc de Bourgogne avait également
recours à lui comme intermédiaire
avec les prêteurs d'argent. Après son
mariage avec Marguerite de Flandre, Philippe le Hardi eut de grands
besoins financiers. Il emprunta des sommes fort
importantes à des marchands de Bruges : Liénart
de Just, Florentin ; Richard de Rest, Milanais ; André
Rouhier, Astesan ; en garantie de cette dette,
montant à 17.185 francs d'or, il engagea la
plus grande partie de ses bijoux, et ce fut Barthélemi Spifame
qui les retira en remboursant les sommes
prêtées, et dont Gui de La Trémoille,
chambellan du duc, Arnaut de Gorbie, son conseiller, maître
Jean Potier, prêtre et son secrétaire, et Huet Hamon,
son trésorier général, se portèrent
caution au nom de Philippe le Hardi (2). Le 30 novembre 1374 (3),
Spifame donnait quittance de 4.200 francs
à lui dus « pour deniers paiez et rendus
à Avignon, par lui, à Bernart et Beudin, diz Bonnot,
frères, marchans, demeurant à Avignon, qui les avoient
empruntés
à usure pour monseigneur, à la requeste
de Benedic du Gai, sur la bonne ceinture de monseigneur ».
De même, le duc Jean de Berri s'adressa souvent à lui
(4) ;
1. Léon Mirot, Études lucquoises. Forteguerra
de Forleguerra... dans Bibliothèque de l'École des
chartes, t. XCVI (1935), p. 305.
2. Arch. dép. de la Côte-d'Or, B 1430
; compte de Huet Harnon de 1369 à 1370.
— Cf. également Léon Mirot, Forleguerra...,
p. 303-304.
3. Ibid., B 340 : analysé par B. et H. Prost,
ouvr. cité, p. 397, n° 2098 ; le prêt était
au taux de 24 %.
— Au bas de l'acte conservé à Dijon
se trouve le sceau ou marque commerciale de Barthélemi Spifame.
Ce sceau existe également dans la quittance
du 16 février 1369 (Bibl. nat., Clairambault,
col. 104, n° 123), et cette marque est dessinée
avec quelques différences dans la quittance du 18 février
1356,
à côté de la signature autographe
« Bartolomeo Spiafami » [Ibid., Pièces orig.
2729, Spifame, n° 2). Nous la reproduisons ci-contre d'après
ce dernier document.
— B. du Gai, pannetier de Philippe le Hardi, devint
conseiller, puis général des Monnaies de France
(sur ce personnage, également Lucquois, voir Léon
Mirot,
Études lucquoises, p. 27-28).
4. Arch, nat., KK 251, fol. 19 v° ; compte de
1370-1371 : « A mondit seigneur, par la main Bertholmieu
Spifame, bourgeois de Paris, en quoy mond. seigneur
lui estoit tenuz par un pièces de sathains
qu'il fiz acheter de luy et envoies à madame la duchesse
par mandement de mond. seigneur rendu à court, lx 1. »
;
— Ibid., fol. 30 v° ; même compte : «
A Barthélemi Spifame, marchant et bourgeois de Paris
pour don fait à îuy par mond. seigneur pour faire
paier comptant d'une assignation de vi° 1., dont le roy avoit
assigné sur Iuy madame Gilles, mère de lait
mons. le sire d'Oliergues et la Grise, norice de madame
Bonne de Berry... »
A la mort du prince, en 1416, Jean et Barthélemi
Spifame figurent avec Jean de L'Éclat (1), leur oncle,
au nombre des créanciers qui donnèrent mainmise
de la saisie sur les biens du défunt (2). La
mention relative à une affaire que Barthélemi Spifame
réglait à Avignon n'a rien qui puisse surprendre.
Il y avait, en effet, et depuis longtemps, une succursale,
dont on trouve trace dès 1350 ; ce qui explique pourquoi
Spifame était l'intermédiaire
entre les évêques et abbés de
Flandre et la Chambre apostolique. Son fils Jean et son neveu François
paraissent l'avoir dirigée vers 1370-1374.
Les rapports de Spifame avec la papauté semblent,
du reste, avoir été nombreux. En 1362, un de ses facteurs,
Jacopo Bianchi, envoyait à Urbain V
des balles de toiles, de nappes et d'essuie-mains
pour l'hôtel pontifical, moyennant 530 L. En 1376, il prêtait
1,000 florins à la Chambre apostolique
et était mêlé à diverses
autres opérations financières avec un autre changeur,
Girardo de Fondora. Il paraît avoir été très
mêlé aux efforts faits par Grégoire XI
pour récupérer les domaines de l'Église
en Italie, lors de leur rébellion ; en 1374, il recevait
des sommes pour le compte de Nicolas de Beaufort, frère du
pape, et, en 1376, pour le compte d'Ame de Savoie,
lors de leurs expéditions dans la péninsule (3). Ce
n'était pas seulement à Paris, à Avignon, à
Bruges,
à Londres que s'exerçait l'activité
de la compagnie des Spifame. Ils avaient soit des succursales, soit
des facteurs dans divers autres centres : à Montpellier,
peut-être le plus ancien des établissements
(4), à Bologne, à Florence, à Pise, à
Venise, où agissaient leurs facteurs, eux-mêmes Lucquois
: Filippo Astarii,
Jacopo Bianchi, Francesco Ostelli, Ruperto di Poggio,
à côté de Simon Boucel, gendre de Barthélémi,
de Jean, son fils, de François, son neveu et
1. Changeur, puis conseiller du roi, général
des aides, président de la Cour des aides, maître des
Requêtes de l'Hôtel, conseiller au Parlement de Paris
(cf. Léon Mirot, Éludes lucquoises,
p. 28-29).
2. Jules Guifïrey, Inventaires de Jean, duc de
Berry. Paris, E. Leroux, 1894-1896, 2 vol. in-8°, t. II, p.
198.
3. K. H. Schäfer, Die Ausgaben der apostolischen
Kammer unter den päpsten Urban V und Gregor XI (1362-1378),
t. VI des Vatikanischen Quellen. Pader
born, Schöningh, 1937.
4. Voir plus loin.
de Guido Gucci Spiafami, son parent, que l'on voit
à Venise de 1351 à 1354 (1).
Comme il était de coutume, les services rendus
par Barthélemi Spifame et sa société au pouvoir
royal furent récom pensés ; on en a du moins
quelques témoignages caractéristiques,
bien que peu nombreux. Déjà en 1342-1343 2, ce fut
l'octroi de sa bourgeoisie avec tous ses privilèges ;
en mars 1354, Jean II, en souvenir de ce qu'avait
fait Spifame sous le règne de Philippe VI et sous son propre
règne, confirma un don précédemment
fait viagèrement de 200 L. t. de rente
annuelle sur le trésor, en le rendant héréditaire
et en le fixant sur les émoluments et revenus de la recette
de la
sénéchaussée de Beaucaire et
de Nîmes (3). Cette faveur se poursuivit sous Charles V ;
en avril 1369, ce roi confirmait une acquisition de terres
en Normandie (4), et quand un procès s'engagea
entre les Spifame et un de leurs voisins de la rue des Lombards
et de la rue de la Vieille-Monnaie,
Jacques Sevestre, au sujet de constructions et de
droit de sortie sur une ruelle desservant leurs immeubles, ce furent
les Spifame qui obtinrent
gain de cause (5), et, en outre, le roi leur abandonna
son droit de voirie sur cette ruelle, en récompense de leurs
bons services (6).
Barthelemi Spifame habitait, en effet, à Paris
dans le quartier qui groupait tous les « Lombards »,
autour de Saint-Jacques-de-la-Boucherie,
dans les rues des Lombards et de la Vieille-Monnaie
(7). Il possédait plusieurs maisons, à trois pignons
"entretenants" rue des Lombards,
1. Je dois ces renseignements sur les succursales
et les facteurs de la Compagnie des Spifame à MM. Yves Renouard,
ancien membre de l'École française de
Rome, professeur à l'Institut français
de Florence, et Albert Mirot, archiviste aux Archives nationales,
que je remercie de leur aimable obligeance.
2. Voir plus haut, p. 69.
3. Arch, nat., JJ 86, n° 146.
4. Ibid., JJ 99, n°483.
5. Ibid., JJ 104, n° 176.
6. Ibid., Xlc 29, n° 42. — Jacques Sevestre devait
être un descendant de Pietro Silvestri, gendre d'Ugolino Belloni
(Léon Mirot, La fondation de la chapelle..., p. 6).
7. Léon Mirot, Études lucquoises, p.
19 à 22.
dont l'un au coin de la rue de la Vieille-Monnaie,
un autre à l'enseigne de l'Aigle, un troisième rue
de la Vieille-Monnaie, à l'enseigne
de l'Image-Notre-Dame, ayant deux cours et aboutissant
rue de Marivaux, et un autre dans cette dernière rue (1).
C'est au sujet
de l'usage d'une ruelle desservant un des hôtels
de la rue de la Vieille-Monnaie qu'il obtint du roi la cession du
droit de voirie.
Il possédait également une maison près
l'Échelle-du-Temple, voisine de l'hôtel qui appartint
au duc de Berri et à son gendre,
Amé VII de Savoie (2). La fortune immobilière
de Barthélemi Spifame ne se bornait pas à ces maisons
à Paris. Aux environs de la ville, il
possédait des domaines importants, tel, près
du pont de Charenton, sur la rivière de la Marne, un moulin
à tan et à blé, avec ses appartenances,
et « un pou d'isle » plantée en
saulaie (3). A Ghaillot, il avait un hôtel, cour, petit jardin,
foulerie et petit pressoir, deux arpents et dix quartiers de
vigne (4); à la Ville-l'Évêque,
il était propriétaire, dès 1378, d'une maison
qu'avant 1385 il vendit aux La Trémoille (5).
Dans la vallée de la Marne, il avait acquis
entre Montjay (6) et Brou (7), dont ses descendants furent seigneurs
jusqu'au milieu du XVIe
1. A. Longnon, Paris pendant la domination anglaise,
dans Société de l'Histoire
il y a tout lieu de croire que cet ensemble
immobilier avait été constitué par Barthélemi
Spifame.
— Ces maisons, dont l'une avait, au xvie siècle,
pour enseigne le Vault de Lucques, appartenaient encore ainsi
que les biens de Chaillot,
à ses descendants (cf. E. Campardon et A. Tuetey,
Inventaire des registres des Insinuations du Ghâtelet de Paris,
dans Histoire générale de Paris,
Impr. nat., 1906, in-4°, p. 184, n° 1684).
2. Arch, nat., JJ 123, n° 193. — Voir, sur les
hôtels du duc de Berry, Henri de Curzon, La maison du Temple
de Paris. Paris, Hachette, 1888, in-8°, p. 317 (rue
des Bouchers) et p. 325 (rue de PÉchelle-des-Haudriettes),
et Léon Mirot, Communication sur l'histoire de l'ancien
hôtel de Navarre, rue de Braque, n° 2, et rue
des Archives, n° 49, dans Procès-verbaux
de la Commission municipale du Vieux-Paris, année 1925,
p. 51-54.
3. A. Longnon, Paris..., p. 51, n° XXVIII.
4. Ibid.
5. Note manuscrite de mon regretté ami Maurice
Dumolin. Des La Trémoïlle, cette maison passa, après
1575, aux Joyeuse, comtes du Bouchage, puis aux
Minimes, au cardinal de La Rochefoucauld, aux Jésuites
(1605), à Charlotte-Marguerite de Gondi, marquise de Maignelai
(1623), qui, en 1639, la partagea
entre les Capucins et les dames de l'Assomption.
6. Montjay (Seine-et-Marne, cant, de Lagny-sur-Marne
, comm. de Villevaudé).
7. Brou (Seine-et-Marne, cant, de Lagny).
au lieu dit la Forêt (1), un important domaine,
comprenant hôtel, cour, grange, pressoir, étables,
bergeries, colombier, jardins et pourpris « cloz à foussez
et
pont leveiz », deux jardins clos l'un à
murs, l'autre à fossés,où se trouvaient deux
fosses à poisson ; autour de la maison et de ses dépendances
immédiates
s'étendaient soixantedouze arpents de bois,
trois arpents de saulaies, un étang d'une superficie de sept
arpents, deux cents arpents de terres labourables,
huit arpents de prés(2). Non loin de là,
à Noisiel (3), il était propriétaire de dix
arpents de prés ; à Saint-Thibault, près Lagny-sur-Marne
(4), de trois arpents
de vigne et d'une petite maison. En outre, le 26 juin
1368, il avait acquis, moyennant 2,000 livres tournois, par contrat
devant Jean Postel et Gilles Blanchet,
notaires au Châtelet, sur Nicolas Dagord,
chevalier anglais, un manoir, hôtel, hébergement,
terroir et appartenances, sis à Farceaux, et que ce dernier
avait
reçu de Jean Ghandos, vicomte de Saint-Sauveur
(5).
A cette fortune immobilière considérable
s'ajoutaient les capitaux mobiliers, le produit tant de la maison
de « merceries » que des comptoirs de banque et
de change et aussi ce que Barthélemi Spifame
tirait des prêts qu'il paraît avoir pratiqués,
non seulement à l'égard des papes, rois et princes,
mais aussi
des particuliers. Bien que les exemples de ce genre
d'activité ne soient pas parvenus nombreux, on peut cependant
les déduire de quelques faits.
C'est ainsi que le 1e août 1380, un accord intervi,nt
entre Barthélémy Spifame et Jacques Brunetot ;
1. Lieu détruit, comm. de Brou. Simon Spifame
y reçut Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et Jean sans
Peur, le 4 septembre 1401.
2. A. Longnon, Paris..., p. 51, n° XXVIII. — Les
Spifame rendirent hommage pour Brou en 1450, 1451, 1454, 1461 (cf.
Léon Mirot, Inventaire analytique
des hommages rendus à la Chambre de France.
Fascicule I : Prévôté et vicomte de Paris.
Melun, impr. adm., 1932, in-8°, nos 400 à 403). La terre
de
Brou fut apportée par Antoinette Spifame, fille
de Jean et de Marie Lamy, à son mari, Charles de La Vernade
; elle fut vendue, vers 1563, à Charles Le Prévost
par les héritiers de Pierre de La Vernade,
maître des Requêtes de l'Hôtel (Ibid.,n°
404).
3. Noisiel (Seine-et-Marne, cant, de Lagny). — Voir
Longnon, Paris..., p. 51.
4. Saint-Thibault (Seine-et-Marne, cant, de Lagny).
— Voir Ibid.
5. Arch, nat., JJ 99, n° 483. Farceaux (Eure,
cant. d'Étrépagny). — D'après l'abbé
Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris, éd. Cocheris,
revue par Bournon,
les Spifame auraient possédé des biens
à Issy (t. III, p. 9) ; mais je n'ai pu retrouver dans Sauvai
la référence indiquée dans l'édition
de Lebeuf (Sauvai,
t. III, p. 327 et 385) ; ces biens auraient été
donnés par Henri VI à Thomas de Longueil et à
Thomas Gargatide, Anglais.
cet accord apprend que Spifame avait prêté
400 francs à Jean Brunetot, chevalier, de qui Jacques était
l'héritier. La dette n'ayant pas été payée,
Spifame
avait fait saisir une maison appartenant à
son débiteur et sise proche Saint-Laurent. Par l'accord,
Jacques s'engagea à s'acquitter avant la Saint-Remi
et comme garantie donna en gage des pierres précieuses
(1). Quelques années plus tard, un long procès fut
engagé devant l'officialité de Paris (2),
au sujet d'une cédule portant vraisemblablement
obligation pécuniaire, au moment de la succession d'un riche
changeur et bourgeois, Pierre des
Landes, par Simon Spifame, fils de Barthélemi,
et par Dine Raponde, curateur de Barthélemi Spifame (3),
contre les héritiers de Pierre des Landes,
Pierre et Bertrand des Landes,ses fils, Jean de Vaudetar,
son gendre, et un quatrième héritier. Dans ce procès,
dont on ignore l'issue, furent cités
comme témoins de nombreux changeurs et merciers
italiens demeurant à Paris et qui avaient vécu dans
la familiarité de Barthélemi Spifame.
Au moment où s'ouvrait ce procès, Barthélemi
Spifame mourait, le 15 septembre 1385, âgé et affaibli
par la maladie.
Il fut inhumé dans l'église des Grands-Augustins,
où il avait fondé une chapelle, au chevet de l'église.
Cette chapelle servit de sépulture
à ses descendants jusqu'au XVIe siècle
(4) ;
1. Ibid., Xlc 41, n° 71. — Cette maison était
située vers le n° 119 de l'actuelle rue du Faubourg
Saint-Martin à côté du presbytère (cf.
Louis Brochard,
Histoire de la paroisse et de l'Église Saint-Laurent.
Paris, H. Champion, 1923, in-8°, p. 26, 124, 137.
2. Joseph Petit, Registre des causes civiles de l'officialité
épiscopale de Paris, 1384-1387, dans Collection de documents
inédits. Paris, Impr. nat., 1919, in-4° ;
voir à la table, rédigée par
M. Paul Marichal, aux noms Barthélemi et Simon Spifame.
3. Le procès était commencé au
début de 1385, Barthélemi Spifame vivant encore.
Il ne paraît pas en personne, mais est représenté
par Dine Raponde,
« curatore Bartholemei Spifame ». Son
nom disparaît après le 15 septembre 1385 ; Simon
figure seul comme héritier de Barthélemi.
4. D'après Raunié, Épitapkier
du Vieux-Paris, dans Histoire générale de Paris. Paris,
1890-1899, 3 vol. in-4°, t. I, n° 279 : « Soubz ceste
tumbe sont
inhumez le sieur Barthélémy Spifame,
natif de Lucques, et damoyselle Jehanne de Pandolin, sa seconde épouse,
+ 11 octobre 1391 et le dit Spifame le 15/9/1385
Auprès duquel soubz la proche tumbe gist damoiselle
Jacqueline de Honfleur, sa première femme, laquelle décéda
le 28/9/1348. »
II y a erreur dans certaines des dates, Jacqueline
figurant encore comme vivante dans un acte de juillet 1374 (Arch,
nat., Xlc 29, n° 42).
les derniers Spifame, qui s'éteignirent en
1642-1643, furent enterrés en l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie,
dans la chapelle Sainte-Anne (1).
Barthélemi Spifame avait été
marié deux fois ; il avait épousé, en premières
noces, Jacqueline de Honfleur, qui vivait encore en 1374, et,en
secondes noces,
Jeanne de Pondolin, Cette dernière mourut quelque
temps avant son mari.
Il semble avoir eu trois enfants, une fille, qui épousa
Simon Boucel, et deux fils : Jean, qui dirigea la succursale d'Avi
non et mourut avant son père, et Simon.
Ce dernier, dans le procès contre les Vaudetar
et les des Landes, est indiqué comme seul héritier
de son père. Ce fut lui qui continua la famille.
Il était élu de Paris en 1400
et 1401 (2) ; il laissa trois fils :
- Barthélemi, maître de la Monnaie de
Paris en 1400 et de la Rochelle en 1401-1403 (3) ;
- Jean, écuyer, capitaine de Conflans-Sainte-
Honorine, qui épousa Catherine Col (4), fille de Gontier
Col, et, en secondes noces, Denise de Lagni (5),
et qui vivait encore en 1451 (6), et
- Antoine, chevalier de Saint- Jean-de- Jérusalem
(7).
1. Jacques Meurgey, Histoire de la paroisse Saint-
Jacques-de-la-Boucherie.Paris, H. Champion, 1926, in-4°, p.
283.
2. Arch, nat., S 1461, fol. 313 ; — et Bibl. nat.,
Clairambault, vol. 763, p. 8.
— II était mort avant le 8 juillet 1405. Sa
femme se nommait Marguerite (Bibl.nat:, Clairambault, vol. 763,
p. 23).
3. F. de Saulcy, Recueil de documents relatifs à
l'histoire des monnaies frappées par les rois de France
depuis Philippe II jusqu'à François Ier,
dans Collection de documents inédits..., 1888-1892,
3 vol. in-4°, t. II, p. 111, 119, 125, 128.
4. Fille de Gontier Col et de Marguerite Ghasserat
(voir A. Coville, Gontier et Pierre Col et l'humanisme en France
au temps de Charles VI. Paris, B. Droz,
1934, in-4°, p. 62 et 66). — Le mari de Catherine
Col était non le fils de Barthélemie, mort avant
1385, alors que Gontier Col avait à peine trente-cinq ans,
mais son petit-fils. C'est Catherine Col qui apporta aux Spifame la
seigneurie de Passy (Yonne, cant, de Sens), que j'ai précédemment,
et à tort, identifiée avec Passy (Nièvre, cant,
de La Charité, comm. de Varennes-les-Narcy).
5. Bibl. nat., Clairambault, vol. 763, p. 133. — Denise
de Lagny était morte avant le 27 octobre 1434.
6. Léon Mirot, Inventaire analytique..., n°
400.
— Jean Spifame s'excusait de ne pouvoir rendre en
personne l'hommage au roi, étant donné son grand
âge ;
Charles VII, le 22 septembre 1450, le faisait recevoir
par le prévôt de Paris. Il dut mourir en 1454 ; Jean
Spifame le jeune se déclarait, le 17 juin de cette
année, son héritier (Bibl. nat., Glairambault,
vol. 763, p. 320).
7.Il avait dû naître vers 1385. Le 8
juillet 1405, il donnait décharge du compte de tutelle
à son frère (Bibl. nat., Clairambault, vol. 763,p.
47).
Il vivait encore en 1422 (A. Longnon, Paris..., p.
55, n° XXVIII).
A ce moment, les Spifame avaient complètement
délaissé la Toscane. Ils étaient devenus Français,
fournissant des officiers de finance et de justice à la royauté
;
deux d'entre eux furent successivement, au XVI siècle,
évêques de Nevers et l'un d'eux chancelier de l'Université
de Paris. Ils s'éteignirent au XVIIe siècle,
avec Jean Spifame, chevalier, seigneur de Bisseaux
et des Granges, conseiller et maître de l'hôtel ordinaire
du roi, qui mourut le 10 avril 1642 (1).
1. Il fut inhumé à l'église Saint-Jacques
de la Boucherie, dans la chapelle Sainte-Anne. Son épitaphe
se termine par ces mots : C'est le dernier du
nom et des armes, (cf. Jacques Meurgey, op. cit.,
p. 283).