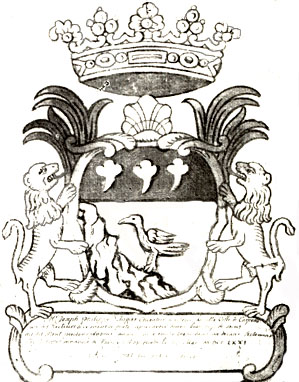à Carpentras, à
Avignon, Caderousse, Velleron, Cavaillon-
D'azur, au geai d'or perché sur une montagne du même.
PIT I-87
- SUPPORT : Deux
lions.
- DEVISE
: Volenti nihil difficile
- D'azur à trois croissants d'argent posées 2
et 1.
- Ecartelé : 1) d'azur à trois croissants d'argent
posées 2 et 1 ; 2) de gueules au vaisseau d'or;
3) de gueules au dextrochère armé d'or mouvant du
flanc senestre et tenant une épée haute d'argent;
4) d'azur à trois croissants d'or posés
2 et 1 accompagné d'un quintefeuille du même en
abîme
 Généalogie :
Généalogie :
Page 1a : les origines
Page 1b : à Carpentras, Avignon
Les Augier étaient de grands seigneurs ayant
des propriétés sur les bords du Rhône, dans le
voisinage d'Avignon, même avant le XIIe siècle.
PIT
Au XIIe siècle, les titres montrent qu'ils
étaient seigneurs près d'Avignon, ayant des droits
sur un port ( Portus Augeriorum , port des
Augiers)
sur un autre port à l'embouchure de
la Sorgue.
Preuves suivies depuis le commencement
du XVIe siècle à Carpentras.
La seule branche subsistante est passée à Avignon
en 1650.
D'azur à l'aigle d'argent gravissant
un mont du même, mouvant du flanc dextre et de la
pointe ; au chef de gueules chargé de 3 trèfles
d'argent.
DON
Complément
:
AUGIER (Victor), né à Orange le 26 juillet 1792,
avocat d'abord à Valence, ensuite près la cour royale
de Paris, et ensuite avocat aux conseils du roi
et à la cour de cassation, correspondant de la
société philotechnique de Paris et de l'académie
de Vaucluse, a publié :
- 1° Encyclopédie des juges de paix, ou Traités
par ordre alphabétique sur toutes les matières qui
entrent dans leurs attributions. 5 vol. in-8°,
Paris, ouvrage à la rédaction duquel ont
concouru les premiers jurisconsultes de notre siècle.
- 2° Journal de la magistrature et du barreau,
ou doctrines de la cour de cassation et des autres cours du royaume,
comparées entr'elles et
avec l'opinion des jurisconsultes les plus célèbres,
par une société d'avocats sous la direction de M. V.
Augier. Paris, in-8°.
( Ce journal, qui continue toujours de paraître,
est publié par livraisons, au nombre de 12 par an formant
un seul volume, et dont la première est datée du 1er
novembre 1832).
- 3° Le juge de paix, journal de jurisprudence
civile et de police, ( un vol. in-8° par an ) publié depuis
1831.
- 4° Une vingtaine de mémoires imprimés,
sur des questions de droit.
- 5° Le beau-père et le gendre, 2 vol. in-12,
Barba, éditeur; M. V. Augier en a fait les vers, et son beau-père
(Pigault-Lebrun) la prose.
- 6° Voyage dans le midi de la France (par Pigault-Lebrun
et M. V. Augier), un vol. in-8°. Barba éditeur.
- On trouve dans l'Almanach de l'arr. d'Orange pour
1810 (pag. 293-306) une lettre sur cette ville, par Augier fils à
son ami B...de Nismes.
Sources :
- Pithon-Curt, t. 1, pag. 182 et t. 4, p. 216-219.
- Hist. du Languedoc, t. 3, p. 605 des notes, et p. 576,
591 et 594 des preuves.
- Giberti, Op. cit. t. 1, ch. 4 et ibid. ch. X, art.
1, p. 1081 et 1082.
- Mistarlet, p. 92-100
- Barjavel
AUGIER
de Cavaillon
Augier Augier etait damoiseau
de Cavaillon en 1365. Il épousa Isoarde Cabassole, fille de
Philippe qui fut syndic d’Avignon dans les années 1370. En 1379, il
occupa la charge de viguier de Cavaillon.
Plusieurs années après, on le retrouve écuyer du cardinal
Pedro de Luna. Quand ce dernier accéda au pontificat sous le nom de
Benoît XIII, Augier Augier rejoignit tout logiquement le corps de ses
écuyers d’honneur.
Le souverain pontife, lui confia la forteresse d’Oppède pendant trois
ans, entre juin 1395 et juin 1398.
Il s’empara des Taillades en son nom dans les premiers jours de décembre
1398.
En mai 1399, Augier dut recevoir une amnistie comme les autres partisans
de Benoît XIII.
Avec le retour du pape au pouvoir, la carrière d’Augier fut relancée.
Il fut nommé viguier de Cavaillon au début de l’année
1404
Il accompagna Benoît XIII de Marseille à Gênes.
Il revint ensuite à Cavaillon et resta viguier jusqu’en 1410129.
À sa mort en 1414, il laissait deux fils, Guillaume, un chanoine de
Cavaillon, et Pierre, le cadet, qui partit un temps étudier à
Bologne.
Source : Les nobles de Cavaillon
(XIIIe‑début XVe siècle)- Germain Butaud
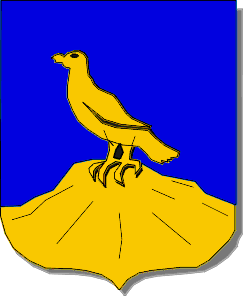

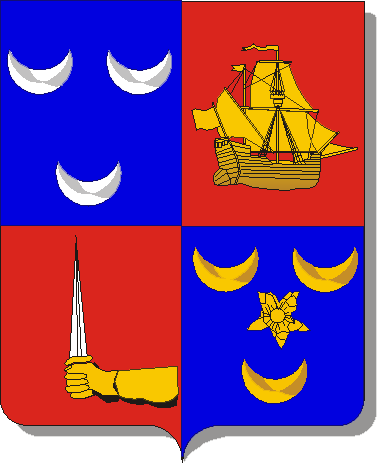
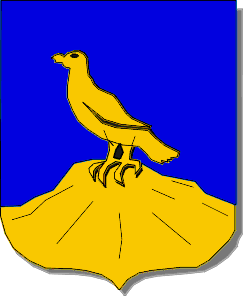

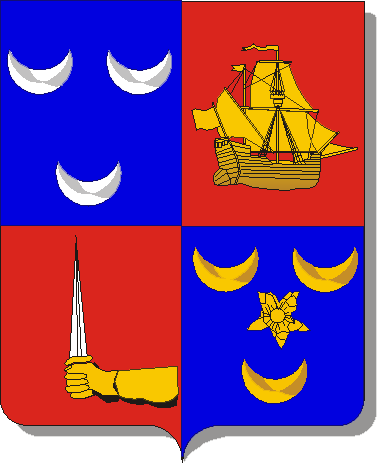
Généalogie :