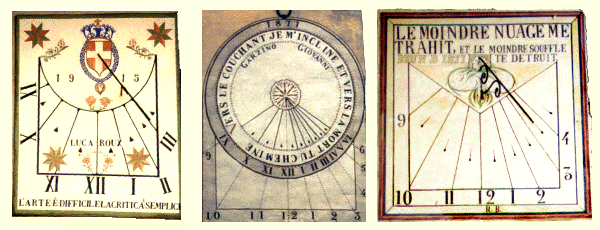| |
|
|
|
Chapitre XVI.
Peuplement alpin maximum.
Un peuplement important des Alpes.
La
période 1800 - 1850 est celle de plus fort peuplement des Alpes.
En Queyras, on exploite les terres cultivables jusqu’à 2200m principalement
pour le seigle et l’orge. Abondance du bétail entraîne une
utilisation intensive du fumier.
En 1845, le chemin du Queyras est rendu carrossable,
surmontant l’obstacle des gorges du Guil et un an plus tard, on lance le
projet de ligne ferroviaire de Turin à Gênes.
Bellino
compte 1.086 habitants, en 1838, et atteint son peuplement maximum
vers 1870. Nul doute que là aussi, les terres cultivables remontent
bien haut vers les sommets et que l’élevage des vaches et des moutons
entraîne la construction des «albergs» près des
sommets, comme à Vautour ou aux granges de l’Autaret.

Les voies de communications de nos vallées ne sont pas fameuses.
En Ubaye, par exemple, quand le sous-préfet de 1841 acheta une voiture
à deux roues, il fallut l'amener démontée, à
dos de mulet, et le roulage n'atteignit Barcelonnette qu'en 1848. Grosse
différence avec la vallée de la Durance, mais qui n'empêchait
nullement l'économie rurale de connaître un beau développement
agricole et pastoral, ni les montagnards de courir le monde.
“La
dernière phase de surpeuplement des Alpes a été celle
de la première moitié du XIXe siècle, après
les guerres de la Révolution et de l'Empire, avec la généralisation
de la pomme de terre et les premiers progrès économiques.
La population des Alpes (sans l'avant-pays) aurait alors légèrement
dépassé 1 million d'habitants, dont 47% pour les Alpes du
Sud et 53% pour les Alpes du Nord. Une très forte natalité,
presque partout supérieure à 30 pour 1000, laissait,
malgré une forte mortalité, des excédents naturels
variant de 2 à 10%, suivant les secteurs, excédents qui iront
s'amenuisant au cours de la seconde moitié du siècle à
cause d'une baisse sensible de la fécondité et du vieillissement
de la population par émigration. Au milieu du XIXe siècle,
les Alpes rurales sont donc beaucoup plus peuplées qu'aujourd'hui
; ce peuplement dense est à la fois la cause et la conséquence
d'une organisation rurale adaptée aux conditions anciennes
de la montagne.” [20]
“Les
traits spécifiquement montagnards, tels que la prépondérance
de l'élevage, le développement précoce d'une démocratie
rurale, la mise au point d'une véritable
civilisation de l'étagement méritent une analyse
complète, indispensable pour mieux comprendre la part de l'agriculture,
de l'élevage, de la forêt et des ressources complémentaires
dans cette économie traditionnelle qui connut son apogée
au milieu du XIXe siècle.”
L'autarcie
de cette ancienne économie n'est pas spécifique puisque partout
les ruraux devaient plus ou moins produire eux-mêmes ce qui était
nécessaire à leur vie. De ce point de vue, les montagnes
n'étaient d'ailleurs pas les plus défavorisées. Si
elles récoltaient moins de blé que les plaines, elles élevaient
plus de bétail et, grâce à leurs minerais, à
leurs forêts, à leurs eaux motrices, à leur laine,
possédaient un éventail industriel assez étendu.
Les
communautés de haute montagne, particulièrement, associaient
trois étages agricoles : le fond de vallée pour les cultures
et quelques prairies de fauche ; le niveau intermédiaire, brouté
au printemps, fauché l'été, brouté à
l'automne ; l'alpage, dont parfois la partie inférieure pouvait
être fauchée. Trois niveaux d'habitat répondaient aux
trois niveaux d'exploitation.
L'étagement
explique les multiples migrations des hommes et des animaux :
montée aux alpages, directe ou avec un étage intermédiaire,
descente symétrique à l'automne ; déplacements d'hiver
pour consommer le foin entassé dans des granges ; transhumance d'hiver
en direction des régions basses, ayant pour corollaire l'été
la montée des troupeaux provençaux ; migrations de
travail des hommes, quelquefois l'été (faucheurs, moissonneurs,
bergers, fromagers, maçons), surtout l'hiver
(petits métiers, commerces ambulants). Ce mouvement perpétuel
était l'une des conditions de survie d'une population trop nombreuse
pour les ressources d'un seul étage, d'un seul terroir ou d'une
trop courte saison d'été.
Tandis
que l'agriculture se trouvait plus à l'aise dans les plaines et
plateaux de la montagne, l'élevage gagnait avec l'altitude.
Essentiellement nourricière, l'agriculture ajoutait aux céréales
(blé jusque vers 800 m, seigle, orge) la vigne (jusqu'à 1000
m ), les légumes (la pomme de terre), les plantes textiles (chanvre,
lin, mûrier à soie dans le bas), les arbres à cidre
(poirier plus que pommier), les arbres à huile (noyer, amandier,
olivier au sud). Le nord suivait l'assolement triennal (céréale
d'hiver, céréale de printemps, jachère), le sud l'assolement
biennal blé-jachère (qui était aussi un dry-farming
avant la lettre).” [20]
Mais
l’ouverture de routes, comme celle des gorges du Guil, en Queyras, rompt
l’équilibre économique qui reposait sur une stricte autarcie.
Le progrès entre dans nos vallées qui vont commencer à
se dépeupler [53].
Dans
les Alpes-Maritimes, on construit les routes des vallées, en Vésubie,
en Tinée, et la Basse Corniche sur le bord de mer.
Les cadrans solaires de Blins
La commune de Bellino s'orne de nombreux cadrans solaires qui sont autant
de citations locales. Récemment restaurés sur des fonds européens,
ils sont un exemple de tradition locale. On en compte 32 dans les principaux
hameaux de Chiesa, Prafauchier, Celle, Chiazale et S. Anne.
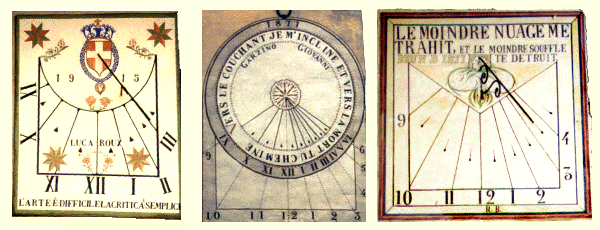
On se reportera au site créé à l'occasion de cette
restauration par Site
cadrans solaire : [102]
Mon arrière-grand-père paternel, Levet Giovanni Antonio (1857-1935),
"Conciliatore del' Comune di Bellino en 1896, sous le Roi d'Italie Umberto
Ier, est l'auteur de quelques cadrans solaires, signés de son nom,
entre autres celui de la façade de l'église située
à l'entrée de Chiazale, ce qui lui vaut d'être honoré
par le musé de Bellino ouvert en 2005. On se reportera à
la généalgie familiale pour connaître ses autres réalisations.
Suite
© Copyright JG 2005
|
|